
Lancé en 2020, le projet Métha-BioSol vise à améliorer les connaissances sur l’effet des digestats sur la qualité biologique et écologique des sols. Les résultats en conditions agricoles réelles sur 80 parcelles seront bientôt disponibles.
C’est un travail de quatre années qui est en train d’aboutir avec, notamment, un colloque de restitution le 25 juin dernier à l’Institut Agro de Dijon. Soutenu par l’Ademe, le projet Métha-BioSol a rassemblé plusieurs partenaires (Institut Agro Dijon, Inrae, Elisol environnement, Esa d’Angers, université de Rennes I) autour de la question de « l’impact des digestats de méthanisation sur la qualité biologique et écologique des sols ». Face au constat du manque de données scientifiques et d’informations contradictoires émanant du terrain, il devenait en effet essentiel d’objectiver cet impact pour répondre aux interrogations des agriculteurs méthaniseurs.
Métha-BioSol s’est déroulé en trois étapes.
- La première, en laboratoire, a consisté à tester différents types de digestats sur différents types de sols, sans récurrence des apports (un seul apport).
- La deuxième reposait sur des prélèvements de sols sur des sites expérimentaux de longue durée dans des contextes pédoclimatiques divers (Bretagne, Alsace) : des digestats variés y sont épandus depuis plusieurs années (récurrence des apports depuis trois à huit ans). Dans les deux cas (laboratoire, sites expérimentaux), les mesures se rapportaient à des indicateurs biologiques précis : diversité et activité des macro et micro-organismes (lombriciens, nématodes, champignons, bactéries) ; dynamique du carbone ; état sanitaire (présence de trois pathogènes, quantification d’E. coli).
- Dans la troisième étape du projet, encore en cours, l’objectif est de mesurer l’impact des pratiques agronomiques liées à l’épandage de digestats sur un réseau de 80 parcelles agricoles dans les régions Paca, Bretagne-Pays-de-la-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Les résultats obtenus au laboratoire montrent que les sols sableux sont plus sensibles à l’apport de certains digestats, notamment ceux présentant un rapport C/N faible, c’est-à-dire une quantité d’azote importante. « À cette échelle, ces résultats constituent un élément de réponse mais ne gagent en rien de ce qui peut se passer sur le terrain, notamment parce que les micro et mésocosmes étaient dépourvus de plantes », soulignent toutefois les auteurs du rapport. Les micro et mésocosmes sont des dispositifs expérimentaux en labo ou serre, de taille petite ou moyenne, dans lesquels sont reconstitués des milieux naturels, et où les paramètres sont contrôlés pour étudier les réponses des espèces.
Réponse sensible après huit à dix ans d’apports
Dans les sites expérimentaux, les indicateurs de la qualité biologique des sols répondent aux apports de digestats après huit à dix ans de récurrence. Les paramètres physico-chimiques (C organique, N total, pH), la qualité microbiologique (biomasse, richesse) et nématologique (abondance, diversité) semblent être les plus impactés. Dans les sols prélevés, ceux ayant reçu un digestat semblent présenter une biologie différente de ceux ayant reçu du fumier non digéré ou une fertilisation minérale.
Les résultats de Métha-BioSol montrent ainsi que les impacts à court terme (labo) et moyen terme (sites expérimentaux longue durée) de l’épandage de digestats sur la biologie des sols sont variables et dépendent à la fois du type de sol (pH, texture) et des caractéristiques du digestat (C/N notamment). Le déploiement des indicateurs en conditions réelles de terrain sur un réseau de fermes épandant des digestats depuis plusieurs années pourrait permettre de renseigner davantage l’impact sur la qualité des sols agricoles, en association avec les pratiques agricoles. Il est probable que des mécanismes de compensation puissent être mis en avant. Cette démarche implique une vision systémique de l’usage des digestats dans divers systèmes de cultures et diverses situations pédoclimatiques.
Survie des pathogènes après épandage
Concernant la qualité sanitaire des sols, deux des trois pathogènes recherchés ont été détectés dans un même digestat ; et ils ont été identifiés simultanément dans les microcosmes préparés avec ce digestat et le sol limono-argileux. Cela suggère une survie potentielle des bactéries pathogènes dans le sol après épandage, conditionnée par les caractéristiques du sol. La concentration initiale des pathogènes dans le digestat influence aussi leur durée de détection. Cela montre que la qualité sanitaire du digestat est un élément important à prendre en compte ; et que les caractéristiques du milieu receveur doivent aussi être prises en considération avant de conclure sur l’impact du digestat sur la qualité sanitaire des sols.
- Méthanisation : ses bénéfices agronomiques et agroécologiques en question
- « Nous maîtrisons mieux le cycle de l’azote »
- L’impact des digestats sur les sols à l’étude
- Des Cive respectueuses de la durabilité des systèmes
- « Vers un système plus économe et résilient »
- Assurer une fertilisation efficace et économe avec les digestats




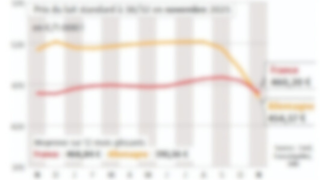
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard