
L’empreinte carbone de la filière laitière provient à 80 % des élevages. Les démarches RSE des transformateurs les obligent à les inclure dans leur stratégie bas carbone. Un atout que les producteurs ne doivent pas rater.
On ne dit plus réduction de l’empreinte carbone mais décarbonation. Il s’agit en fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) à fort pouvoir de réchauffement climatique. Traduisez, pour la filière laitière, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote, ces deux derniers étant convertis en CO2 pour exprimer l’empreinte carbone de l‘activité. Le sujet monte chez les industriels laitiers, qu’ils soient privés ou coopératives. Il place les éleveurs au centre de leurs préoccupations car 80 % des émissions de la filière proviennent des élevages.
Quel que soit le secteur, la pression sur les entreprises s’accentue d’année en année et les oblige aujourd’hui à se tourner vers leurs fournisseurs.Depuis plusieurs années, celles de plus de 500 salariés doivent en effet publier un rapport qui présente, entre autres, l’incidence de leurs activités sur l’environnement et les mesures prises pour l’atténuer. Ce que l’on appelle désormais communément la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise). Les enseignes de distribution et de restauration, les groupes agroalimentaires ou encore les banques doivent publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) qui intègre leur empreinte carbone. Pour cela, elles calculent les émissions générées par leurs activités et leurs consommations énergétiques (périmètres 1 et 2 ou scopes en anglais).
Elles évaluent également les émissions de leurs aval et amont. Dit autrement, la réglementation oblige les opérateurs à créer un cercle vertueux en intégrant leurs fournisseurs dans leurs efforts.
Un nouveau sigle dans le jargon laitier : le CSRD
Sous l’impulsion de l’Union européenne, les démarches RSE vont prendre de l’ampleur. Un nouveau sigle entre dans le vocabulaire des entreprises : CSRD, pour Corporate Sustainibilty Reporting Directive. Selon leur catégorie, à partir de 2025,elles seront obligées de publier un rapport de durabilité sur l’environnement, le social et leur gouvernance. Pour Lactalis et Sodiaal, ce sera en 2026. « Le CSRD comporte beaucoup plus d’indicateurs que le DPEF, indique éric Piou, commissaire aux comptes de la coopérative d’Isigny Sainte-Mère. Ce sont entre autres plus de 1 000 données à fournir. » « L’Europe n’est pas seule à exiger des moyens et des résultats de durabilité, rassure Laetitia Albertini, de H&H Group, partenaire chinois de la coopérative. La Chine et les États-Unis l’exigent aussi. »
La certification SBTi donne le « la »
La certification internationale Science-based Target Initiative (SBTi) est l’outil sur lequel s’appuient les grands groupes pour montrer patte blanche auprès de leurs clients et de leurs financeurs. Elle reprend l’ambition de la COP 21 de Paris de neutralité carbone en 2050. Or, en 2022, SBTi a actualisé la définition de la décarbonation du scope 3. Elle demande désormais aux entreprises d’intégrer l’agriculture dans leur plan (dit « scope 3 Flag » [Forest, Land and Agriculture]). De plus, jusque-là sa méthodologie autorisait la comptabilisation des crédits carbone qui compensent une activité polluante... tout en continuant à polluer. Elle l’interdit aujourd’hui et accepte les seuls crédits carbone de contribution à des projets. « Nos clients nous questionnent sur la façon dont ils peuvent baisser leur scope 3 Flag », confie un industriel.
Convaincre les producteurs
Pour les industriels laitiers et la filière, l’enjeu est d’embarquer l’amont. Il reste du chemin à faire. L’ambition de l’interprofession d’une baisse de 17 % entre 2016 et 2025 ne sera très probablement pas atteinte. Elle se décompose en - 20 % pour les producteurs et - 25 % pour les laiteries. De plus, à peine la moitié des producteurs ont réalisé un diagnostic CAP’2ER de niveau 1 ou 2. Conçu par l’Institut de l’élevage, le premier prend une photo à l’instant T des émissions ; le second établit un plan d’actions. « À nous de montrer à ceux qui ne sont pas encore engagés l’intérêt des diagnostics en chiffrant davantage les économies réalisées par les actions qui seront identifiées », estime Jennifer Huet, directrice environnement du Cniel. Un exercice qui ne sera pas forcément facile. Les manifestations de janvier et février contre les contraintes réglementaires ont laissé des traces. Et, si les producteurs entrent dans la démarche, ce ne sera pas pour une centaine d’euros annuels symbolique.
Primes : un curseur à 5 €/1 000 l au maximum
Les coopératives ouvrent la voie. Elles lancent ou réfléchissent à des grilles de primes relatives à des niveaux d’émissions, et non à des plans d’actions de baisse. Elles placent aujourd’hui le curseur autour des 5 €/1 000 l. L’objectif est double : rétribuer les efforts déjà faits et encourager à la décarbonation. Leur dispositif est basé sur le volontariat. Dans le tour de France non exhaustif que L’Éleveur laitier a réalisé, Laïta a enclenché le mouvement. Les trois coopératives partenaires Terrena, Even et Eureden versent un maximum de 4,5 €/1 000 l (CAP’2ER niveau 2 avec d’autres actions). « L’impulsion est bonne, se réjouit Christophe Miault, président de la branche lait de Terrena. La moitié de ses 500 adhérents en bénéficient. »
Sodiaal : 10 M€ sur la table
En avril, Sodiaal luia emboîté le pas en inaugurant sa grille de durabilité. Son dispositif de diagnostics est plus simple : l’autodiagnostic SelfCO2 en ligne sur le compte extranet des producteurs. « Il équivaut à un CAP’2ER niveau 1. Sa mise à jour annuelle donne lieu à une prime de 100 €, indique Florence Monot, directrice de la collecte de Sodiaal. Il est complété de plusieurs critères demandés aux producteurs. » Les deux tiers des 9 000 adhérents qui l’ont réalisé ont accès à un potentiel de 5 €/1 000 l : 2 € sur des critères de biodiversité (haies, prairies) et 3 € sur l’empreinte carbone (si elle est inférieure à 0,75 kg/l de CO2, sinon 2 € sous 0,85 kg et 1 € sous 1 kg). Le tiers restant des adhérents bénéficie uniquement de la partie biodiversité. « Le budget annuel est de 10 M€ en année pleine. » Il y a deux ans, le groupe coopératif a signé un engagement avec SBTi sur une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à + 2 °C. Il vient de la revoir à +1,5 °C. « C’est beaucoup plus exigeant. Cela revient à une réduction de notre empreinte carbone de 50 % en 2030 par rapport à 2019 dont 30 % pour notre Scope 3. » Les résultats affichés sont contrôlés par le cabinet international EY.
La Prospérité Fermière : primes et crédits carbone
La Prospérité Fermière (760 producteurs) a un projet alternatif. Le programme de cinq ans qu’elle a signé avec son partenaire General Mills pour la transition de 50 exploitations illustre la route qu’elle emprunte. Il est construit avec Tereos et Unéal dont sont aussi adhérentes ces exploitations. General Mills financera la prime qu’elles recevront sur leur niveau d’émissions. La coopérative devrait en effet annoncer à la fin de l’année une grille de primes. « Nous souhaitons étendre l’initiative engagée avec General Mills à d’autres partenaires », indique Patrick Meunier, directeur du projet coopératif. L’autre voie de financement pour les adhérents est la vente de crédits carbone à titre de contribution de projet, qui est pilotée par la start-up Carbone Farmers.

Une tonne de carbone est achetée environ 30 € aujourd’hui. Le diagnostic CAP’2ER niveau 2 est le moteur du dispositif, qui engage l’adhérent pour cinq ans. « L’objectif initial était que l’ensemble des adhérents l’ait effectué fin 2025. Il sera probablement atteint en 2026 car nous manquons de conseillers pour accompagner les éleveurs. C’est ce qui nous freine. 120 sont aujourd’hui réalisés. »
Trouver le financement du surcoût
On le comprend, la Prospérité Fermière veut créer un modèle qui finance les adaptations. Le paiement de leur surcoût fait partie des enjeux de ces prochaines années. « Celui des producteurs rentre dans la matière première agricole relative à la loi égalim que nous discutons avec les enseignes de distribution, signale Florence Monot. Les 10 M€ de durabilité de Sodiaal sont une première marche auxquels s’ajoutent environ 35 M€ par an d’investissements RSE que nous incluons dans les négociations de notre matière première industrielle. »
Du côté de Lactalis, les OP s’interrogent aussi sur les variations interannuelles. « Les éleveurs subissent depuis plusieurs années des sécheresses et des inondations. Leurs achats d’aliments pour compenser les mauvaises années fourragères dégradent leur empreinte carbone. Comment ces phénomènes peuvent-ils être pris en compte ? » questionne le président de l’association d’OP Unell Yohann Serreau. Le sujet est sur la table avec le leader mondial qui, lui aussi, s’est engagé auprès de SBTi à la neutralité carbone en 2050. D’ici à 2033, cela se traduit par - 33 % des émissions de son scope 3 par rapport à 2021. En France, les CAP’2ER niveau 1 sont le levier actuellement utilisé. « Nous sommes à mi-parcours des 9 000 livreurs à auditer d’ici à fin 2025 », précise Fabien Choiseau, directeur France des approvisionnement lait.
La crainte d’un droit d’accès au marché
Même si les producteurs sont au centre du jeu, vu les bonus actuels affichés, ils ne décrochent pas le jackpot. Il ne faudrait pas que l’empreinte carbone devienne un nouveau critère d’accès au marché. La proposition d’un socle multicritère que la FNPL vient de présenter au Cniel cristallise ce risque. L’autre risque est que les données de production échappent au contrôle des éleveurs. Ils seront alors moins armés pour monnayer leurs efforts auprès des entreprises. C’est ce que pointe France OP Lait. L’OP Bel Ouest a pris les devants pour l’éviter (lire page 12). La charte de bonnes pratiques de circulation des données que le Cniel prépare devrait aider les OP. Les transformateurs craignent, eux, que les efforts entrepris leur échappent si leurs livreurs les vendent en crédits carbone de compensation, et non en contribution (rémunération des pratiques). Ils ne pourront alors plus les déduire de leur comptabilité carbone. C’est pour cette raison qu’ils regardent avec prudence France Carbon Agri, précurseur en France dans ce domaine. Ils souhaitent plus de précision s sur la destination des crédits. « L’empreinte carbone des protéines laitières doit rester compétitive et faire le poids face à la montée des protéines végétales », résume Florence Monot.


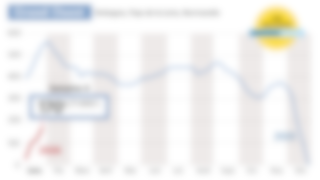


La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité