
Quatre questions à Alexis Villeneuve, référent agronomie et fertilisation de Littoral Normand
Sur quoi butent aujourd’hui les éleveurs, et plus largement les agriculteurs ?
A. V. : L’enjeu se concentre sur la réduction des herbicides. Le changement ne peut être mené que sur plusieurs années car il implique d’allonger la rotation des cultures et de modifier leur itinéraire technique en investissant dans des matériels qui nécessitent un apprentissage. La moyenne des IFT herbicides des 1 549 fermes pour lesquelles Littoral Normand effectue le registre phytosanitaire progresse en 2024. Certes, les conditions pluvieuses ont compliqué le désherbage l’an passé mais c’est une tendance plus globale, avec un salissement des parcelles qui augmente aussi. Je pense en particulier aux vulpins et ray-grass.
Les matières actives sur le marché sont de moins en moins efficaces et il y a de moins en moins de matières actives. L’annonce en mars par la Commission européenne de la suppression en 2026 du flufénacet en est la dernière illustration.Elle est la principale matière active utilisée contre les graminées automnales.
Qu’en est-il de la réduction des fongicides et des insecticides ?
A. V. : Elle est moins compliquée que celle des herbicides car elle peut s’appuyer sur la résistance génétique des variétés à des maladies et sur l’usage de produits de biocontrôle tels que le soufre. Ils ne rentrent pas dans le calcul de l’IFT des fongicides.
Quels sont les leviers pour limiter le désherbage chimique ?
A. V. : La conduite de Baptiste Lemonnier est un bon exemple de ce qui peut être mis en œuvre : alterner les cultures d’automne et de printemps, retarder les dates de semis, réaliser des faux semis quitte, s’il le faut, à utiliser un tiers de dose de glyphosate après le dernier passage d’outil, pratiquer un labour occasionnel (tous les trois à quatre ans) ou encore allonger les rotations par des prairies temporaires. Bien souvent, les éleveurs labourent systématiquement ou ne labourent pas du tout. La vérité est plutôt entre les deux. De même, je comprends qu’ils ne souhaitent pas implanter des prairies temporaires lorsque la surface de prairies permanentes est suffisante pour assurer les besoins du troupeau. Il peut alors être envisagé de semer une luzerne dont les produits de la fauche seront par exemple destinés à la vente. Les prairies temporaires sont un bon levier d’assainissement des parcelles.
Comment comptez-vous valoriser les enregistrements de registre sanitaire ?
A. V. : Nous voulons aller au-delà de l’objectif réglementaire et utiliser toutes ces données accumulées pour améliorer les pratiques. Littoral Normand et les Civam haut-normands vont déposer une demande de financement auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour finaliser un logiciel. Il pourra identifier les matières actives problématiques ou pas sur la qualité de l’eau du secteur, constituer des groupes de pratiques – par exemple, labour/non-labour – pour comparer leurs résultats, etc. Il faut mettre en œuvre des solutions dès maintenant plutôt qu’attendre d’hypothétiques nouvelles molécules.


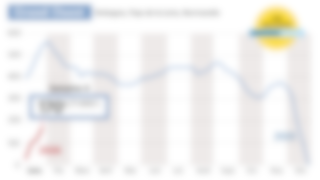


La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité