Les exploitations laitières ont-elles une autre solution que l'agrandissement pour assurer leur avenir ?
Benoît Dedieu : Votre question sous-entend que seules les grosses structures ont un avenir. Cette idée assez répandue repose sur le concept d'économies d'échelle. Les charges de structure sont diluées par plus de lait produit, avec un abaissement des coûts au litre. Ce raisonnement reproduit une logique de filière qui concentre tous les efforts sur la valorisation de ses produits. Il est cohérent pour les structures spécialisées pour lesquelles atelier lait et exploitation ne font qu'un. Leur agrandissement sera une clé d'évolution intéressante. Il sera réussi si les performances technico-économiques sont maintenues et la productivité du travail améliorée, sans excès d'heures supplémentaires et d'endettement. Seulement, ce modèle n'est pas le seul en France. Au modèle « grandes exploitations spécialisées » — à partir de 400 000 l de lait — souvent mis en avant, un certain nombre d'éleveurs préfèrent des formules plus souples.
Comment les exploitations plus petites résistent-elles à la baisse du prix du lait ?
B. D. : Ayant moins investi massivement que les grosses structures, elles sont plus robustes. Ce n'est pas la seule raison. La pluriactivité que les éleveurs développent, soit par le travail de la conjointe en dehors de la ferme, soit par plusieurs productions sur la ferme, leur sert d'amortisseur. Certains, avec une approche globale poussée, sont très réactifs. Selon le marché ou les conditions climatiques, ils développent ou diminuent la voilure de l'atelier qui leur sert de tampon face aux aléas. L'exemple le plus classique est la réduction de l'atelier taurillons en cas de pénurie fourragère. En d'autres termes, ils ne mettent pas tous leurs oeufs dans le même panier. Parmi les petites à moyennes exploitations (250 000 l et moins), celles ayant le plus souffert de la crise sont les spécialisées en lait : elles ont peu de marges de manoeuvre pour ajuster et résister.
Finalement, la réflexion sur l'avenir des exploitations porte plus sur leur résistance aux aléas que sur leur taille…
B. D. : Effectivement, sans oublier la dimension du travail. Il faut intégrer différents regards sur le travail dans le débat sur la restructuration des exploitations. Selon leur profil, la combinaison travail-marché-aléas climatiques ne donnera pas les mêmes stratégies. Il faut les accompagner en apportant des réponses spécifiques. Un éleveur à la tête d'une exploitation spécialisée, motivé pour l'agrandir, évoluera vers l'automatisation des tâches ou l'embauche d'un salarié pour améliorer la productivité du travail. Un excès d'automatisation ne risque-t-il pas de l'éloigner du travail réel avec les animaux ? Comment travailler avec un salarié qui, lui, compte ses heures ?
Déléguera-t-il des travaux à une entreprise ? À l'inverse, un éleveur attaché à sa pluriactivité, familiale ou au niveau de l'exploitation, acceptera l'agrandissement s'il ne remet pas en cause la sécurité de son système et l'articulation entre ses différentes activités. Il trouvera des réponses dans des formules simplifiées : désileuse automotrice en Cuma, valorisation de la plasticité animale par plus de pâturage, semis sans labour, monotraite dans certains cas, etc.
Le cloisonnement du conseil dans les départements n'est-il pas un frein à l'accompagnement de ces évolutions ?
B D : Des initiatives de conseils à plusieurs organismes commencent à émerger pour associer l'organisation du travail à la performance technique et économique. C'est une nouvelle facette du métier de conseil. Ces organismes ont consacré du temps à la technicité. Ils doivent se pencher dorénavant sur l'amélioration des conditions de travail et de la vie sociale et familiale des producteurs. Sans recette toute faite. L'exploration de voies très diversifiées permettra à la filière de mieux résister en cas de crise.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE HUE
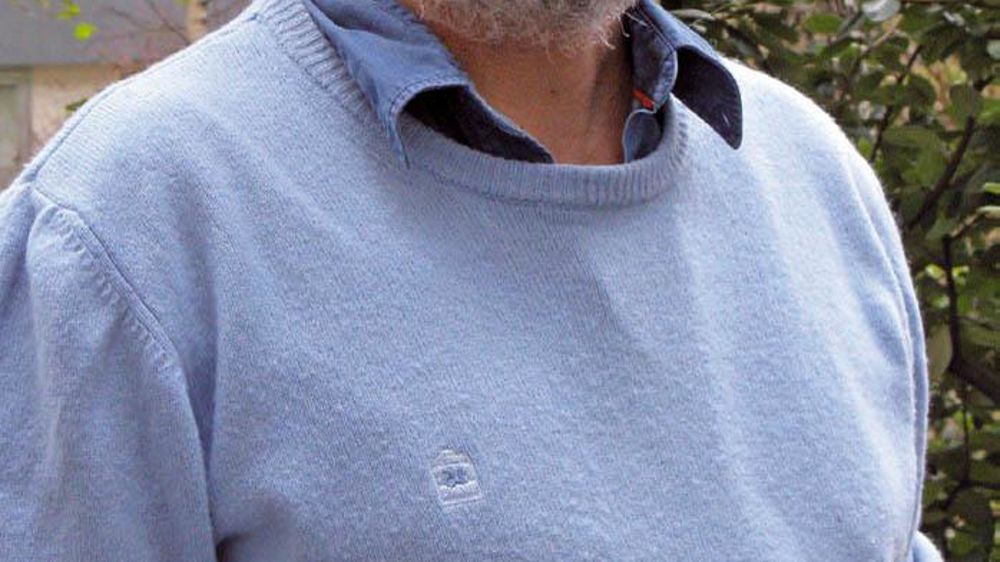
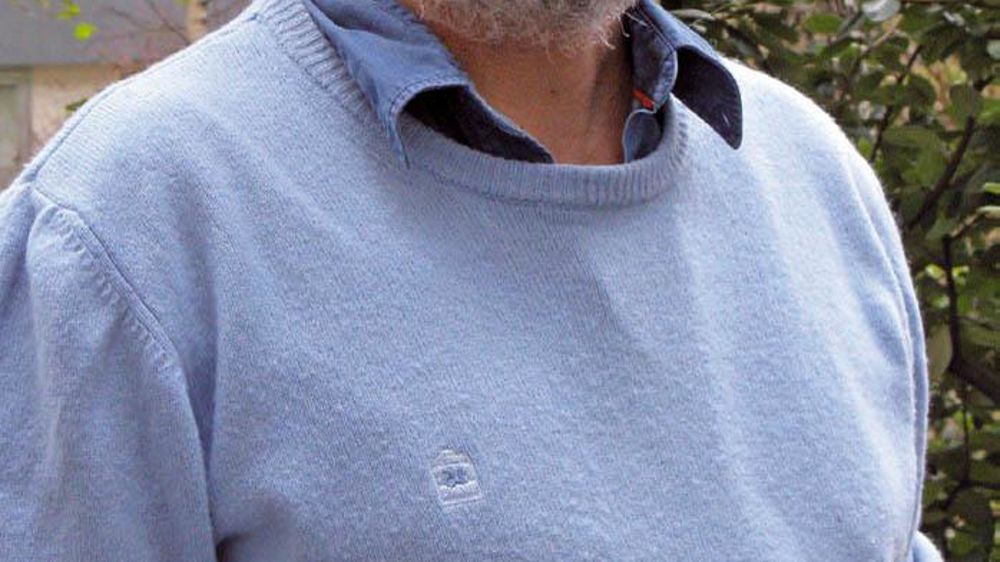
Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
Le bale grazing à l’essai
Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État
Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »
Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité
Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs