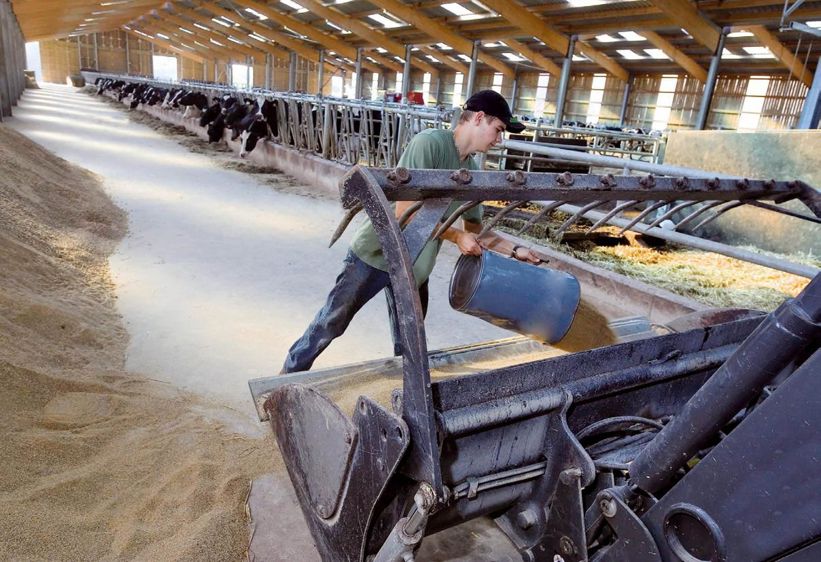
Le coût alimentaire c'est 50 % du coût de revient d'un litre de lait et les trois quarts des charges opérationnelles. Trois nutritionnistes nous présentent leurs plans d'action. Certains sont iconoclastes, parfois divergents, mais tous militent pour un fonctionnement optimum du rumen.
« Un état d'acidose subclinique, c'est 10 % de digestibilité en moins de la ration, soit un surcoût colossal qui ne se repère pas à l'oeil ». 1 FOURRAGES VALORISER CEUX DE L'EXPLOITATION
Le niveau de matière sèche de l'ensilage de maïs ainsi que l'éclatement des grains sont des facteurs essentiels. L'idéal est de viser 35 % de matière sèche. Cette année, du fait du manque d'eau, nous trouvons des maïs qui ont séché sur pied avec des grains laiteux. Le supplément de correction de ces maïs équivaut à 400 kg de blé et 100 kg de soja sur une lactation, soit un coût alimentaire augmenté de 8 €/1 000 l. Même constat avec un maïs à 30 % de MS dont la valeur d'encombrement est supérieure (1,03 UEL) à un maïs à 35 % de MS (0,96 UEL). Il faudra 1,5 kg de blé par jour pour compenser le déficit d'ingestion.
Pour les mêmes raisons, la conservation du silo doit être parfaite et c'est parfois le maillon faible. Un repère : un tracteur de 8 tonnes ne peut tasser correctement que 40 à 50 tonnes d'ensilage brut par heure. Enfin, la longueur de coupe (12 à 18 mm) est à adapter aux modes de reprise (fraise, type de mélangeuse) et à la quantité de concentré dans la ration. Ce qui nous emmène au second point.
2 ACIDOSE UNE MAÎTRISE PARFAITE
Un état d'acidose subclinique, c'est 10 % de digestibilité en moins de la ration, soit un surcoût colossal mais qui ne se repère pas à l'oeil nu. Cette maîtrise dépend d'un équilibre fragile entre la production d'acide dans le rumen et la sécrétion de bicarbonate liée à la rumination. Ce sont les fibres supérieures à 2 mm, flottants en surface du rumen, qui permettent cette rumination. Votre conseiller troupeau peut vous aider à évaluer l'indice de fibrosité de la ration. La production d'acide dépend aussi du rapport entre cellulose brute (ou NDF) et niveau d'amidon et de sucres. Le repère est de se situer entre 25 et 30 % d'amidon total (dont 20 % de ruminal). L'efficacité alimentaire de la ration s'évalue par le rapport litre de lait produit/kg de MS ingérée. Au contrôle laitier, nous avons des grilles de cohérence. Exemple : entre 100 et 200 jours de lactation, un troupeau à 8 000 kg doit se situer entre 1,3 et 1,4 kg de lait/kg de MS ingérée. La maîtrise de l'acidose, c'est aussi répartir la consommation des concentrés dans la journée (places et accès à l'auge), et une bonne préparation des vaches taries. Si les papilles du rumen ne sont pas assez développées, l'absorption des acides issus de la digestion sera incomplète et ils s'accumuleront dans le rumen.
3 AZOTE QUELLE VALORISATION ?
Le rapport entre les kilos de MAT exportés par jour dans le lait (TA x lait produit) et les kilos de MAT ingérés est un critère technico-économique majeur, vu le prix des compléments protéiques. Le rendement des vaches laitières pour transformer l'azote est faible mais il devrait se situer, au minimum, entre 25 et 30 %. Les facteurs de variation de cette efficacité de l'azote dans la ration sont nombreux : le rapport PDIE/UFL est-il optimum ? L'apport d'azote soluble est-il suffisant ? Pour une ration à base d'ensilage-maïs et de foin, le type de complémentation azoté est un enjeu majeur en terme de coût. Exemple : une ration à 8 500 kg de lait complémentée avec 3 kg de tourteau de colza et 1 kg de tourteau de soja tanné, coûte 70 €/1 000 l. La même, complémentée avec 4,5 kg de soja, est à 76 €/1 000 l. Les rations semi-complètes, associées à une VL 3 l au Dac, sont aussi plus onéreuses (+15 €/ 1 000 l par rapport à une ration à base de colza). En effet, le rythme de 1 kg pour 3 l de lait supplémentaires est faux, car une vache qui produit plus augmente d'abord son ingestion de fourrage. Les éleveurs qui possèdent un Dac ont donc intérêt à l'utiliser pour distribuer une partie du correcteur azoté (tanné ou non) et de l'énergie si besoin. J'attire aussi l'attention sur certains aliments du commerce associant à un tourteau tanné de l'azote non protéique (de type urée, vinasse, etc.) en remplacement des tourteaux classiques.
La valeur alimentaire affichée est correcte, mais la valorisation dans le rumen n'est pas celle qu'on attend. La règle est que le correcteur de base doit être du tourteau non tanné et, actuellement, le colza est imbattable au niveau du prix. Les tourteaux tannés n'interviennent qu'en complément pour un objectif de production plus élevé.
4 ADDITIFS LA MAIN LÉGÈRE
Ajouter de la mélasse à 210 €/t, c'est un coût de 6 à 7 €/1 000 l supplémentaires. D'où l'importance d'évaluer le besoin, ou pas, de sucres solubles dans la ration. Avec un maïs sec, cela peut être nécessaire mais le blé, moins onéreux et plus riche en UFL, apporte aussi de l'amidon qui est rapidement dégradé dans le rumen. Son effet appétent joue sur de mauvais fourrages (paille, foin) mais pas avec du maïs. Le bicarbonate est souvent utilisé systématiquement en ration maïs plat unique. Il serait plus judicieux d'évaluer avant le risque acidogène. Il doit être utilisé lors des transitions alimentaires. De la même façon, l'apport de paille ou de tout autre correcteur de structure n'est nécessaire que si l'indice de fibrosité et le niveau de cellulose brute/NDF par rapport à l'amidon le commandent. 800 g de paille à 1,16 d'UEL, c'est 1,2 kg d'ensilage consommé en moins. Il faudra 1,5 à 2 kg de concentrés en plus pour compenser.
5 PRODUCTION LA RÉDUIRE À VOLONTÉ
Les prêts de quotas seront limités pour cette campagne. S'il faut réduire le niveau de production, faites-le sans gâcher la ration, c'est-à-dire en réduisant l'ingestibilité tout en conservant un rapport énergie/ azote optimum. L'erreur est de freiner uniquement sur le correcteur azoté. Si, en croisière, le rapport PDIE/UFL est de 100, je me place à 95 pour freiner la production tout en valorisant bien la ration. Il faut garder ce rapport mais rendre la ration moins ingestible en incorporant des fourrages plus encombrants : foin ou autre.
« Je suis effaré de voir des éleveurs qui continuent à semer du maïs avec un potentiel de rendement qui oscille entre 6 et 10 t de MS/ha ». 1 MAÏS LE DIMINUER VOIRE LE SUPPRIMER
Dans de nombreuses exploitations, la production fourragère n'est pas adaptée au prix du lait que nous connaissons aujourd'hui en terme de coût. Il faut remettre en cause le modèle dominant, à commencer par le maïs-ensilage. Je suis effaré de voir des éleveurs qui continuent à semer du maïs avec un potentiel de rendement entre 6 et 10 t de MS/ha. On nourrit des vaches avec du maïs-ensilage, en espérant cette fameuse valeur énergétique à 0,92-0,95 UFL si propice à faire du lait. Mais c'est un fourrage qui coûte cher et dont la qualité est dépendante du climat. Et que deviennent les 0,95 UFL quand les grains du maïs se retrouvent dans les bouses. Même en zones favorables à sa culture, le maïs n'est pas la panacée. Démonstration. Un maïs à 0,94 UFL se compose ainsi : l'épi (50 % de la plante) est à 1,27 UFL/kg de MS et apporte 0,63 UFL ; la partie supérieure à l'épi (40 % de la tige) est à 0,80 UFL et apporte 0,16 UFL, la partie inférieure (60 % de la tige) est à 0,5 UFL et apporte 0,15 UFL. En outre, cette partie basse de la tige, très lignifiée, produit de l'encombrement et consomme beaucoup d'azote soluble pour être dégradée. Pourquoi ne pas s'en passer ? Dans les régions favorables au maïs, je n'utiliserais que sa partie noble : le grain, de préférence en ensilage grain humide ou en ensilage épi. Ensuite, je nourrirais mes vaches avec une base de fourrage riche en cellulose digestible. La vache est un ruminant fait pour consommer des fourrages, et non de l'amidon. On peut se permettre des rations moins concentrées en énergie quand celle-ci est apportée en priorité par la cellulose et les sucres du fourrage car le fonctionnement du rumen est optimisé.
2 MÉTEIL Y VENIR, OU Y REVENIR
Ce mélange de céréales et de protéagineux, semé à l'automne, assure la couverture hivernale des sols, ne subit pas les périodes sèches et laisse une excellente structure du sol avec de l'azote résiduel pour la culture suivante, le tout pour un minimum d'intrants et de travail du sol. Ce méteil peut être un excellent fourrage à condition de l'ensiler tôt, au stade floraison et non pas à 35 % de MS au stade pâteux du grain quand les tiges ne valent guère plus que de la paille. Un éleveur de la Sarthe a récolté cette année, le 9 mai, un mélange de triticale, avoine, pois, vesce et féverole pour 0,82 UFL, 114 PDIN, 91 PDIE. Pourquoi se passer d'un tel fourrage qui rapporte entre 10 et 14 t de MS/ha au lieu des bas de tige du maïs à 0,5 UFL ? En outre, c'est un excellent précédent pour un RGI/trèfle incarnat, qui assurera deux ou trois coupes jusqu'à l'automne, ou un sorgho sucrier. Une association luzerne-dactyle fournira aussi un excellent fourrage riche en protéine et dense en énergie. Ensuite, le maïs se résumera aux besoins de la complémentation énergétique, de préférence en grain humide. C'est donc une modification radicale des assolements qu'il faut envisager dans une logique d'économie d'intrants, et pour une production de fibres digestibles qui optimiseront le rendement du rumen.
3 SOJA S'EN PASSER
On peut se passer de tourteau de soja. Le tourteau de colza est aujourd'hui disponible à un prix imbattable. L'un de mes éleveurs a même trouvé du tourteau de tournesol à 130 €/t. Pourquoi s'en priver ?
Mon objectif de ration se résume à des fourrages de qualité équilibrés en énergie et azote, du maïs-grain et 150 g de minéral. J'admettrais au maximum 1 kg de soja dans le cas où il faut doper un peu le niveau en azote. Et pour m'assurer que tout fonctionne, je regarde l'état corporel des animaux, le TP et les performances de reproduction. Les concentrés dits à haute valeur énergétique, à base d'huile de palme, distribués parfois en début de lactation, me sortent par les yeux. Un ruminant est-il fait pour consommer de l'huile de palme ? Cela n'aboutit qu'à des dépôts de graisse qui faussent l'état corporel en dégradant le fonctionnement du rumen et du foie.
4 GÉNISSES PAS D'ENSILAGE-MAÏS
Distribuer de l'ensilage-maïs à des génisses est une hérésie totale. Ces animaux doivent être conduits avec un ensilage de méteil ou de sorgho, du foin et un concentré azoté à base de tourteau de colza.
Il y a aussi beaucoup à gagner sur l'alimentation des veaux de la naissance à six mois en fabriquant son propre aliment plutôt qu'en achetant un produit floconné à 450 €/t.
Tous ceux qui possèdent une mélangeuse peuvent fabriquer une ration sèche de qualité à base de foin (de prairie, de luzerne), de céréales (blé, orge, maïs), de tourteau de colza et d'un liant type mélasse qui amènera le jeune veau à un poids de 200 à 210 kg à six mois.
« Ce qui coûte cher, c'est ce qui ne marche pas ». 1 NUTRITION RESPECTER LES FONDAMENTAUX
Si les économies réalisées sur la ration pénalisent à terme la santé du troupeau, les pertes dépasseront les gains. Or, une vache en bonne santé est d'abord une vache dont la panse fonctionne bien. Le rumen a besoin de fibres, qui ont une action mécanique, et sa flore a besoin de protéines. La teneur en protéines brutes de la ration doit atteindre 17 %. En dessous de 16 %, on ne valorise plus l'énergie de la ration. L'excès d'amidon pénalise la digestion de la cellulose et provoque l'acidose. Il ne doit jamais y avoir plus de 25 % d'amidon dans le régime. La volonté de valoriser ses propres céréales ne peut pas tout justifier ! 1kg de céréales en plus, c'est en moyenne 3 % d'amidon supplémentaire dans la ration. Par ailleurs, la flore du rumen supporte mal les changements. Les transitions alimentaires sont indispensables.
Enfin, les bovins ont un système immunitaire peu performant. Ces défenses naturelles sont encore affaiblies en cas de déséquilibre alimentaire. Les conséquences ne sont pas forcément visibles tout de suite, mais elles finissent par se manifester (mammites et cellules leucocytaires notamment).
2 PRODUCTION FAVORISER LES VACHES EN DÉBUT DE LACTATION
En réduisant la complémentation des animaux, on diminue le niveau de production. Quand les vaches en début de lactation sont concernées, le pic de lactation est pénalisé et on ne rattrape pas ensuite. Or, la production du quota est une nécessité économique. 1 kg de lait perdu au pic, c'est 200 kg en moins sur la lactation. A 5 kg de moins, on perd 1 000 l.
3 COLZA OBSERVER LA DIGESTIBILITÉ
Remplacer le tourteau de soja par le colza est une option tentante, compte tenu du différentiel de prix. Mais attention, la qualité des protéines n'est pas la même. Le colza apporte davantage d'azote soluble. Pour ne pas pénaliser la digestibilité, et tout particulièrement en début de lactation, la substitution ne peut pas être totale. Il faut garder environ 70 % de soja pour 30 % de colza dans une ration à base de maïs. Si, comme le préconise Philippe Brunschwig, de l'Institut de l'élevage, on peut remplacer 3 kg de soja par 4,5 kg de colza, c'est que les PDIA ne veulent plus rien dire(1)... En fin de lactation, on peut donner proportionnellement plus de colza. Attention aux rations qui contiennent de l'ensilage d'herbe et de la luzerne, deux fourrages plus riches que le maïs en azote soluble. Le niveau de substitution doit être de 1,5 kg de colza pour 1 kg de soja. Ainsi, on apporte autant de PDIN. Si on descend à 1,3 kg de colza, on fournit assez de MAT, mais on est trop juste en protéines digestibles.
4 URÉE PAS PLUS DE 100 G/VACHE/JOUR
La teneur en MAT des maïs fourrages tend à baisser depuis de nombreuses années en raison de la sélection variétale et de la fertilisation. Lorsqu'elle descend bien en dessous de 7,5 %, on compense avec de l'urée ou du tourteau de soja. L'urée coûte moins cher et les fabricants d'aliment peuvent avoir tendance à en rajouter. Il est essentiel de vérifier la teneur réelle sur l'étiquette. La ration ne devrait pas dépasser 100 g d'urée/VL/j et 3 % dans un correcteur, c'est 30 g/kg !
PROPOS RECUEILLIS PAR DOMINIQUE GRÉMY ET PASCALE LE CANN
(1) L'Éleveur laitier n° 173, octobre 2009, page 42.
Yann Martinot, DIRECTEUR TECHNIQUE DU CONTRÔLE LAITIER DE L'ORNE
Michel Lepertel, NUTRITIONNISTE INDÉPENDANT (FRANCE, EUROPE DE L'EST)
René Hinault NUTRITIONNISTE INDÉPENDANT




Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité
Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026