
Alors que le loup fait de plus en plus de victimes bovines, les moyens de protection manquent. Des éleveurs et partenaires du monde agricole testent des dispositifs et tentent de mieux comprendre l’espèce.
L’une des deux génisses était encore chaude quand Guy Scalabrino les a retrouvées mortes au champ à 300 m du village, un matin d’octobre 2022. Lors du constat, les louvetiers ont reconnu la responsabilité du loup qui, cette année-là, commençait à faire trembler les éleveurs bovins du Doubs. « Il mord les bovins aux cuisses pour sectionner les tendons et les faire tomber, puis les dévore vivants : c’est cela le plus insupportable », lâche l’éleveur encore choqué. Le reste du lot, une douzaine de jeunes montbéliardes de 1 an, était calme : les prédateurs avaient opéré à l’écart. Une autorisation de tirs de défense a été accordée. « Les louvetiers sont restés une semaine, reprend l’éleveur. Ils ont vu trois loups, sans avoir le droit de tirer car les loups n’étaient pas dans ma parcelle mais juste derrière la clôture… Le tir de défense n’est pas adapté aux élevages ayant de petits lots dans de petites parcelles. » Ce producteur de lait à comté a finalement rentré ses jeunes malgré le beau temps, ne laissant que les adultes dehors.
En novembre 2023, les loups ont de nouveau attaqué ses génisses, près du village. Ce n’est pas que le loup rôde près des humains mais, « quand une bête se sent attaquée, elle vient chercher refuge près des maisons et le loup la poursuit jusque-là », observe l’éleveur. Sur plus de vingt bovins tués dans le Doubs cette année, ce sont les jeunes de 8 à 15 mois qui étaient les plus visés.
Que les bêtes soient écornées ou non n’y change rien. « Le loup s’adapte : au lieu de sauter à la gorge des bovins, il les épuise et les attaque par l’arrière », souligne Amandine Vial, en Isère, qui fait vêler à l’intérieur toute l’année par peur du loup. Et, même quand ce dernier rate son coup, il peut y avoir des conséquences. « Il y a quatre ans, mes vaches affolées se sont enfuies et ont provoqué un accident de moto », se souvient-elle. Dans un cas similaire, en Savoie, Cédric Laboret et ses associés ont eu besoin des voisins pour récupérer des génisses après une semaine de divagation. « Nous sommes pâturants et ne voulons pas rentrer nos animaux, insiste-t-il. Ce serait contraire aux cahiers des charges AOP. Mais même des visites quotidiennes à nos animaux n’empêchent pas les loups de les approcher en notre absence. » Il a équipé ses génisses de colliers anti-loup depuis deux ans. « Si elles s’affolent, le collier émet des ultrasons pour désorienter les loups, explique-t-il. Aucune bête équipée n’a été attaquée, mais cela ne prouve rien car il n’y a pas eu de prédation dans le secteur. » Les chiens de protection ne sont pas une option : « Les ressources en eau et fourrages sont telles qu’on ne peut pas rassembler tous nos animaux en un lieu, expose-t-il. Pour nos dix lots, il faudrait au moins vingt patous ! Il y a déjà assez de problèmes avec les chiens des troupeaux ovins. »
Contraintes de travail supplémentaires
Dans le cadre de tests pilotés par l’Agence régionale de biodiversité, Guy Scalabrino, dans le Doubs, a aussi équipé des génisses de colliers. D’autres éleveurs ont introduit des ânes dans les lots de jeunes, ou installé des boîtiers sonores simulant une présence humaine. Même s’il n’y a pas eu de prédation sur ces lots tests, il est trop tôt pour tirer des conclusions. « En revanche, les phéromones ne fonctionnent pas. Des pièges photos ont montré que les loups passaient régulièrement près des diffuseurs », affirme l’éleveur.

Lui a aussi construit un parc de nuit de 40 ares pour les jeunes de 8 à14 mois. Il comporte cinq fils d’acier électrifiés écartés de 20 cm, sur 1,30 m de hauteur. « Mais un matin, j’ai retrouvé mes génisses dehors : elles avaient défoncé les fils, témoigne-t-il. Ce n’est pas forcément un loup qui les a fait paniquer. Mais cela prouve qu’un loup peut les pousser à défoncer les fils afin de les attaquer au-dehors ! » Le parc, en plus, est plein d’inconvénients. Les bêtes doivent rentrer chaque soir et sortir chaque matin pour pâturer. Et, quand il fait chaud, elles mangent peu le jour, retrouvant l’appétit à l’heure de rentrer au parc : il faut alors les complémenter.
Ce sont ces contraintes que l’éleveur a expliquées à trente bénévoles de l’association Férus, venus se former une journée sur sa ferme.
L’association qui prône la cohabitation loup-élevage déploie depuis vingt ans dans les Alpes le programme Pastoraloup pour l’élevage ovin. Elle a lancé en 2023 un programme dans le Jura pour l’élevage bovin. Le principe est identique : des bénévoles assurent la surveillance nocturne du troupeau chez les éleveurs volontaires. Ce coup de main peut durer deux nuits ou plusieurs semaines, selon le souhait de l’éleveur et la disponibilité des bénévoles. Ces derniers, souvent habitants du territoire, gèrent leur nourriture et leur hébergement (tente, bivouac). « C’est gratuit : on ne demande rien aux éleveurs, souligne Natacha Bigan, responsable du programme. On leur garantit l’anonymat et eux ne dévoilent pas le nom des bénévoles qui viennent chez eux. » Pourquoi ce secret ? « Les éleveurs sont souvent réticents à l’idée de travailler avec une ONG naturaliste, de peur de passer pour des traîtres, constate-t-elle. Ils craignent aussi que les bénévoles fassent du prosélytisme pour le loup, alors qu’on ne vient pas juger ni convaincre, mais chercher ensemble des solutions. » Malgré la rudesse de la tâche, les bénévoles se bousculent : « L’an dernier nous ne pouvions en former que soixante, cette année nous doublerons leur nombre, reprend Natacha Bigan. Les éleveurs ou bergers partenaires étaient sept. »
Des bénévoles pour veiller la nuit
Guillaume ne regrette pas d’avoir fait appel à eux. Employé par cinq éleveurs suisses pour garder 130 veaux et génisses en alpage, près d’une zone de présence permanente du loup, il n’était pas serein. « De mi-août à début octobre, des bénévoles se sont relayés en binôme, témoigne-t-il. Ils étaient autonomes en couchage et nourriture et équipés d’une caméra thermique et d’une lampe torche. Toute la nuit, l’un au moins restait éveillé. À deux reprises, ils ont mis en fuite un loup. » Des clichés ont prouvé que leur présence n’avait pas été superflue. Mais cette solution est aussi efficace qu’énergivore. « Les bénévoles sont motivés, mais en fin de saison je sentais de l’essoufflement », témoigne Guillaume. Et la surveillance est ardue en raison des bois et du relief accidenté, lesquels compliquent aussi la mise en œuvre des tirs de défense.

Attaquer la proie la plus facile
« Il n’y a aucune solution simple et généralisable en élevage bovin, admet Nicolas Jean, à la direction des grands prédateurs de l’Office français de la biodiversité (OFB). On doit gérer les situations au cas par cas en répondant à la détresse que le loup suscite, qui ne doit pas être négligée. En cela les tirs ont une utilité, pour régler localement une situation de crise. En dehors de l’urgence, la mise en place d’une protection vise à inciter le prédateur à s’attaquer aux proies sauvages en rendant le bétail moins accessible, car le loup est un opportuniste qui choisit ses proies en évaluant le rapport bénéfices/risques. Cependant, sa capacité d’apprentissage lui permet de tirer parti des failles dans la protection. »
En colonisant des zones où les bovins étaient plus nombreux que les ovins et moins protégés, le loup s’est logiquement mis à les attaquer. « Cependant, il continue à poursuivre des proies sauvages, souligne Jean-Marc Landry, biologiste et éthologue travaillant en Suisse et en France sur le loup en milieu pastoral. Le comportement de l’espèce n’a pas changé. Il va au plus facile : brebis plutôt que bovins, veaux plutôt que génisses de 2 ans… Mais on ne connaît pas encore tous les déterminants des attaques. En Suisse, on avait d’abord observé que seules les meutes d’au moins quatre adultes attaquaient les gros animaux. Ensuite, on a vu un couple le faire, puis un loup solitaire. Donc la taille de la meute joue moins que l’espèce de loup. Mais le type d’élevage compte beaucoup. On a peu de dégâts sur les troupeaux de vaches allaitantes adultes et on a l’impression – à confirmer – que certaines races rustiques se débrouillent mieux. À l’inverse, l’allotement par catégorie d’âges rend les jeunes très vulnérables, car ils n’ont pas d’instinct anti-prédateur. Des éleveurs ont eu de bons résultats en introduisant des vaches adultes et leurs petits dans des lots de génisses, pour rebâtir une structure sociale. »
Utiliser les capacités d’apprentissage du loup
Selon le chercheur, la capacité d’apprentissage du loup peut-être retournée contre lui. « Il s’habitue aux nouveautés qui n’ont pas de conséquences. Mais un tir d’effarouchement traumatique peut le conditionner à avoir peur d’approcher un troupeau. Et les premiers tests laissent penser que l’animal traumatisé peut inculquer cette peur aux louveteaux. Tandis que si le loup est tué, il ne peut pas apprendre aux autres à avoir peur. » Il faut néanmoins que l’effet traumatique soit suffisant, ce que Nicolas Jean, de l’OFB, juge difficile. Ces deux spécialistes sont prudents sur la question des tirs létaux.
Zéro prédation, un objectif impossible
Les statistiques ne plaident pas pour une régulation préventive de l’espèce puisque le nombre « officiel » de loups, passé de 430 à 1 140 en cinq ans, est décorrélé du nombre de dégâts sur le bétail, passé de 11 080 à 12 500 victimes. Quant aux tirs de défense, utiles voire nécessaires dans l’urgence, ils n’auraient pas toujours l’effet escompté à long terme. « Les dégâts peuvent reprendre, voire augmenter, là où des loups ont été tués, observe Jean-Marc Landry. Si on élimine un mâle reproducteur qui cause peu de dégâts, on risque de le voir remplacé par un autre mâle qui, lui, s’en prendra au bétail et apprendra aux jeunes à faire de même. Le tir létal aurait un réel intérêt si on arrivait à identifier les individus au comportement problématique. En attendant, il est utile pour donner quelques semaines de répit à l’éleveur afin de mettre en place une protection. » Il est vrai que celle-ci n’empêchera pas forcément les attaques : « Elle abaisse la vulnérabilité sans éliminer totalement le risque, un peu comme pour un aléa naturel, avance le biologiste. On n’aura jamais zéro prédation. Reste à savoir le seuil acceptable. Dans le Jura vaudois, la prédation est responsable de 3 % des morts en estivage, d’après l’organisme officiel Identitas. Les 97 % de morts de maladies, blessures ou accidents sont mieux acceptées. »



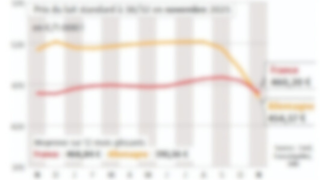
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard