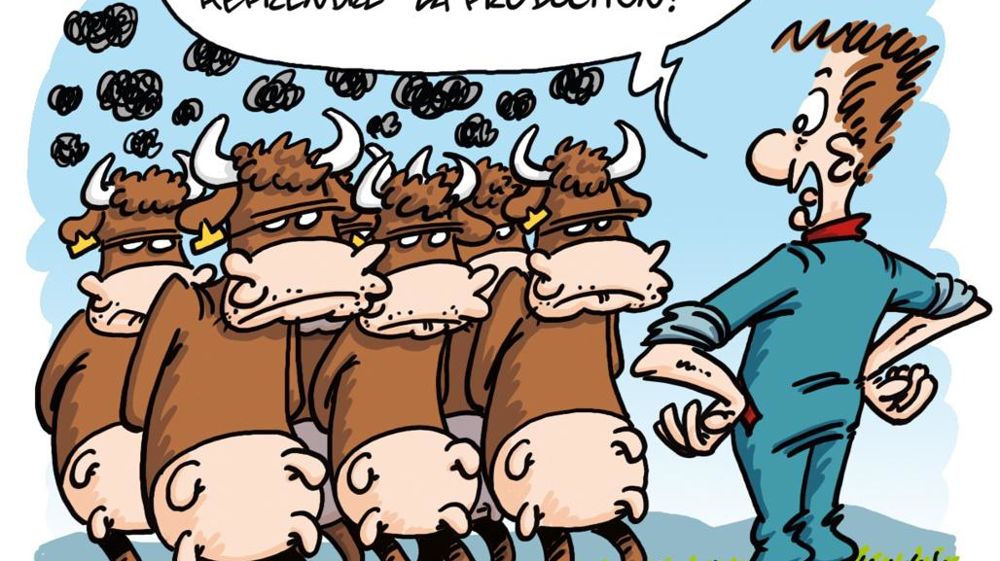
La traite robotisée laisse espérer une réduction jusqu'à la moitié du temps d'astreinte. L'organisation du bâtiment est l'une des clés du succès.
LOGIQUEMENT, ON PENSE QUE LA TRAITE ROBOTISÉE LIBÈRE DU TEMPS. « C'est globalement vrai, mais il faut l'évaluer avant de décider l'investissement, nuance Stanislas Desvois, le Monsieur robot de Littoral Normand. La personne qui consacre seule une heure à la traite le matin et le soir aura, grosso modo, le même temps d'astreinte en traite robotisée. En revanche, elle gagnera en souplesse de travail, surtout en deuxième partie de journée, et en confort. » Pour lui, dès deux heures de traite matin et soir, on est gagnant. « Il faut comptabiliser toutes les heures. Si deux personnes traient ensemble deux heures matin et soir, on totalisera huit heures. »
Dans le cadre du service Project robot de Littoral Normand Conseil Élevage, c'est ce qu'il fait. Avec les éleveurs, il simule une journée de travail avec salle de traite et une journée avec robot en rythme de croisière. Le volume d'heures est ensuite comparé.
DEUX HEURES ET DEMIE À TROIS HEURES D'ASTREINTE JOURNALIÈRE
« Il n'existe pas de références de travail bien établies sur la traite robotisée mais à partir de nos échanges avec les adhérents équipés, nous estimons que, selon la taille du troupeau, l'astreinte est de deux heures et demie à trois heures. » Il découpe la journée en trois temps.
Le matin : une heure à une heure et demie. L'éleveur ou l'éleveuse démarre par la consultation de l'ordinateur pour le repérage des vaches en retard, les alarmes mammite et chaleur, le taux de fréquentation du robot, etc. Il faut ensuite aller chercher les vaches en retard, laver le ou les robots, observer et soigner celles identifiées « mammiteuses », détecter les boiteries. « Pour ne pas perdre de temps, cette observation se fait en général en même temps que le nettoyage des logettes », témoigne Franck Heslouis, éleveur avec deux stalles GEA (voir p. 42-43).
« On conseille d'observer deux cycles de traite complets successifs pour vérifier le fonctionnement du robot (lavages, désinfection, trempages, etc.) », ajoute le conseiller.
En milieu de journée : vingt à trente minutes pour s'assurer que tout va bien, gérer les vaches en retard et faire d'éventuelles mises à jour si elles ne sont pas faites à distance (vaches vêlées, délais d'attente liés à l'usage de médicaments vétérinaires, etc.).
Le soir : une petite heure. Ce troisième passage, souvent vers 18 heures, permet une dernière vérification. « Elle se fera d'autant plus aisément que l'on peut accéder au bureau, au robot et aux box d'isolement en chaussures "de ville".»
NE PAS PERDRE LE TEMPS GAGNÉ À CAUSE D'UNE INSTALLATION MAL RÉFLÉCHIE
Le gain de temps peut être vite perdu si l'implantation du robot ou les équipements qui vont avec sont mal réfléchis. « Cela peut même aboutir à un temps passé à la gestion du troupeau bien supérieur à ce qu'il était avant. » On ne s'attardera pas sur les équipements de base qui facilitent le travail : parc d'attente sur caillebotis pour simplifier le nettoyage du robot et de ses alentours, porte deux ou trois voies en sortie de traite pour diriger les vaches malades ou fraîchement vêlées vers une aire paillée ou des logettes, abreuvoirs placés aux endroits stratégiques pour encourager la circulation, etc
ÉVITER LES PIÉTINEMENTS
« La première cause de dérapage vient des boiteries », avertit-il. Outre les soins et les frais supplémentaires qu'elles occasionnent, les vaches fréquentent moins le robot et augmentent le nombre de retards qu'il faut gérer. « C'est encore plus vrai en robot saturé, c'est-à-dire avec 65 à 70 vaches par stalle. Le troupeau a sa propre dynamique, avec toujours les mêmes vaches aux mêmes horaires. La moindre perturbation amplifie les retards, avec plus de travail à la clé. » Un robot saturé libère plus de temps mais demande une plus grande régularité dans les horaires d'interventions pour conserver l'équilibre que les vaches ont trouvé entre elles. Mieux vaut donc éviter tout ce qui concourt aux piétinements, à commencer par les culs de sac en bout de couloirs. Ils encouragent la hiérarchie sociale dans le troupeau, ce qui conduit les vaches dominées à moins fréquenter logettes et robot. On peut les supprimer par un couloir transversal le long du pignon pour aller du couloir des logettes aux cornadis. Autre source de piétinements : l'aire d'attente insuffisante devant le robot, favorisant là encore les dominantes. « En circulation libre, il est conseillé de prévoir au moins 5 mètres de dégagement devant le robot, en circulation semi-forcée à forcée, l'équivalent d'une fois et demie la surface occupée par le robot. » Le tout bien éclairé par des panneaux translucides dans la toiture. « Il faut donner envie de fréquenter le robot. » De même, la circulation sera plus fluide grâce à des couloirs larges : viser 4,5 à 5 mètres pour l'alimentation et 3 mètres entre les rangées de logettes. Bâtiment bien ou mal conçu, dans tous les cas, en système robot, les vaches se déplacent plus. Leurs pattes sont plus sollicitées. Il faut l'intégrer dans son organisation du travail avec des parages plus fréquents : en début, milieu de lactation, etc.
ÉLABORER SA PROPRE GRILLE DE GESTION DES ALARMES
On le comprend : pour se préserver de dérapages et de la désorganisation corollaire, l'anticipation et une plus grande réactivité deviennent la règle d'or. Les alarmes délivrées par l'ordinateur de bord remplissent cette mission, à condition de ne pas se laisser submerger. « C'est particulièrement vrai avec les alarmes à cellules. Si elles ne sont pas suffisamment prises au sérieux, les comptages cellulaires et les mammites risquent d'augmenter. Pour l'éleveur, c'est évidemment plus de travail. Pour le robot, c'est plus de temps de tri du lait et de rinçage au détriment de la traite elle-même. S'il est saturé, cela perturbera le rythme du troupeau avec plus de retards de traite. » Il faut donc trouver le bon équilibre entre déclenchement de l'alarme et délai d'intervention. La première peut être couplée avec d'autres critères : fréquentation du robot, baisse de production, observation de l'animal, etc. « Attention à ne pas se perdre dans les multiples possibilités qu'offre le logiciel », avertit Franck Heslouis. Lui réagit à la deuxième alarme cellules, en la combinant à la chute de production.
QUATRE QUESTIONS AVANT D'INVESTIR
Gestion informatique : les éleveurs mal à l'aise avec l'informatique doivent se poser la question de leur robot-compatibilité. Habitué à son maniement, Franck Heslouis, lui, ne se l'est pas posée.
Contact animal : comment vivre le fait de ne plus toucher les vaches ?
Nouvelles responsabilités: les tâches vont être réparties différemment au sein d'un Gaec, d'un couple ou entre le salarié et l'éleveur si celui qui trayait jusque-là n'est pas robot-compatible. Cela correspondra-t-il aux objectifs de chacun ?
Objectif principal : sans doute la question fondamentale est-elle non pas celle du « pourquoi », mais du « pour quoi » : compenser le départ à la retraite de son associé mieux gérer les autres ateliers de l'exploitation, consacrer plus de temps à sa famille ?
CLAIRE HUE
Stanislas Desvois est le référent « robots » de Littoral Normand Conseil Élevage. Il est aussi membre du groupe de réflexion sur les robots de Seenergi qui rassemble quatre contrôles laitiers de l'Ouest. © CLAIRE HUE




Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Quelques recommandations pour bien loger ses veaux laitiers
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?