
L’identification des bonnes pratiques mais aussi le recensement des espèces constituent des leviers indispensables pour rendre la biodiversité concrète à l’échelle des exploitations, sensibiliser les agriculteurs et déclencher des initiatives favorables. L’EARL Les Champs de Bray a suivi cette démarche.
La biodiversité englobe un tel nombre d’espèces vivantes, visibles ou invisibles à l’œil nu, qu’il est difficile de la quantifier et de mesurer l’impact des pratiques agricoles sur sa richesse. Des initiatives s’y essaient toutefois comme le programme Reine Mathilde en Normandie. Piloté par l’Institut de l’élevage (Idele) depuis son lancement en 2010, il a été initié par la société Stonyfield France (marque Les 2 vaches, laiterie Les prés rient bio, filiale de Danone) et reste aujourd’hui financé à la fois par des fonds privés et publics (Région Normandie, Agence de l’eau Seine Normandie). De nombreux partenaires y contribuent : Idele, chambre d’agriculture, Bio en Normandie, Littoral Normand, Civam, Agronat. Son objectif est de favoriser les conversions en agriculture biologique et de les pérenniser en apportant notamment des références techniques visant à sécuriser les systèmes. « La dimension biodiversité a été intégrée en 2020, déclare Caroline Evrat-Georgel, coordinatrice du programme à l’Idele. Les partenaires ont retenu cette proposition des financeurs car nous pensons que cela a du sens pour les éleveurs. Il est important de montrer de quelle façon l’activité laitière peut préserver, voire favoriser, la biodiversité afin de revaloriser le métier de producteur et de répondre aux critiques de la société concernant l’élevage. »
Sur les deux fermes vitrines du programme Reine Mathilde dans le Calvados et en Seine-Maritime, des outils sont donc utilisés pour tenter de mesurer l’impact de l’élevage laitier sur la biodiversité. « Nous employons une double approche, explique Caroline Evrat-Georgel. D’une part, un diagnostic Biotex a été réalisé pour recenser habitats et pratiques favorables sur les fermes. D’autre part, les protocoles de l’Observatoire agricole de la biodiversité sont mis en place chaque année pour évaluer les effectifs de vers de terre, abeilles et invertébrés. Ces comptages sont une illustration concrète pour sensibiliser les agriculteurs lors des portes ouvertes. Ils montrent aussi les influences multifactorielles pesant sur les populations. »
« Le diagnostic Biotex nous a ouvert les yeux »
L’EARL Les Champs de Bray à Avesnes-en-Bray (Seine-Maritime), pilotée par Charlène et Thomas Fourdinier, est devenue ferme vitrine en 2019 et a débuté sa conversion en bio en 2020. « Nous aimons innover dans une démarche d’amélioration continue et communiquer afin d’impulser des changements à l’échelle du territoire, confie Charlène, par ailleurs vice-présidente des Civam normands. De plus, la dimension multipartenariale du programme Reine Mathilde nous plaît. Quant au choix du bio, ce n’est pas une fin en soi. Nous voulons avant tout développer un système économe, autonome et respectueux du bien-être animal. » Pour atteindre leur objectif, les éleveurs augmentent les surfaces en herbe et le pâturage. À l’issue du diagnostic CAP2’ER financé par leur laiterie Danone en 2019, ils décident de renforcer la place des haies et des arbres sur la ferme, avec l’objectif premier de créer de l’ombrage pour leur système pâturant.

« Nous avons progressivement pris conscience du rôle de ces aménagements pour la biodiversité, témoigne Charlène Fourdinier. Le diagnostic Biotex nous a aussi ouvert les yeux. Malgré les haies déjà présentes, certaines parcelles demeurent très grandes : l’une mesure 35 ha, une autre 20 ha. Il est préconisé de les découper en blocs plus petits, car en grandes cultures bio, nous avons particulièrement besoin des insectes auxiliaires hébergés dans les haies ou les bandes fleuries. »

Plus d’un kilomètre de bandes fleuries intraparcellaires de trois mètres de large a déjà été implanté et elles pourraient représenter jusqu’à cinq kilomètres afin de réduire la maille paysagère à 5 ha environ sur les surfaces en cultures. « Nous avons choisi des espèces complémentaires en matière de floraisons et de strates, précise Thomas Fourdinier. Nous voulons en faire des bandes pérennes sans aucune intervention. Mais nous avons peu de recul sur la durabilité de telles bandes et sur un éventuel effet de salissement. »
Déployer les protocoles de l’Observatoire agricole de la biodiversité
Derrière le bâtiment des laitières, une parcelle cultivée de 9 ha a été implantée en 2019 avec un mélange d’espèces (ray-grass anglais, fétuque élevée, pâturin, différents trèfles, plantain) afin de devenir une prairie permanente. Des haies intraparcellaires ont été plantées (500 mètres linéaires) pour diviser l’ensemble en cinq blocs dans lesquels différentes plantes ont été ajoutées (chicorée, luzerne, sainfoin, trèfle violet) dans le but d’améliorer la résistance à la sécheresse. « Nous avons également planté une centaine d’arbres de haut jet accompagnés d’arbres plus petits pour créer des bosquets qui généreront de l’ombrage, indique Charlène Fourdinier. Nous avons saisi des opportunités de financement par Danone, Miimosa, et le plan de relance. Ces aides à l’achat de plants sont justifiées car ces arbres sont d’utilité publique. Reste à notre charge le temps à passer pour la plantation, l’entretien. Dans notre cas, nous visons la fabrication de copeaux de bois à l’aide de matériel en Cuma pour un usage en litière. Il faut rendre les haies utiles pour éviter que les agriculteurs les voient comme une contrainte. »

Dans cette grande prairie, ainsi que dans un champ non labouré, sont déployés les protocoles de l’Observatoire agricole de la biodiversité pour compter abeilles sauvages, vers de terre et invertébrés terrestres. « Nous avons plusieurs années de résultats analysés avec ceux des autres fermes Reine Mathilde, et remontés au niveau national auprès de l’observatoire, résume Simon Godard, conseiller technique de Bio en Normandie, partenaire du programme en charge des suivis biodiversité. À l’EARL Les Champs de Bray, nous sommes plutôt dans la moyenne haute pour les abeilles et les invertébrés, en comparaison avec les statistiques nationales. En revanche, nous avons trouvé moins de vers de terre que nous l’imaginions, peut-être en raison d’une zone de tassement dans le sol où nous observons aussi un déficit de pousse d’herbe. Malgré des systèmes et des environnements similaires entre fermes, il y a des différences flagrantes dans les comptages. Cela nous questionne, nous cherchons des explications, nous essayons de comprendre. »

Pour Charlène et Thomas Fourdinier, la biodiversité est aujourd’hui comme « une petite lumière toujours allumée » dans leurs choix stratégiques. « Nous voyons la cohérence avec notre activité, ce n’est pas déconnecté, c’est même assez pertinent concernant par exemple le lien entre la vie du sol et le maintien des rendements malgré les aléas, conclut Charlène. Ça ouvre aussi des portes. C’est un sujet à partager avec les citoyens, un moyen pour eux de s’intéresser à l’agriculture. »

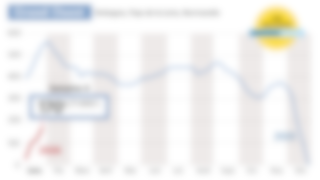


La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité
Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs