
Construit il y a vingt ans, le séchoir d’Alain Grasteau, éleveur dans la Sarthe, génère un coût alimentaire très compétitif grâce à une ration sans maïs ni concentré protéique. Un tel investissement doit être, aujourd’hui, envisagé prudemment en raison de l’explosion des coûts de construction.
À la suite de son installation en 1993 sur la ferme familiale, dont le système fourrager repose alors sur le maïs et le soja, Alain Grasteau entame une réflexion dans l’objectif de s’orienter vers davantage d’herbe. « Je n’étais pas très motivé par le matériel, encore moins par le pulvérisateur, et je recherchais un système plus extensif, déclare-t-il. Mais il fallait assurer suffisamment de stock pour l’hiver, et aussi pour le reste de l’année car à l’époque, la ferme ne comptait que douze hectares de prairies accessibles au pâturage. »
L’éleveur opte donc pour le séchage en grange, et construit en 2003, un séchoir d’une capacité de 330 tonnes de matière sèche de foin. Quelques années plus tard, en 2007, il se convertit à l’agriculture biologique. Plusieurs échanges parcellaires lui permettent par la suite d’atteindre 28 hectares de pâturage accessibles. Avec ses trois cellules d’une surface de 153 m2 chacune, le séchoir stocke l’herbe fauchée en vrac sur une épaisseur de 6,50 mètres, chaque couche empilée par-dessus étant séchée au fur et à mesure. Le séchage se fait à l’aide de la toiture conçue comme un capteur solaire : en fibrociment sombre pour mieux absorber la chaleur, elle est doublée à l’intérieur d’un plafond en Styrodur.


Entre les deux matériaux, une lame d’air circule grâce à l’aspiration créée par deux ventilateurs situés dans les combles. L’entrée d’air se fait au niveau du débord de toiture sur les pignons. Lors de son passage dans la toiture, l’air se réchauffe d’environ 10 °C et surtout, perd 50 % d’hygrométrie. Aspiré par les ventilateurs, il est insufflé sous le fourrage, celui-ci étant posé sur caillebotis à 50 cm au-dessus du sol. Par un mouvement circulaire, l’air réchauffé et asséché dans le capteur solaire descend sous les caillebotis, puis remonte à travers le foin (en se chargeant de l’humidité contenue dans celui-ci), avant de ressortir du bâtiment par une ouverture dans le faîtage.
S’affranchir des conditions météo
Ainsi, le séchoir en grange est un moyen de récolter l’herbe en s’affranchissant des conditions météo, puisqu’il amène en quelques jours le foin préfané de 65 % à 90 % de matière sèche au minimum. « Il faut compter huit jours de séchage pour les premières coupes, indique Alain Grasteau. Sur ma ferme, j’ai 70 ha à récolter en première coupe. Je dispose de mon propre matériel pour maîtriser la chaîne de récolte à savoir : une faucheuse frontale de 3 mètres, une faucheuse latérale de 3 mètres, une faneuse de 8 mètres, un andaineur à double rotor de 6 mètres et une autochargeuse de 40 m3. L’idéal est d’avoir une fenêtre météo de quatre à cinq jours pour gérer un chantier de sept à huit hectares. Je fauche et fane le premier jour ; je fane deux fois le deuxième jour ; je fane à nouveau si besoin, puis j’andaine le troisième jour ; et enfin je ramasse à l’autochargeuse le quatrième jour. »

Au printemps 2024, l’éleveur disposait d’un stock de report de 200 tonnes de foin. Il a commencé ses récoltes le 25 avril, et collecté sur l’année 400 tonnes de matière sèche (t de MS). Une fois le séchoir plein, il a eu recours au bottelage ainsi qu’à l’enrubannage en complément. « Quand on dispose d’un appoint de chaleur tel qu’un déshumidificateur d’air, une batterie d’eau chaude en provenance d’un méthaniseur en cogénération ou un générateur d’air chaud, il est possible de démarrer les récoltes encore plus tôt, souligne Quentin Lemonnier, conseiller chez Segrafo, association spécialisée dans le séchage en grange. Les panneaux photovoltaïques en toiture sont aussi un moyen de récupérer davantage de chaleur qu’avec une toiture en fibrociment. »
Alain Grasteau distribue du foin séché en grange à ses vaches quasiment toute l’année : en complément du pâturage au printemps ; en complément d’ensilage de méteil à l’automne ; et seul ou avec un peu d’enrubannage en hiver. Un concentré céréalier fabriqué à partir du méteil grain est apporté toute l’année.
63 €/1 000 litres de coût alimentaire
La culture du maïs a été abandonnée ainsi que les achats de concentré protéique. Contrairement à la conservation par voie humide, la conservation par voie sèche préserve les sucres solubles présents dans l’herbe à la récolte, qui sont une source d’énergie importante. « La valeur nutritive du foin est supérieure à celle d’un foin classique mais il ne faut pas non plus rêver, reconnaît Alain Grasteau. Mon niveau de production laitière varie d’une année sur l’autre en fonction de cette qualité. Cette année il était de 3 700 litres vendus par vache mais il peut atteindre 4 200 litres une très bonne année. »

Le gros atout de la production laitière de l’éleveur est son faible coût. D’après le Civam AD 72 auquel l’éleveur adhère, le coût alimentaire total en 2023 était de 63 €/1 000 litres, dont 33 € de coût fourrager. Du côté des charges de mécanisation, elles sont estimées à 303 € par hectare de SAU (carburant, entretien, amortissement matériel roulant), dont 2 458 € par an liés à la griffe et l’autochargeuse (matériel spécifique au séchage en grange). Du côté de la consommation électrique, le séchoir représente le tiers des besoins de la ferme (environ 11 000 kWh par an). En y ajoutant l’assurance pour le bâtiment, le tracteur et l’autochargeuse, on atteint 4 962 € de charges de structure liées au séchage en grange. Un projet de bâtiment de stockage avec production d’énergie photovoltaïque pour l’autoconsommation est une piste à l’étude pour l’avenir.
Une hausse des coûts en vingt ans
Dans le cas de la SCEA Grasteau, le séchoir en grange est donc un outil aujourd’hui très rentable grâce à la maîtrise des charges permise. Ce choix est-il toujours aussi pertinent aujourd’hui ? « Pas toujours, regrette Quentin Lemonnier. Pour Alain Grasteau, l’investissement a été de 614 € par tonne de matière sèche. Aujourd’hui, il faut compter 1 500 €/t de MS du fait de la hausse des prix des matériaux et de normes plus contraignantes. »


Des projets de séchoirs continuent toutefois à voir le jour, mais à certaines conditions. Quentin Lemonnier cite l’exemple d’une réalisation à 1 200 €/t de MS (subventions déduites) chez deux jeunes installés ayant beaucoup autoconstruit (hors maçonnerie et charpente). Dans neuf cas sur dix, quand le coût du raccordement est abordable, les projets sont associés à une production d’énergie solaire dont la vente couvre une partie de l’investissement. Certains éleveurs se lancent également avec la perspective d’améliorer suffisamment leur autonomie protéique pour réduire significativement leurs achats de concentrés (éleveurs de chèvres notamment). « Une part élevée du coût de construction d’un séchoir en grange vient de la hauteur de la charpente et des contraintes liées à l’installation d’une griffe à fourrage, explique Quentin Lemonnier. Mais il est également possible de se tourner vers un séchoir en bottes ou un séchoir à plat multiproduit. »



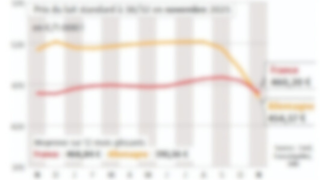
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard