
Traiter moins, traiter mieux et au moment opportun. Tels sont les trois piliers de la lutte ciblée contre les parasites gastro-intestinaux. La théorie est claire, mais comment la mettre en pratique ? Au moment du retour à l’étable, on peut appliquer la méthode de traitement ciblé sélectif. Avant cela, il peut s’avérer nécessaire d’intervenir au pâturage.
La saison de pâturage a démarré, les animaux sont dehors, ou ne vont pas tarder à sortir… Vous réfléchissez légitimement sur la pertinence d’agir contre le parasitisme ?
Première chose à savoir : « Il est souvent inutile de vermifuger durant les deux mois qui suivent la mise à l’herbe », assure Céline Cotrel, vétérinaire et cheffe de gamme chez Ceva Santé Animale. En effet, au cours de cette période, le risque d’infestation reste modéré.
Ce n’est qu’une fois passé ce laps de temps qu’il faut s’interroger : « Mes animaux produisent-ils bien au pâturage ? Quels sont ceux qui ont besoin d’un antiparasitaire interne, et qui peut s’en passer ? » Des repères pratiques permettent d’en juger.
Qui a atteint son objectif de temps de contact effectif ?
Avant tout, il est essentiel de distinguer les jeunes en première ou deuxième saison de pâture des animaux adultes ayant validé leur TCE (Temps de Contact Effectif). La vétérinaire rappelle que « pour acquérir une immunité naturelle solide, le temps de contact effectif avec les parasites doit être de huit mois avant le premier vêlage, déduction faite de la durée d’action du traitement antiparasitaire et des périodes de sécheresse ».
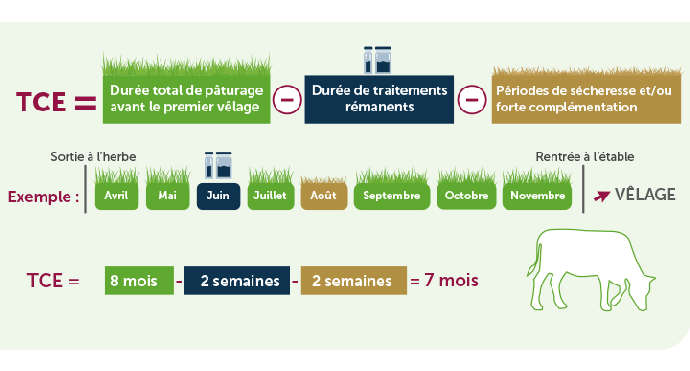
Bien souvent, cette immunité n’est pas complète chez les jeunes - y compris les primipares. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils doivent tous être traités ! Au niveau du pré-troupeau, l’état d’infestation s’apprécie la plupart du temps à l’œil : retard de croissance, aspect corporel dégradé, maigreur, poil piqué, diarrhées… « Ces génisses ou ces veaux méritent sans doute un traitement, explique Céline Cotrel. L’idéal pour s’en assurer est de suivre l’évolution de leur GMQ. »
Si c’est possible : tous les jeunes à la pesée !
Pour cela, passez tout le monde à la bascule avant la mise à l’herbe, puis une seconde fois à deux mois. « Les animaux qui sous-performent par rapport aux objectifs sont à traiter », précise la vétérinaire. Autre avantage de la pesée, elle aide à décider la mise à la reproduction des génisses. Contrôler régulièrement le GMQ permet de cibler les animaux en décrochage.
Cette pratique, très utile dans le cadre d’une démarche de traitement ciblé sélectif, est cependant plus courante chez les allaitants que les laitiers. Pas de bascule ? Prenez votre mètre ruban et mesurez les tours de thorax. Moins précise, la technique permet néanmoins de repérer les écarts entre individus.
Si vous êtes éleveur laitier, soyez attentif aux résultats de production des primipares n’ayant pas atteint leur TCE. « S’ils sont décevants, un antiparasitaire doit être envisagé. »
Être attentif aux retards de production
Les animaux qui ont complété leur TCE (adultes et primipares) peuvent être considérés comme immunisés. S’ils produisent bien au pré, on peut attendre et réévaluer plus tard la pertinence d’un traitement. « Après deux mois de pâture, les animaux, en retard de production laitière ou de prise de poids, devront être déparasités », résume Céline Cotrel.
Tous les individus d’un troupeau ne sont pas égaux face aux parasites. En effet, on considère de façon consensuelle que 20 % des animaux hébergent 80 % des populations de parasites et qu’au sein d’un même lot, tous les individus de bovins n’ont pas la même sensibilité au parasitisme et qu’il convient de cibler les traitements sur les plus fragiles. L’objectif est de ne prendre en charge que les animaux sensibles, par nature moins résilients, ou dont l’immunité a baissé. Cela peut être le cas après une année très sèche. Une vigilance accrue est de mise si le début de saison de pâturage est humide. Par ailleurs, ni la coproscopie, ni le test pepsinogène, parfois utilisés pour évaluer l’exposition du pré-troupeau, ne sont des révélateurs fiables du parasitisme des bovins adultes.
Eviter les sous dosages, basez-vous sur l’animal le plus lourd
Une fois les animaux à traiter identifiés, comment procéder ? Evaluez votre dosage sur la base du poids de l’animal le plus lourd. Ce faisant, vous éviterez les sous dosages qui favorisent l’apparition de résistance chez les strongles. « Ce phénomène, s’il se généralise sur vos pâtures, est sans issue, prévient Céline Cotrel. Le risque d’être confronté à une absence d’efficacité des traitements est réel. »
Limiter les pertes
Plusieurs voies d’administration sont possibles. La forme “ pour-on”, plébiscitée pour son côté pratique, présente une biodisponibilité faible. Les rejets dans l’environnement sont donc importants.
Les premiers à pâtir de ces rejets environnementaux sont les coléoptères coprophages, ou bousiers, responsables du recyclage naturel des bouses. Ce processus est assez rapide dans une prairie en bonne santé : il suffit de quelques jours pour qu’une bouse disparaisse. En leur absence, la bouse reste en place, créant une zone de refus. Certaines pâtures où la microfaune a été détruite peuvent en être recouvertes.
Une autre voie d’administration possible est la voie injectable. Les vermifuges injectables ont une biodisponibilité élevée. Cette forme pharmaceutique permet de limiter les rejets environnementaux et d’éviter les problématiques de sous dosage par léchage ou lessivage par la pluie.
Cependant cela nécessite de bloquer les animaux. Elle est particulièrement conseillée pour la mise en place du traitement ciblé sélectif, pour la maîtrise de la dose de produit assimilée par l’organisme.
Article réalisé par Web-agri Factory et proposé par Ceva.




« Nos vaches produisent en moyenne 16 200 kg de lait »
Les refus de dossiers de financement se multiplient dans les concessions agricoles
Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs
Le drenchage, la solution pour réactiver le rumen
Le lait sur le marché Spot ne vaut presque plus rien
Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Économie, travail, environnement : « S’installer en lait 100 % herbe, mon triplé gagnant »
Angus, Charolais, Blanc Bleu : quelle race préférer pour le croisement laitier ?