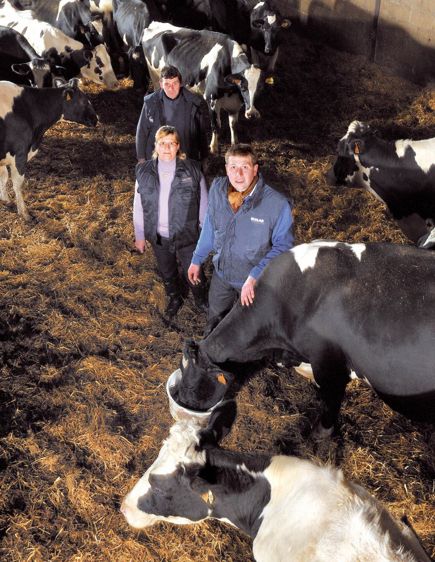
EN LIVRANT LEUR LAIT À LA COOPÉRATIVE MILCOBEL, BASÉE EN BELGIQUE, QUI LE VALORISE ESSENTIELLEMENT EN BEURRE ET POUDRE, LES ASSOCIÉS DU GAEC DU SUREAU ONT SUBI LA CRISE DE PLEIN FOUET.
LE GAEC DU SUREAU FAIT FIGURE DE PIONNIER, mais dans le mauvais sens du terme. Située dans l'Aisne, cette exploitation est l'une des premières en France à subir la crise du lait. En cause : sa laiterie, Milcobel, basée en Belgique, qui valorise essentiellement son lait sous la forme de beurre et de poudre. Résultat : le prix de base payé aux producteurs est calé sur le marché très volatil des produits industriels. Après avoir atteint un point culminant à 385 €/1 000 l en octobre 2007, il fait une chute vertigineuse pour atteindre un plancher à 185 €/1 000 l en mai 2009. De quoi donner des haut-le-coeur aux trois associés de ce Gaec familial.
En s'associant avec ses parents en 2005, Mickaël Hubert était loin de penser affronter une pareille conjoncture laitière. À l'origine, l'exploitation s'étendait sur 130 ha et disposait d'un droit à produire de 311 000 l de lait. Un troupeau de dix-huit vaches allaitantes complétait l'atelier laitier pour valoriser l'herbe, très abondante dans cette région située au sud de la Thiérache. « À 25 ans, j'ai saisi l'occasion de reprendre une ferme du village avec un quota de 255 000 l sur 55 ha. En m'installant, on m'a accordé une rallonge de 30 000 l. Les années suivantes, nous avons racheté 15 000 l de lait avec le dispositif des TSST, puis diverses attributions gratuites nous ont été accordées. La référence totale du Gaec atteint maintenant 625 000 l », déclare Mickaël.
La vente du lait en Belgique date de 1997. À l'époque, le contrat de livraison à Nestlé arrivait à échéance. La coopérative Milcobel cherchait à élargir son de lait comparé aux laiteries de la région, déclare Gérald, le père de Mickaël. En moyenne, durant dix ans, nous avons été payés 15 €/1 000 l plus cher. »périmètre de collecte sur le territoire français. « Elle avait un argument fort et offrait une plus-value sur le prix du litre de lait comparé aux laiteries de la région, déclare Gérald, le père de Mickaël. En moyenne, durant dix ans, nous avons été payés 15 €/1 000 l plus cher. »
VALORISER L'HERBE DANS LA THIÉRACHE
Aujourd'hui, les associés retrouvent un peu d'espoir avec la légère embellie sur le marché du beurre et de la poudre. En novembre, le prix de base s'élevait à 260 €/1 000 l (avec les primes qualité, le prix payé atteint 315 €). Grâce à une politique d'investissement très prudente depuis de nombreuses années, le Gaec a abordé cette crise avec une situation financière saine. L'exploitation des parents était peu endettée avec seulement des travaux de mise aux normes à rembourser. En s'installant, Mickaël a racheté les bâtiments de la ferme voisine et la maison d'habitation où il s'est installé avec sa femme.
Quant au foncier, la totalité a été louée. Lorsqu'il a fallu regrouper les deux troupeaux, très peu d'investissements ont été réalisés. « Nous les avons logés dans la stabulation de mes parents, qui date de 1982. Le bâtiment est divisé en deux avec une table d'alimentation centrale. D'un côté, une aire paillée pouvant recevoir 45 vaches laitières. De l'autre, nous avons accueilli le second troupeau, les génisses étant déplacées sur l'autre site. » Seule la construction d'une fumière a été entreprise sur le site racheté.
Le système de production, fondé pour une large part sur l'herbe, représente l'autre point fort de l'exploitation. Durant la crise, les trois associés ont mesuré combien il se révélait économe. Ce mode d'élevage est un véritable choix des parents car seulement 2,5 ha de pâturage sont accessibles à proximité de la stabulation, située au coeur du village. La tentation aurait pu être grande de miser sur le zéro pâturage. « Mais dans la Thiérache, les vaches doivent valoriser les prairies, confie Gérald. Au total, sur une SAU de 195 ha, ces surfaces représentent 105 ha. Nous avons toujours déplacé le troupeau au printemps, sur une parcelle d'herbe de 25 ha d'un seul tenant. Jusqu'en 1997, les vaches étaient traites dans une salle de traite ambulante. Après cette date, nous avons aménagé une salle de traite fixe. » La reprise de l'exploitation voisine par le fils représentait un fort enjeu pour le Gaec car les surfaces à reprendre en location étaient situées à proximité de ce bloc d'herbe. « À présent, cette parcelle s'étend sur 48 ha. Pour faire face à l'accroissement du troupeau, nous avons agrandi la salle de traite de 2 x 4 à 2 x 6. Le même aménagement a été réalisé dans celle située dans la stabulation », ajoute Mickaël.
AUCUNE COMPLÉMENTATION À L'HERBE
Au 15 avril, tout le troupeau est donc amené à la pâture qui n'est située qu'à 1,5 km du corps de ferme. La transition alimentaire est un peu délicate car les vaches ne sont lâchées que quelques heures par jour derrière le bâtiment, pendant moins d'une semaine. « Mais globalement, peu de problèmes métaboliques sont observés. Au printemps dernier, une seule vache a fait une tétanie d'herbage. » Les vêlages ont été volontairement groupés de la mi-septembre à la mimars pour que la production laitière suive le rythme de la pousse de l'herbe. Pendant cinq mois, les associés tentent de tirer profit au maximum de ce fourrage peu coûteux. Les parcelles sont divisées en paddocks d'environ 2,5 ha. Au printemps, les animaux disposent d'une surface de 25 à 30 ares par vache et reviennent sur une même parcelle toutes les trois semaines. L'été, la surface atteint 55 ares par vache et l'intervalle entre deux pâturages est de cinq semaines. Atout important durant cette période : le troupeau ne reçoit aucune complémentation. « Cela nous a permis de produire au moindre coût lorsque le prix du lait était au plus bas », explique Mickaël.
À partir de la mi-septembre, les vaches sont ramenées progressivement à la stabulation quelques jours avant leur date de vêlage. Et un mois plus tard, elles sont toutes rentrées. Durant cette période, les associés tirent, là encore, profit de leur système fondé sur l'herbe. Même si la ration est composée de deux tiers d'ensilage de maïs, le tiers restant comprend de l'ensilage d'herbe grâce à la récolte de 25 ha au printemps. Ceci permet de réduire la complémentation azotée.
UNE CONDUITE PEU INTENSIVE, TRÈS ÉCONOME
Avec la crise, les associés ont apporté certains changements à la ration. D'une part, l'aliment azoté à base de tourteaux de soja et de colza a été remplacé par un moins coûteux à base de tourteaux de colza et de drêche. L'économie réalisée atteint 70 € sur chaque tonne d'aliments. « Ensuite, nous adaptons notre complémentation selon le prix de base du lait. En septembre dernier, il atteignait seulement 220 €/1 000 l. Nous avons donc limité le tourteau azoté à 2 kg/VL/j pour équilibrer la ration à 20 kg de lait. Il est inutile de produire du lait pour perdre de l'argent. » La complémentation est ainsi adaptée mensuellement. Deux mois plus tard, en novembre, lorsque le prix de base est remonté de 40 €, les vaches ont reçu 3,8 kg de tourteaux dans la ration équilibrée à 30 kg de lait par jour. Pour 2008, le coût alimentaire calculé par la chambre d'agriculture atteint 105 €/1 000 l. « Il est supérieur de 10 € à l'objectif fixé par le réseau d'élevage, analyse Sébastien Juliac, conseiller à la chambre. Il s'explique par la non-réforme de certaines vaches pour produire la totalité de la référence laitière en constante augmentation. Certaines n'ont donc pas bien valorisé les concentrés qui leur étaient distribués. » Cette stratégie a également eu pour effet de dégrader légèrement le niveau cellulaire du tank. Malgré tout, la situation sanitaire du troupeau est bien maîtrisée. Les frais vétérinaires sont réduits à 9 €/VL alors que le groupe se situe à 15 €. La conduite peu intensive du troupeau explique en partie ce bon résultat. Le niveau d'étable est plutôt bas, avec 6 600 kg par vache en race holstein. L'objectif est de maintenir cette productivité par vache laitière avec la même quantité de concentrés. Gestionnaire dans l'âme, Mickaël aime les chiffres. Après un BTS Acse et un certificat de spécialisation en comptabilité-gestion en poche, il a travaillé comme comptable dans un centre de gestion. Au printemps, au plus fort de la crise, il a demandé à son conseiller en gestion de son CER de calculer ses coûts de production (voir page 79). Pour le lait, il s'établit à 305 €/1 000 l par litre vendu. Un chiffre qui comprend la rémunération de la main-d'oeuvre à 1 700 € par associé et une valorisation des capitaux propres à hauteur de 4 %. En 2009, le prix moyen du lait payé s'élève à 233 €/1 000 l, soit 45 à 50 € de moins que les exploitations voisines livrant leur lait en France. Ce qui représente un manque à gagner de 72 €/1 000 l. En 2009, l'atelier viande devrait atteindre l'équilibre financier.
AU MINIMUM UN AN POUR RENFLOUER LES CAISSES
Quant à la vente de céréales, elle devrait dégager un léger excédent de trésorerie. Mais pas suffisamment pour combler la baisse du chiffre d'affaires de l'atelier laitier. Le Gaec a donc eu recours à de nouvelles sources de financement pour passer le cap. « Pour la première fois, nous avons contracté un emprunt à court terme de 40 000 €. En passant par notre coopérative, nous avons obtenu un taux réduit de 1,19 %. Nous devons le rembourser entre février et juillet 2010, ajoute Mickaël. Nous avons également réinjecté entre 15 000 à 20 000 € dans l'exploitation. » Les associés ont aussi demandé à leurs fournisseurs de les soutenir en décalant les échéances de paiement sans appliquer d'agios. Certains ont joué le jeu, la dette à rembourser est estimée à 20 000 €. La crise a eu pour effet de créer une certaine solidarité entre les treize éleveurs du département livrant leur lait à Milcobel. Ils sont allés à la MSA demander du soutien. « Nous avons obtenu un gel de nos cotisations prélevées mensuellement au second semestre 2009. Chez nous, cela représente 1 500 € par mois. Mais l'on ne sait pas si nous devrons payer ces cotisations plus tard ou si elles seront supprimées », déclare Mickaël. Il estime par ailleurs ne pas être le plus mal loti du groupe. « Certains ont un système de production beaucoup plus coûteux et sont probablement dans une situation plus délicate que nous. » Pour faire face au manque d'argent, le Gaec a tenté de faire des économies partout. Ainsi, le groupage des chaleurs des génisses a été supprimé et un taureau pour le rattrapage a été placé plus tôt. L'économie réalisée atteint 3 000 €. Les associés ont réussi à s'approvisionner en paille sans débourser un seul centime grâce à un système d'échange. « Un voisin céréalier coopératif nous a donné 80 t de paille et je lui rendrai 240 t de fumier », confie Mickaël.
Les associés pensent qu'un an leur sera nécessaire pour rétablir la situation financière. Pour atteindre cet objectif, ils espèrent qu'en 2010, le prix moyen du lait payé soit au moins de 330 €/1 000 l. « Je suis tout de même inquiet pour les mois de mai et juin, une période jamais favorable aux marchés des produits industriels. » Cette crise a cassé l'évolution de l'exploitation. Plusieurs investissements ont été gelés. Le renouvellement de la désileuse et du tracteur d'élevage (45 000 €) a été décalé d'un an. Même situation concernant le projet de stabiliser l'accès à la salle de traite et le branchement de l'eau du réseau à la pâture pour un coût d'environ 17 000 €. Par ailleurs, un salarié, à mi-temps depuis dix-huit ans, a pris sa retraite fin 2008 et n'a pas été remplacé. Les associés assurent seuls le travail. Impossible pour eux de se libérer à tour de rôle les weekends. Ils ont également réduit leurs prélèvements privés de 500 € chacun pour ne pas accentuer le trou dans la trésorerie. « Mais nous comptons bien nous rattraper lorsque le cours des produits industriels remontera », conclut Mickaël, un brin optimiste.
NICOLAS LOUIS
Le troupeau de vingt-cinq blondes d'Aquitaine permet de valoriser les prairies et de diversifier les productions.
Les bâtiments sont situés au coeur du village de Dagny-Lambercy. Seulement 2,5 ha de pâturage sont disponibles à proximité de la stabulation.
La salle de traite de 2 X 6 postes à la pâture est de même dimension que celle située dans la stabulation. Le Gaec ne dispose que d'un seul jeu de griffes qui est déplacé d'un site à l'autre.
Après le lait et la viande, les cultures représentent le troisième atelier de l'exploitation. En 2009, la vente de céréales a permis de dégager un léger excèdent de trésorerie.
Contrairement au prix du lait où le Gaec ne fait que subir les cours mondiaux des produits industriels, Mickaël tente de maîtriser en partie celui de ses céréales en les vendant sur le marché à terme.
La nurserie de quarante places est séparée de la stabulation. Très peu de problèmes sanitaires sont observés durant la phase d'élevage des veaux.




La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026