
Construite en 2023, la stabulation laitière du Gaec du Chêne Vert prend en compte le réchauffement climatique et applique les dernières recommandations sur le bien-être des vaches. Les associés n’oublient pas leur propre confort.
Le confort et le bien-être de l’éleveur et des vaches, la résistance aux fortes chaleurs des laitières sont les trois axes qu’un bâtiment doit satisfaire aujourd’hui.
C’est ainsi qu’Anthony, Marie-Elisabeth et Bertrand Emprou, en Gaec fils-parents, ont conçu leur stabulation laitière de 110 logettes et 108 places aux cornadis pour 102 à 105 vaches traites. Elle est en route depuis novembre 2023 et est le résultat de la refonte de l’élevage que l’installation d’Anthony en 2021 a provoquée. Son arrivée s’est en effet accompagnée de 690 000 litres de référence contractuelle supplémentaire par l’attribution JA de Lactalis, la reprise de contrats laitiers et d’une exploitation voisine de 55 ha. « En attendant la construction de la stabulation, le troupeau était scindé en deux lots, l’un dans le bâtiment de 40 logettes paillées existant, l’autre sur une aire paillée. Cette organisation qui a duré deux ans était fatigante. »
Un réglage minutieux des logettes
La stabulation laitière n’a rien de tape-à-l’œil. Ici, point d’équipements high-tech mais ceux choisis sont réfléchis. Sans doute les logettes profondes (ou creuses, lire l’encadré) sont-elles les plus frappantes lorsque l’on rentre pour la première fois dans le bâtiment. « Avec les logettes profondes, on tend vers le confort de l’aire paillée tout en bénéficiant de l’organisation des logettes », estime Guillaume Cailler, conseiller bâtiment à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, qui accompagne le Gaec du Chêne Vert. « Si les logettes sont bien réglées, les vaches seront propres. »
Utilisant la paille depuis des années à raison de 3 à 4 kg/logette/jour, les associés souhaitaient la conserver, la jugeant moelleuse pour leurs laitières. Cet atout l’emporte sur celui des logettes-matelas pour lesquelles il y a zéro paille à brasser et l’économie de temps qui va avec. « Guillaume Cailler et la visite de bâtiments nous ont convaincus de l’intérêt des logettes profondes. » Après un an de fonctionnement, le bilan est positif même s’ils s’y sont repris à quatre fois pour obtenir le bon réglage des logettes (détail photos). La quasi-absence de cuirs pelés au niveau des jarrets, des cuisses et de la pointe du bassin en témoigne. Le nombre de logettes souillées par les bouses et les urines est l’autre indicateur : 10 à 15 le matin, soit 10 % à 15 % des logettes, ce qui est conforme aux recommandations. Ce pourcentage renvoie aux primipares et aux plus petites vaches du troupeau. « Après les tâtonnements du début, nos vaches sont aujourd’hui propres. Cela fait partie de nos critères incontournables de confort du travail car la traite s’en trouve facilitée. C’est une des raisons qui nous a fait opter pour ce système. » Quant au nombre de mammites, il est revenu à la normale (une par mois depuis juin mais avec du pâturage) après en avoir subi 25 à 30 en trois mois cet hiver en raison des logettes mal réglées.
70 tonnes de paille économisées
Le Gaec énumère trois autres intérêts qu’il trouve aux logettes profondes. Le premier : une économie de paille. Il apporte 1 kg de paille/vache/jour contre 3 à 4 kg en logettes paillées. Le kilo de paille broyée en brins de 2 cm est mélangé à 3 kg de chaux et à un petit litre d’eau. « Nous avons besoin 30 tonnes de paille par an contre 100 tonnes si nous avions construit un bâtiment de 110 logettes paillées, soit une économie de 6 000 € à 7 000 €. Ils sont grignotés par les 100 t de chaux pour une dépense de 3 000 € et par les 1 500 € de broyage de paille, calcule Marie-Elisabeth. Peut-être consommerons-nous un peu de moins de paille en 2024-2025. L’année passée particulièrement pluvieuse a sans doute exigé un surplus de paille que nous avons du mal à quantifier, faute d’expérience. »
Travail manuel allégé
Deuxième intérêt des logettes profondes : la suppression du paillage quotidien des vaches qui, dans l’ancienne organisation, occupaient Anthony ou Bertrand plus d’une heure par jour (logettes et aire paillée). « Nous ne subissons plus la poussière qu’il générait », ajoutent-ils, Désormais, les deux associés les rechargent tous les 10 à 15 jours l’hiver et tous les 25 à 30 jours durant la saison de pâturage. L’un ou l’autre y consacre 45 minutes, auxquels il faut rajouter 20 à 30 minutes d’égalisation des litières. « Deux préparations paille + chaux + eau sont effectuées dans notre mélangeuse distributrice à vis horizontale sur un autre site à 1,5 km de là. Elles sont versées dans un godet distributeur avec tapis de 1,5 m3 qui éjecte le mélange sur 6 à 7 logettes. Il n’était pas question de réaliser manuellement cette tâche. »







Le Gaec veut augmenter la capacité du godet, acheté 8 500 €, par des rehausses qui permettront d’alimenter plus de logettes. En revanche, l’ébousage et l’égalisation quotidiens au râteau sont obligatoirement manuels. C’est l’inconvénient de ce système. « Nous le faisons matin et soir durant 20 à 30 minutes l’hiver, et une fois par jour durant le pâturage. Avant, nous enlevions aussi manuellement les bouses des logettes. » L’autre inconvénient est le stockage de la paille hachée, volumineuse, et son brassage.
Désormais en système lisier
Le dernier intérêt aux yeux des deux associés et de Bertrand, et pas des moindres, est l’abandon du système fumier, désagréable et compliqué à gérer, d’autant plus que les couloirs étaient raclés au tracteur « Les logettes paillées produisaient un fumier mou. La paille hachée à 2 cm apportée en faible quantité résout ce problème. Elle nous permet de passer en système lisier. Les deux couloirs sont raclés toutes les trois heures l’hiver », dit Bertrand. L’investissement dans des abreuvoirs à vidange rapide, dans deux portes à ouverture et fermeture automatique aux extrémités de la table d’alimentation ou encore la réflexion en cours sur deux robots de traite ou une TPA 2x12 postes complètent l’amélioration de leurs conditions de travail. Les vaches sont actuellement traites dans une 2x6 postes.
Été : un bâtiment qui gère les fortes chaleurs
Les autres investissements sont destinés au bien-être des vaches. « La nouvelle stabulation prend en compte la nécessaire adaptation au changement climatique, pointe Guillaume Cailler. La toiture de fibrociments est sans translucides pour éviter d’augmenter la température dans le bâtiment durant les fortes chaleurs. » En contrepartie, le bâtiment est éclairé par l’ouverture des longs pans équipés chacun d’un filet brise-vent amovible (photo), régulé par un boîtier électronique en fonction du vent, de l’humidité et de la température. « Sur la façade nord-est, le constructeur nous a conseillé une hauteur à 2,50 m de la paroi métallique pleine pour ralentir la vitesse du vent l’hiver, dit Anthony. Les courants d’air ne sont pas forcément sur le dos des vaches l’été mais, construit sur une petite butte, le bâtiment bénéfice des vents maritimes. Le littoral est à 60 km de l’exploitation. L’été s’est bien passé mais cette première année s’est déroulée sans canicule. » Le Gaec ferme l’accès au pâturage à partir de 76 de THI (Temperature Humidity Index). À ce niveau, les laitières sont considérées en stress thermique élevé. Anthony s’appuie sur l’application gratuite ThermoTool pour prendre cette décision. « L’ombrage qu’offrent les haies n’est alors pas suffisant pour protéger les laitières des très fortes chaleurs », estime-t-il. Ceci d’autant plus que le bâtiment a un autre atout : le soleil de fin d’après-midi ne tombe pas sur la table d’alimentation et les vaches. Elles sont protégées par la toiture qui couvre les 5 mètres du couloir de distribution. Le jeune éleveur est un partisan des conduites qui couple pâturage et vie en bâtiment l’hiver. « Ils sont économiquement efficients et apportent de la variété dans la vie des vaches. »
Hiver : fournir de l’espace aux vaches
Les 105 vaches en lactation passent 100 % de leur temps dans le bâtiment durant quatre mois. Avec 110 logettes, elles disposent chacune d’une logette et d’une place aux cornadis, ce qui répond aux recommandations de confort de couchage et d’accès à l’auge. « Nous ne voulons pas dépasser les 110 traites pour maintenir ce confort, dit Anthony. Si, à l’avenir, nous développions de nouveau l’activité laitière, nous augmenterions la production par vache. À 9 450 kg brut par vache, il existe encore des marges de progrès. » Certes, le Gaec a prévu une extension possible de 15 mètres du bâtiment. « Mais pour l’instant, ces 240 m² servent d’aire d’exercice extérieure l’hiver aux vaches. Cela leur plaît. Les voir prendre le soleil nous plaît aussi », sourit Marie-Elisabeth.




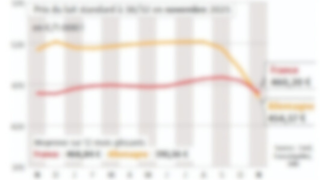
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard