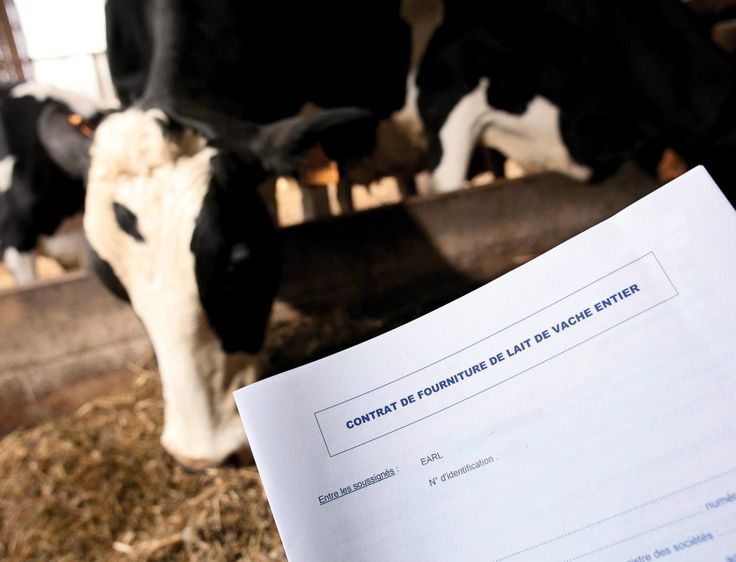
Les contrats de lait s'échangent désormais de plus en plus librement. Cela soulève bien des questions, qu'il s'agisse de la fixation du prix ou du statut juridique.
LONGTEMPS OFFICIEUX PENDANT LA PÉRIODE DES QUOTAS LAITIERS, le marché des références laitières devient officiel à l'heure des contrats. Une évolution qui ne plaît certes pas à tout le monde, mais qui répond à un réel besoin, notamment là où les demandes de volumes supplémentaires sont longtemps restées insatisfaites.
Les modalités d'achat et de vente d'un contrat sont a priori les mêmes que pour n'importe quel bien. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. L'échange implique aussi la laiterie, et son statut (coopérative ou privée) a son importance. De plus, la nature juridique du contrat n'est pas encore bien claire, ce qui engendre des incertitudes.
Nous avons interrogé deux associations de gestion, CER France Morbihan et Cogedis, pour faire le tour des questions qui se posent.
Hormis quelques interprétations divergentes, les réponses sont à peu près claires.
ACHAT DE PARTS SOCIALES EN COOPÉRATIVES
En coopératives, il n'existe pas de contrat de vente de lait mais un contrat d'adhésion. L'agriculteur acquiert des parts sociales et la coopérative achète sa production. Le cas du remplacement d'un adhérent par un autre pour cause de cession d'exploitation est bien connu. Tout dépend des statuts mais, d'une manière générale, la coopérative a son mot à dire pour accepter un nouvel adhérent.
Dans le cas où le repreneur ne souhaite acquérir que le droit à produire du cédant, rien n'est formalisé. Il faut donc que l'acheteur et le vendeur s'assurent que la coopérative accepte de cesser la collecte chez l'un pour la démarrer chez l'autre, en maintenant les conditions acquises au premier. On peut imaginer que l'acceptation ne se fasse pas à l'identique. Par exemple, une partie des livraisons pourrait être payée au prix B. Si la coopérative reconduit les mêmes conditions, on peut supposer qu'elle est disposée à prendre de nouveaux adhérents. Le preneur n'a donc sans doute pas besoin du vendeur pour travailler avec la coopérative. S'il le fait en direct, il paiera les parts sociales, mais rien de plus. Il faut donc bien évaluer l'intérêt de passer par un cédant.
PRIVÉS : LE CONTRAT DÉTERMINE LES CONDITIONS
Dans le cas des industriels privés, l'échange des contrats est assez peu réglementé. C'est le contrat lui-même qui fixe les conditions. La première chose à faire est de vérifier s'il prévoit les conditions de cessibilité. On peut imaginer une transmission du contrat à l'identique. Cela suppose l'accord de la laiterie.
Attention à la durée de validité du contrat. La plupart des contrats ont été signés il y a à peine quatre ans, avec une durée de validité de cinq ans, renouvelable tacitement. La question de l'intérêt d'acheter un contrat valable un an se pose pour l'acheteur, même s'il semble peu probable que la laiterie ne reconduise pas le contrat sur une autre période de cinq ans l'amortissement.
FIXER LE PRIX
Les points clé du contrat concernent la durée, le volume et le prix du lait. Or, les contrats de lait donnent peu d'informations sur le prix. Cette incertitude dévalorise le contrat. Sa valeur réside dans la possibilité de bénéficier d'un débouché durable et dans de bonnes conditions financières pour sa production. Cette sécurité a un prix dans la mesure où il n'est pas possible de l'obtenir gratuitement. Dans le contexte actuel de production abondante, les laiteries sont peu enclines à donner des volumes de référence supplémentaires. Mais cela peut changer. Quelle sera la valeur des contrats achetés aujourd'hui si les industriels en produisent de nouveaux dans quelques années ?
En matière de commerce, les choses sont simples : le prix est celui que l'acheteur est prêt à mettre. Les candidats à l'achat doivent donc être capables d'évaluer l'intérêt économique d'un contrat. Celui-ci dépend des hypothèses retenues et des résultats propres à l'éleveur. Il doit d'abord évaluer le revenu marginal qu'il dégagera sur les volumes produits en plus.
Si le preneur doit investir pour livrer le lait supplémentaire, on ne peut plus considérer qu'il est produit au coût marginal. Les charges de structure supplémentaires vont réduire le revenu dégagé sur le volume du nouveau contrat, et donc le niveau de prix qu'il peut raisonnablement payer.
L'acheteur doit aussi fixer la durée d'amortissement qu'il souhaite pour le contrat. Compte tenu de la volatilité, il doit estimer un taux de risque réaliste. Par exemple, si le revenu marginal espéré est de 60 €/1 000 l, le risque de s'écarter de cette valeur existe. Avec un risque à 20 %, on aboutit à un revenu fluctuant entre 48 et 62 €/1 000 l.
L'acheteur doit garder cette évaluation du prix en tête lorsqu'il négociera avec le vendeur. À lui de la fixer comme un maximum ; si la concurrence ou la ténacité du vendeur pousse le prix plus haut, l'acheteur doit savoir qu'il augmente le risque de ne pas rentabiliser l'investissement.
Les prix pratiqués sur le terrain semblent extrêmement divers. Certains retiennent le chiffre de 150 €/1 000 l, soit le montant qui a longtemps prévalu pour les Acal. Ou encore celui qui avait été retenu pour les TSST (transferts de quotas sans terre). À l'OPLGO, la première OP à avoir mis en place les échanges de gré à gré, on préconise de ne pas dépasser 72 €. Le montant de parts sociales demandé par les coopératives fournit une autre référence. Chez Sodiaal, par exemple, il se situe autour de 36 €/1 000 l, avec une part de volume B .
LES FORMALITÉS À RESPECTER
L'acheteur doit d'abord s'assurer que la laiterie rédigera un avenant au contrat pour formaliser le changement.
Le vendeur et l'acheteur doivent écrire une convention entre eux afin de préciser l'ensemble des points relatifs à la transaction. Il faut mentionner la date à laquelle s'opère le changement. C'est essentiel pour la facturation des livraisons et aussi pour la détermination du volume concerné. En effet, pour un échange s'effectuant en cours de campagne, une partie du volume contractuel a déjà été livrée par le cédant.
En toute logique, le contrat devrait s'amortir en fonction de sa durée de validité, ce qui crée une charge déductible. Dans les faits, la question n'est pas tranchée par l'ANC (Association nationale de comptabilité). En attendant, le contrat est traité comme une immobilisation non amortissable, à l'image des DPU (droits à paiement unique). En Bretagne, les CER préconisent de ne pas pratiquer d'amortissement.
Sur le plan fiscal, le contrat est présumé exister à l'actif du bilan du vendeur. La vente génère une plus-value, à court ou à long terme selon la date de début du contrat. Elle pourra être soumise au paiement d'impôt et de CSG. À titre indicatif, une plus-value à long terme est taxée à 16 % et soumise à la CSG et au CRDS au taux de 15,5 %.
Selon François Pillet de Cogedis, la TVA est due sur la vente d'un contrat, mais avec une franchise de 34 000 €. Au CER du Morbihan, Jean-François Bréger conseille d'appliquer la TVA sur la vente d'un contrat. Il considère en effet qu'il s'agit d'une cession d'actif professionnel, donc soumis à la TVA.
Sur le plan juridique, si la vente de contrat s'effectue avec transfert de foncier mis à bail, il faut être vigilant. Car le contrat pourrait être considéré comme un pas-de-porte. Or, la vente d'un pas-de-porte entre fermiers est interdite. Lorsque la nature juridique sera éclaircie, ce type d'incertitude sera levé.
Sur le plan financier, les banques semblent traiter la question comme les autres demandes de crédit. Déjà sollicité pour financer l'achat de contrat, le Crédit agricole des Côtes-d'Armor examine d'abord la cohérence du projet et la capacité de l'acheteur.
PASCALE LE CANN




Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs