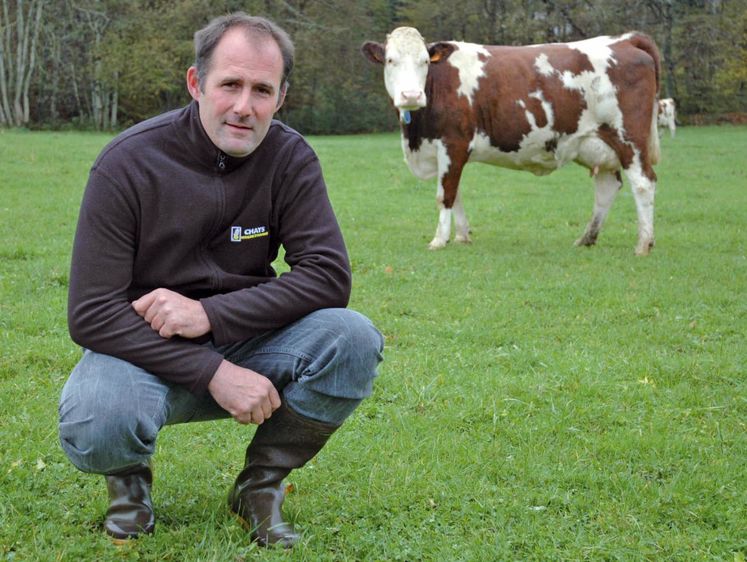
Martial Kovalik conduit un système intensif mais très raisonné en zone comté. Son credo : faire le maximum de chiffre d'affaires via ses ventes de lait et d'animaux dans la limite de ce qu'il est économiquement intéressant de produire en plus.
INSTALLÉ SUR LE PREMIER PLATEAU DU MASSIF JURASSIEN, Martial Kovalik est un peu atypique dans sa façon de produire du lait. Et pourtant, la rentabilité de son exploitation devrait inciter ses collègues, comme lui en filière comté, à s'en inspirer. Témoin : les 118 000 euros d'EBE dégagés en 2010-2011 (main-d'oeuvre salariée déduite) et 103 000 € en 2011-2012 (année pourtant marquée par la sécheresse). La structure n'a cependant rien à envier à d'autres. Martial mène 46 montbéliardes produisant 331 000 l de lait. Comme bien d'autres dans le Doubs, il élève beaucoup. Trente génisses par an, toutes nées chez lui pour partie des vaches vendues fraîches vêlées. L'EARL de l'Avenir couvre 98 ha dont 92 d'herbe (77 ha de prairies naturelles, 15 ha de temporaires), le tout avec un parcellaire regroupé favorable mais sur un milieu pédoclimatique qui l'est moins. Les sols assez superficiels ont l'avantage d'être portants mais souffrent vite en cas de sécheresse. Plus singulier est le volume de main-d'oeuvre pour la structure. Juste un apprenti pour 0,2 UTH en plus du « bon plein-temps » de Martial… un appoint indispensable pour passer sereinement la fenaison, capitale ici. Mais cela n'explique pas la performance économique enregistrée.
« PRIORITÉ FORCÉE À L'EBE POUR S'INSTALLER »
Si l'exploitation dégage autant de revenu, c'est que Martial Kovalik a compris depuis longtemps qu'avec du foinregain distribué cinq à six mois l'hiver et du pâturage le reste du temps, la clé d'un EBE maximal n'était pas dans l'expression du potentiel laitier maximum des animaux. C'est tout simplement parce qu'au delà d'une certaine quantité de concentrés, la théorie du kilo d'aliment supplémentaire pour 1,5 à 2 l de lait en plus ne se vérifie plus. Il chute à 1 ou 0,5 l, voire moins… lourd de conséquences financières quand le fourrage seul couvre au mieux 12 à 14 kg de lait. Martial se souvient encore de cette discussion animée avec son contrôleur, l'année de son installation, à propos de deux vaches contrôlées à 45 kg auxquelles il fallait, en théorie, apporter 16 kg d'aliments chacune pour couvrir les besoins. « C'était pour moi un non-sens économique et ce n'était pas les prix actuels. Difficile de surcroît à ce niveau d'apport de tenir des vaches sans problème métabolique ou de pattes. »
En vérité, l'éleveur n'a jamais vraiment eu d'autre choix que de maximiser l'EBE. C'est hors cadre familial qu'il s'installe en 1995 sur une exploitation où il lui faut investir dans « du lourd » au plus vite. C'est dans une étable entravée sans couloir central et en petites bottes qu'il démarre. L'année de son installation est celle de la construction d'un stockage du fourrage avec le passage à la balle ronde. Suivent en 1997, un hangar à matériel et, en 1999, la stabulation : des logettes paillées cul à cul, un couloir raclé au tracteur et des caillebotis devant les cornadis. Elle abrite de part et d'autre du couloir d'alimentation les laitières d'un côté, les élèves de l'autre. Pour la salle de traite, Martial opte pour une TPA mono-quai à dix places. Dans le même temps, l'exploitation doit en plus renouveler le matériel repris en bout de course.
« EXPRIMER LE POTENTIEL LAITIER COÛTE CHER EN SYSTÈME FOIN-REGAIN »
En résumé, Martial a eu l'obligation de comprendre très tôt que pour dégager du revenu, il lui fallait maximiser le produit de son atelier laitier, mais cela dans la limite de ce qu'il est intéressant de produire en plus sans pénaliser l'EBE. Un travail d'équilibriste accessible à tous, sous réserve d'accepter de limiter les quantités de concentrés distribuées et ne pas chercher à exprimer tout le potentiel des animaux, stratégie vite coûteuse en ration foin-regain. Et ne parlons pas d'un hiver comme celui qui s'annonce avec du VL 18 dont le prix arrive à 315 ou 355 €/t (avec ou sans tourteau de soja). Même avec du lait à 502 €/1 000 l comme ici, les derniers kilos de lait produits peuvent coûter plus cher qu'ils ne rapportent. On l'aura compris, Martial ne se mire pas dans sa moyenne contrôle laitier. Sa stratégie n'a d'ailleurs jamais varié d'une virgule depuis le départ : produire son quota en priorité avec du fourrage, pas du concentré, et selon la qualité du premier et le prix du second en jouant si besoin sur le nombre de vaches. « Peu m'importe de traire quelques animaux en plus. En 2010, j'ai atteint mon objectif avec 46 vaches, en 2008 avec 54. » Les 58 places de VL du bâtiment et le volant de la bonne quinzaine de vaches fraîches vêlées vendues lui donnent la souplesse voulue. Mais ce raisonnement reste tout en subtilité car, dans ce système plutôt intensif pour le secteur (1,12 UGB/ha de SFP et 3 741 l/ha de SAU en tenant compte du correctif sol-climat défavorable), il est vital d'assurer un niveau certain de produits. La moyenne économique du troupeau est d'ailleurs loin d'être ridicule : 7 140 l et 7 230 l en 2010 et 2011. Mais cela juste avec 1 400 kg de concentrés par laitière, soit 201 et 194 g/l pour un coût de 45 et 48 €/1 000 l.
Pour arriver à ce résultat, Martial joue sur trois axes. Le premier est un classique souvent négligé : le pâturage. Sa gestion est facilitée ici par un parcellaire regroupé. 13 ha, les moins légers de l'exploitation et assez riches en trèfle, sont attenants au bâtiment. Au total, plus de 50 ha sont accessibles aux vaches. Pour autant, Martial ne néglige rien : jamais plus de trois jours dans la même parcelle et un fil avant déplacé deux fois quotidiennement. « C'est comme cela qu'on maintient le lait au tank et le TP », souligne l'éleveur pour lequel peu importe le temps passé s'il lui fait économiser du concentré. En 2011, marquée par un début de saison sec, les vaches ont tourné sur 64 ares/VL au printemps, 68 en été et 123 à l'automne (48, 79 et 110 ares/VL en 2010). Au pâturage, jamais plus de 5 kg de concentrés et seulement pour les meilleures. Le gros du troupeau se contente de 2 kg d'un VL16 acheté (composé de matières premières basiques) distribué au Dac. S'y ajoute, pour 10 à 15 animaux à plus de 27 kg, un mélange de 0,5 à 3 kg maximum de céréales, du seigle et de l'orge produites sur l'exploitation et du maïs acheté. Les animaux reçoivent en outre toute la saison un minimum de 2 à 3 kg de foin, « crucial pour soutenir les taux et l'état des animaux ». Martial apporte aussi un soin particulier à la qualité de l'herbe offerte en n'hésitant pas à passer le broyeur. Par exemple, si une parcelle est prête à épier. « Ce travail est très variable selon les années et les parcelles. Il m'est arrivé de broyer quatre fois dans la même saison. En revanche, en 2011, le broyeur est resté sous le hangar. » Et s'il se sent dépassé, il fauche pour récolter. « Le tout est de ne jamais laisser sur le sol un tapis trop épais qui compromettrait la repousse. » La fertilisation des pâtures ne doit rien non plus au hasard. Les 26 ha dédiés aux VL et les 15 ha des génisses reçoivent 16 à 20 m3 de lisier à l'automne. S'y ajoutent deux ou trois apports de quinze unités d'azote minéral.
« ON PEUT FAIRE DU BON FOIN EN BALLES RONDES »
Le second levier pour limiter les quantités de concentrés est aussi un grand classique : la qualité du foin et regain distribués ici à hauteur de 50/50 pendant les 5 à 6 mois d'étable. La qualité, un défi quand on est en balles rondes ? Pas pour Martial, même s'il n'a pas la prétention de faire aussi bien qu'avec un séchage en grange. « Il y a moyen de récolter une première coupe plus que correcte à condition de s'en occuper. »
Lui fauche plutôt l'après-midi, pirouette deux fois par jour, et met en andains tous les soirs en prenant soin de bien retourner le foin côté sol. Il s'est aussi donné les moyens de travailler vite avec deux faneuses de 8,70 m et 6,40 m en plus de la faucheuse-conditionneuse de 2,80 m et un andaineur de 6,50 m à deux toupies. « Je suis un peu suréquipé », assume-t-il volontiers. « Ma deuxième faneuse ne travaille que 3 à 4 jours dans la saison, mais il faut savoir ce que l'on veut. ».
Martial prend aussi des risques calculés, comme cette année où il a profité des deux « fenêtres de tir » fin mai. Résultat : 10 et 20 ha fauchés et tout le foin des laitières engrangé.
Dans les alentours, beaucoup ont dû attendre trois semaines de plus avant de sortir la faucheuse avec, à la clé, 20 % de MAT perdus. Pour assurer le rendement (3,8 t de MS/ha en 2010, 2,5 t en 2011), les 50 ha en première coupe reçoivent 16 m3/ha de lisier. S'y ajoutent 10 t/ha de fumier composté sur 25 ha et 30 unités d'azote sur 30 ha. « En mai, j'utilise un testeur d'humidité pour décider du pressage. Je ne prends le risque de presser entre 18 et 20 % que si le temps est menaçant. »
Comme au pâturage, Martial garde l'hiver la main légère pour la programmation du Dac. Une vache à 22 kg de lait, moyenne hivernale du troupeau, reçoit, comme toutes celles qui produisent entre 22 et 27 kg, 5,5 kg d'aliment (3 kg d'un VL24, complété de 2 kg du mélange céréalier d'été et de 0,5 kg de tourteau). Celles qui sont entre 27 et 32 kg en ont 7 kg, et les vaches au-delà sont plafonnées à 8,2 kg.
Le troisième levier pour arriver à plus de 7 000 kg/VL avec 1,4 t d'aliment est bien plus singulier. Depuis que la nouvelle stabulation permet à Martial de moins courir pour soigner seul tout le cheptel, il n'a de cesse de chercher à casser le pic de lactation et obtenir une courbe de lactation la plus plate possible. Ses apports de concentré très maîtrisés et plafonnés vont dans ce sens.
« TARIR TRENTE JOURS POUR ÉCRÊTER LE PIC »
Depuis deux ans, il y a ajouté un autre volet : un tarissement très court. « En dix ans, j'ai beaucoup tâtonné pour passer de 60 à seulement 30 jours. » Précision : on n'est ici qu'à 130 000 cellules en moyenne annuelle. « Taries 60 jours, les bêtes démarrent avec trop de réserves corporelles dans lesquelles elles puisent pour combler le déficit énergétique entre ce qu'elles produisent et ce qu'elles ingèrent. Mises sous contraintes avec moins de réserves, elles expriment un pic bien moindre », constate Martial.
« Écrêter ce pic permet de démarrer la lactation avec beaucoup moins de concentrés. Mais aussi de limiter la perte d'état et donc d'économiser sur l'aliment à apporter pour en remettre en fin de lactation. Enfin, c'est le gage d'un TP plus haut. » Ici, la vache idéale recherchée est celle qui démarre à 23 kg, fait son pic à 25 kg, est tarie à 15-17 kg et produit sans souci 7 000 à 7 500 kg de lait avec le maximum de TP. Pendant la dernière campagne, le niveau de vêlage des adultes pointe à 28,6 kg de lait, celui des primipares à 24,6 kg. Le travail sur le TP a particulièrement payé. « À mes débuts, j'avais le niveau le plus bas de la coopérative. Aujourd'hui, j'ai le plus haut à 37 g/l. »
Trouver la bonne période de vêlage a aussi été compliqué. Mettre les vaches sous contrainte alimentaire est en effet très difficile à l'herbe où elles mangent ce qu'elles veulent. C'est la raison pour laquelle si les vêlages sont étalés sur l'année, beaucoup se déroulent de septembre à mars.
Toutes les vaches, celles au potentiel laitier le plus marqué en première ligne, n'ont pas tenu dans ce système. Celles qui ont un pic trop élevé, trop faible en TP, ont été et sont encore réformées en priorité. Les maquignons continuent d'ailleurs de se presser ici pour ces vaches très productives que d'autres recherchent.
Sous contrainte alimentaire mais aussi peut-être parce que la génétique montbéliarde actuelle n'est pas totalement en phase avec ce système, les vaches peinent un peu en reproduction (54 et 48 % de réussite en première IA en 2010 et 2011). Ce n'est pas le cas des génisses (71 et 80 %). Mais la proportion des vaches à plus de trois inséminations artificielles reste raisonnable : 15 %, avec un intervalle vêlage-vêlage encore correct (396 et 376 jours) dans la mesure où les vaches ne sont improductives qu'un mois et taries pour certaines à 20 l/j. Les frais vétérinaires restent bas (13 €/1 000 l). Martial regrette de ne pas pouvoir trier ses taureaux d'insémination sur la persistance de lactation qu'il recherche. Mais aussi de ne pas avoir plus de choix pour « fabriquer » ces vaches puissantes dans leur dessus et leur avant-main qui gonflent ses ventes (124 €/1 000 l de produit animal). Néanmoins, il ne descend jamais sous les 200 kg de lait mais évite les taureaux à plus de 900 kg. Son système reste intensif. Il a besoin d'un minimum de performance laitière, mais pas trop.
JEAN-MICHEL VOCORET
« Une montbéliarde avec d'abord du TP et assez de viande » Symptomatique de choix axés sur le TP, la valeur bouchère, la santé du pis, la mamelle et, seulement ensuite, le lait, Martial Kovalik a trait jusqu'à seize Mohair. Mais juste une Micmac, son contemporain, excellent partout sauf en TP, musculature et largeur de poitrine. Cette stratégie ne s'est pas faite aux dépens du niveau génétique. Le troupeau est indexé à 126 d'Isu, + 299 kg de lait et + 0,9 g/l en TP, pour un moyenne raciale à 113 d'Isu, + 171 kg de lait et seulement + 0,1 en TP.
Tous les animaux sous le même toit. De part et d'autre du couloir d'alimentation, 58 places de vaches laitières et 64 places de génisses… une rationalité indispensable pour soigner seul autant d'animaux en hiver.
Un parcellaire favorable au pâturage La gestion du pâturage est facilitée par un parcellaire regroupé. 13 ha, les moins légers de l'exploitation et assez riches en trèfle, sont attenants au bâtiment. Au total, plus de 50 ha portants sont accessibles aux laitières.




Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs