
Daphné et Yoann Bizet accueillent, derrière leur stabulation, une ombrière photovoltaïque construite par l’entreprise TSE. Elle couvre 40 % des 3 ha de prairies bientôt semées. Un tiers du troupeau y pâturera en juin. L’expérimentation durera neuf ans avec TSE et l’Idele.
C’est une nouvelle aventure que débutent Daphné et Yoann Bizet, éleveurs laitiers dans le Calvados. Après le lancement en 2018 d’une unité de méthanisation couplée à une activité de séchage, ils expérimentent cette fois-ci avec l’entreprise TSE, spécialisée dans la production d’énergie solaire, une ombrière photovoltaïque sur 3 ha de prairie, installée derrière les bâtiments. « Un tiers du troupeau, c’est-à-dire environ 35 vaches, y pâturera en cinq à six paddocks de 0,5 ha. Il s’agira plus d’une aire récréative que d’un véritable pâturage », précise Léa Bonin, en charge du suivi R&D de l’installation chez TSE. Le 15 décembre, les 5 914 panneaux photovoltaïques ont été branchés et, depuis le 15 janvier, leur amovibilité (ou tracking) démarrée. Ils couvrent 40 % de la surface et suivent le soleil d’est en ouest. L’objectif est que toute la surface bénéficie de l’ombre et de la lumière dans la journée. Leur mise en route a été précédée de sept à huit mois de terrassement et de câblages. La canopée est constituée de poteaux espacés de 27 m entre les rangs et de 10,80 m sur le rang. « Les 27 mètres sont le plus large interrang techniquement possible aujourd’hui », indique-t-elle. Les poteaux ont une partie émergée haute de 6 m et une partie souterraine avec des micropieux enfoncés jusqu’à 7 m de profondeur par forage. « Hormis le socle de béton rectangulaire à la base de chaque poteau, il n’y a pas d’injection de béton dans le sol pour ne pas l’artificialiser », souligne Yoann Bizet.

Sur la rangée,tous les trois à quatre poteaux, est fixé un onduleur à mi-hauteur qui reçoit l’électricité continue des panneaux photovoltaïques les plus proches. Elle produit un courant alternatif qui est envoyé dans un premier circuit de câblage électrique enterré à 1,10 m le long de la rangée, puis dans un second circuit de collecte enterré cette fois-ci perpendiculairement à l’ombrière, avant de rejoindre le transformateur de 20 000 volts à l’extrémité de la canopée.
7,6 M€ investis par TSE
L’injection dans le réseau électrique se fait à 450 m de là. L’ensemble de l’investissement s’élève à 7,6 M€, financés par TSE, dont 800 000 € de financement participatif. « TSE est payée pour l’électricité produite. De notre côté, l’exploitation perçoit un loyer pour les 3 ha loués dont mon épouse et moi sommes propriétaires. Nous avons signé un bail emphytéotique et un contrat de quarante ans avec TSE. » Yoann Bizet reste discret sur le montant de l’indemnité. « C’est moins de 3 000 €/ha », assure-t-il tout de même (lire aussi l’encadré).

Le partenariat avec TSE permet à Daphné et Yoann de faire évoluer leur système de production. Ils opèrent un retour vers le pâturage grâce à l’ombrière photovoltaïque. En plus des 3 ha, 6 ha voisins seront pâturés par les 75 autres vaches du lot témoin.


Mise à l’herbe courant juin
« Nos vaches ne pâturent plus depuis douze ans. L’été, lors de fortes chaleurs, elles s’agglutinaient dans les zones ombragées. Ce n’était pas satisfaisant, dit Daphné. Nous attendons donc beaucoup du bénéfice de l’ombrage créé par les panneaux solaires suspendus.Le pâturage, qui devrait débuter courant juin, apportera un peu plus de cohérence à notre conduite. La ration fourragère des laitières est aujourd’hui 100 % en herbe toute l’année mais sans pâturage. La réintroduction du pâturage sera un grand changement pour elles. »
En mars, les 3 ha sous les panneaux seront semés avec une association de graminées + légumineuses sous couvert d’avoine. Agressive, la céréale limitera le salissement par les mauvaises herbes et assurera un premier pâturage trois mois après l’implantation. Le mélange prairial est composé de 22 % de fléole des prés, 16 % de fétuque élevée, 22 % de ray-grass tétraploïde et diploïde, 25 % de trèfle blanc et 15 % de trèfle hybride. « La première année, les 3 ha seront divisés en 6 paddocks d’un demi-hectare qu’un tiers des 110 vaches en lactation pâturera, à raison de deux à trois jours par paddock. L’année suivante, l’un d’entre eux sera retourné pour du maïs, qui est notre tête d’assolement. L’ombrière photovoltaïque ne doit ni changer nos pratiques ni empêcher la personne qui nous succédera de faire d’autres choix. C’est ainsi que nous concevons l’agrivoltaïsme. »
Le stress thermique ausculté
Les panneaux hauts de 4 m (point le plus bas) à 5 m (point le plus haut) et les poteaux espacés de 27 m permettent le passage d’engins agricoles, à l’exception de l’ensileuse. En pleine pousse de l’herbe, le débrayage de paddocks pour la fauche par une autochargeuse sera donc possible. « Les résultats de production, de qualité du lait et de santé des 35 vaches au pâturage seront comparés à ceux du lot témoin, détaille Léa Bonin. Leur comportement au pâturage sera également observé, tout comme celui de leur retour au bâtiment puisqu’il leur sera donné le choix de rester ou de rentrer. » Logiquement, le stress thermique des laitières sera particulièrement suivi.


Les capteurs pour mesurer sous la structure le rayonnement solaire, la température, l’humidité et la pluviométrie aideront à comprendre son processus et à définir les modalités de pilotage de la canopée pour le réduire. Les deux robots de traite mis en route le 9 janvier, que TSE a financés à 70 %, faciliteront le suivi. Une porte de tri dirigera les deux lots vers l’un ou l’autre côté de la table d’alimentation qui leur est réservé. Leur ingestion sera ainsi mesurée grâce au robot d’alimentation des Bizet. Pour le pâturage, une seconde porte de tri orientera les deux lots vers le couloir les emmenant soit vers le paddock sous ombrière, soit vers le paddock classique. TSE et l’Idele assureront le suivi du troupeau, ainsi que celui de la prairie (pousse de l’herbe, valeurs alimentaires, évolution floristique, etc.). « L’Institut de l’élevage garantit l’objectivité des résultats et leur publication même s’ils ne sont pas favorables à TSE. L’expérimentation durera neuf ans », estime Yoann Bizet.
Équipements d’élevage financés par TSE
Outre la participation à l’acquisition des deux robots de traite à hauteur de 70 %, TSE finance les équipements nécessaires à l’expérimentation : deux portes de tri, cage de pesée avant d’aller aux cornadis, podomètres, boviduc en sortie de stabulation, chemins d’accès empierrés aux deux zones de pâturage, clôtures, y compris autour des haubans pour éviter les blessures par frottements, un abreuvoir pour deux paddocks sur 25 m² de tapis, compteurs pour mesurer la consommation d’eau ou encore la plantation de 1 000 m linéaires de haies autour des 3 ha pour l’insertion paysagère.
La crainte des courants parasites
« Les courants parasites dus aux panneaux photovoltaïques sont notre grande crainte, avec une dégradation des comptages cellulaires et du niveau d’étable à la clé, reprennent les deux éleveurs. Si c’était le cas, nous arrêterions l’expérimentation, après avoir bien sûr essayé de résoudre le problème. C’est prévu dans le contrat signé avec TSE. » Il faut dire aussi que l’exploitation est au cœur du massif armoricain, dans le prolongement de la Bretagne, connu pour ses veines d’eau et ses failles. En amont des travaux, durant deux jours, un géobiologue et l’entreprise Mantenna Expertise ont vérifié toutes les mises à la terre de l’exploitation, la conductivité des sols et leurs champs électromagnétiques. Ces mesures seront de nouveau faites quand tout sera mis en route, et ensuite tous les trois ans. « Nous participons à la recherche de solutions énergétiques innovantes tout en maintenant notre activité d’élevage, c’est motivant. Être dans l’innovation contribue également à fidéliser nos six salariés. »



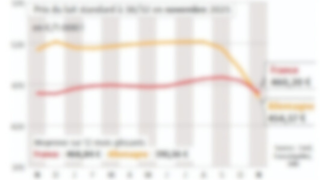
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard