
Après avoir beaucoup investi il y a dix ans, la SCEA Nature et Lait, dans le Pas-de-Calais, est désormais dans une phase d’optimisation de l’existant et se prépare pour les nouvelles générations.
Dans les Hauts-de-France, le regroupement de la SCEA Nature et Lait et de la SCEA Boilly-Martin est l’exemple d’une authentique exploitation de polyculture élevage, dont le chiffre d’affaires est équitablement réparti entre le produit des cultures de vente et celui du troupeau laitier.

Sur des terres de bon potentiel agronomique dans la région naturelle du Ternois, les associés ont su miser sur la complémentarité des productions animales et végétales (fumier, lisier, paille, pulpe de betterave…) pour diversifier leur assolement et bâtir un système d’élevage à la fois simple et économe basé sur le maïs, les matières premières et la ration complète. Aujourd’hui, la conduite du troupeau de 170 holsteins s’approche de ce qui s’apparente à un rythme de croisière. « Nous ne souhaitons pas réinvestir pour nous agrandir davantage, ni remettre en cause un système qui fonctionne bien, même s’il est toujours possible d’améliorer la productivité laitière par la voie du progrès génétique », explique Stéphane Martin.

Un week-end sur deux et quinze jours de vacances par an
Installé en octobre 2003 avec ses parents désormais retraités, Stéphane est responsable du troupeau. Il est secondé par Hugo Boilly, un cousin, actuellement salarié à plein temps, dont le père Christian et le frère Quentin sont les associés en charge des cultures. Ici, l’année 2013 marque un tournant majeur de la vie de l’exploitation : elle correspond à la mise en service d’une nouvelle stabulation de 150 places en logettes + 20 places en aire paillée, équipée d’un roto de traite, d’une nurserie attenante à la laiterie, d’une fosse à lisier et d’une fumière couverte, soit un investissement de 1 M€. Avant cela, les vaches étaient réparties dans deux sites distants de 1 km.

« C’est-à-dire qu’il fallait deux trayeurs sur chaque site et une autre personne faisant la navette pour l’alimentation. D’un point de vue sanitaire, le regroupement de troupeau n’a pas été facile, mais ces installations ont considérablement amélioré nos conditions de travail. Deux personnes suffisent désormais pour assurer l’astreinte le samedi soir et le dimanche, ce qui permet de prendre un week-end sur deux et une quinzaine de jours de vacances. »
Les associés ont ainsi trouvé un équilibre dans la répartition des tâches. Si Christian et Quentin se consacrent au suivi des cultures, ils assurent par ailleurs la traite un week-end sur deux et prennent part quotidiennement aux soins des animaux : paillage, allaitement des veaux, distribution des rations au bol mélangeur. Les « éleveurs », Stéphane et Hugo, participent à certains chantiers de plaine (fumier, paille…), mais aussi au triage et à la livraison de pommes de terre en filet à des commerces locaux.

Une ration complète économe, sans concentré de production
« Tous les mardis matin, nous préparons les commandes. Un peu de céréales sont aussi vendues aux particuliers et aux sociétés de chasse. Au-delà de la marge en vente directe, c’est aussi l’occasion de garder un contact avec l’extérieur. »

Côté troupeau, des rendements maïs réguliers de 16 à 17 t de MS et l’approvisionnement garanti en pulpe de betterave surpressée en tant que planteur (800 t/an) assurent l’autonomie fourragère sur la base d’un chargement de 2,16 UGB/ha de SFP. La ration complète maïs + pulpe + colza est équilibrée à 29 litres de lait, soit une moyenne de 8 250 litres à 33,6 de TP et 42,4 de TB. Cette ration dosant 0,95 UFL et 90 g de PDI/kg de MS ne vise pas l’expression du pic de lactation, mais répond à la volonté de faire le volume de façon économe, sans concentré de production, souligne Stéphane : « Depuis la fin des quotas, nous avons fait le choix de maximiser la recette laitière par les taux grâce à la génétique. » Ainsi, le TB a progressé de 3,5 points en cinq ans sans modifier l’alimentation. Il faut dire que l’éleveur n’hésite pas à acheter les doses des meilleurs taureaux auprès de différents fournisseurs. « C’est un investissement qui paye », assure-t-il. Outre les taux, le plan d’accouplement accorde une attention particulière à la reproduction et à la facilité de vêlage : « Un moyen de favoriser une bonne involution utérine, afin de ne pas trop décaler la mise à la reproduction dans une logique de vêlages groupés. »

Aucune insémination entre le 10 janvier et le 15 juin
Les mises-bas sont en effet groupées entre le 15 mars et le 15 octobre. L’idée étant de ne pas avoir de naissances en hiver à une période avec plus de problèmes de santé chez les veaux, mais aussi de bénéficier d’une grille de paiement incitative à produire du lait d’été. Dans la pratique, cela signifie l’arrêt des inséminations le 10 janvier. Les vaches vides à cette date voient leur lactation prolongée pour une reprise des IA le 15 juin, soit 12 à 15 vaches décalées/an qui expliquent un IVV de 396 jours. De même, après une mise à l’herbe précoce, les génisses de plus d’1 an rentrent à l’étable début juin pour la mise à la reproduction.

Elles ressortent à l’herbe une fois confirmées pleines, pour valoriser 28 ha de pâtures jusqu’à l’automne. Ici, seuls 4 ha d’herbe sont enrubannés en première coupe, plus 10 ha en fin de saison pour leur alimentation.Pas d’ensilage d’herbe donc, ni de dérobées avant maïs dans l’alimentation des laitières. « Avec la pulpe, pas besoin, nous privilégions la simplicité. » À partir de mi-mars, les vaches ont néanmoins libre accès à 10 ha de pâtures divisés en deux blocs, soit une économie de 2,5 kg/jour de colza pendant un mois et demi au printemps et une économie de 15 % de maïs. En été, le pâturage s’apparente plus à une aire de promenade où elles peuvent profiter de l’ombre fournie par les haies plantées en 1999 dans le cadre d’un CTE. Entre les associés, un débat persiste pour savoir s’il faut profiter de la trentaine d’hectares potentiellement accessibles pour augmenter cette surface pâturable au détriment des cultures. « Idéalement, j’aimerais une dizaine d’hectares d’herbe en plus, concède Stéphane. Mais dans tous les cas, je tiens à maintenir le libre-accès à l’herbe pour le confort des vaches. »
La relève est assurée
Si ce système semble bien rodé et offre à chacun la possibilité de dégager du temps libre pour sa famille, des pistes d’optimisation ont néanmoins été identifiées au sein d’un petit groupe d’échange informel de quelques éleveurs : « L’objectif est de mieux maîtriser le taux de renouvellement (35 %) et d’opter pour des taureaux un peu plus laitiers afin de monter entre 8 500 et 9 000 litres de lait et ainsi fixer le cheptel à 150 vaches et 50 génisses. Avoir un bâtiment moins saturé et ouvrir un peu le bardage doit contribuer à améliorer l’ambiance et le confort des animaux. »

Le diagnostic bien-être animal réalisé avec Danone, parmi 100 points expertisés, valide à 93 % les pratiques d’élevage. Sur ce volet, Stéphane assume d’avancer main dans la main avec sa laiterie pour communiquer auprès du public : il a participé à des animations en magasin, au Salon de l’agriculture et projette des interventions dans les écoles en partenariat avec Danone.
La ferme sert aussi de support à des opérations portes ouvertes : « Face aux attaques contre notre métier et à la baisse de consommation des produits ultrafrais, il faut redorer notre image et montrer la qualité de notre travail. Je m’engage pour la filière pour que demain mon fils Théo puisse s’installer à son tour. »


À 19 ans, Théo a suivi un cursus agricole avec cette volonté. La première étape passera sûrement par le salariat en remplacement d’Hugo dont l’installation est d’ores et déjà programmée courant 2024 pour succéder à son père.



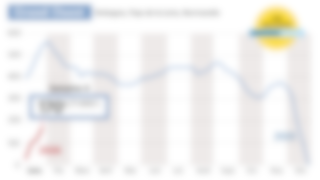
La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité