
Au Gaec de Retz, en Bretagne, Florian et Frédéric Le Pottier utilisent un godet mélangeur pour nourrir tout le troupeau, et une pailleuse placée sur leur télescopique. Une organisation qui leur évite de dédier un tracteur à ces tâches.
Frédéric Le Pottier est éleveur à Loudéac, dans les Côtes-d’Armor. Quand son frère Florian l’a rejoint en 2015 sur le Gaec familial, en remplacement de leur père Jean-Yves parti à la retraite, ils ont construit une nouvelle stabulation. Ce bâtiment est placé de l’autre côté de la route, près des silos d’ensilage déjà existants. Il accueille les 110 laitières et toute leur suite, soit plus de 200 animaux répartis autour d’un seul couloir d’alimentation. « Nous n’avons jamais eu de remorque distributrice ni de bol mélangeur sur l’exploitation, commente Frédéric. La distribution à l’auge s’est toujours faite directement au chargeur. Le premier modèle mélangeur est arrivé en 2010 et a été renouvelé en 2017. L’objectif est de tout faire avec un seul matériel, tout en visant de bonnes performances sur le plan zootechnique. »
4,6 m3 de fourrage transportable
Le modèle choisi par le Gaec de Retz est un Melodis du fabriquant Emily. Il peut contenir jusqu’à 4,6 m3 de fourrage.

Il est équipé sur le dessus d’une fraise à entraînement hydraulique qui prélève l’ensilage. Le mélange est assuré par une vis horizontale qui brasse tout le contenu. Pour la distribution, le constructeur a prévu une trappe à ouverture hydraulique sur le côté du godet. La ration type est la suivante : 1,2 t d’ensilage, 80 kg de correcteur et 8 kg de minéraux. Au quotidien, le chauffeur charge d’abord le maïs, puis éventuellement de l’herbe ensilée. Ensuite, il se dirige jusqu’au bâtiment où se situe le silo avec le correcteur.


Pour gagner du temps, les deux frères ont installé une vis électrique pilotée avec une télécommande depuis la cabine. Pendant le remplissage, le chauffeur a le temps de descendre pour ajouter un seau de minéraux. Le mélange s’effectue lors du trajet jusqu’à la stabulation en inversant plusieurs fois le sens de rotation de la vis. Le couloir d’alimentation est commun aux génisses et aux laitières qui sont logées des deux côtés. Ce godet ne distribuant que sur la gauche, une fois arrivé au bout du hangar, le chauffeur opère un demi-tour et revient en nourrissant l’autre côté.
Une heure de travail par jour en hiver
Pendant les quatre mois d’hiver, il faut compter cinq godets par jour. Une personne seule nourrit tout le troupeau en une heure. Dès le printemps, quand le pâturage a débuté, l’astreinte passe à deux ou trois passages quotidiens. « Nous avons fait installer des capteurs de pesée sur le circuit hydraulique de la flèche, précise Florian. L’écran en cabine indique le poids chargé dans le godet. C’est assez précis et vraiment utile pour affiner la ration. La fraise de désilage laisse un front d’attaque propre et régulier, limitant ainsi le risque de surchauffe du tas. Pour l’ensilage d’herbe, il faut des brins hachés courts pour avoir une bonne qualité de mélange. »

Pesant 2 tonnes à vide, ce type de godet est relativement lourd, il faut donc un télescopique suffisamment puissant pour embarquer parfois jusqu’à 1,5 t de fourrage. Malgré la charge importante, le Gaec n’a jamais constaté d’usure prématurée au niveau de la flèche. Pour l’alimentation, le bras étant toujours rentré, il y a peu de porte-à-faux. Florian et Frédéric utilisent un télescopique Kramer KT507 de 136 ch. Sa capacité de charge nominale est de 4,8 t. Il effectue environ 1 400 heures de travail par an et le Gaec le renouvelle généralement tous les quatre ans. « Le télescopique fonctionne tous les jours, il est dès lors indispensable d’avoir du matériel en bon état, ajoute Florian. C’est pourquoi, nous avons souscrit une garantie de trois ans au moment de l’achat, en incluant aussi un contrat de maintenance par le concessionnaire. Quant à l’entretien, mieux vaut être vigilant : le filtre à air ainsi que les ventilateurs sont soufflés et nettoyés régulièrement. Nous avons aussi opté pour un graissage centralisé, ce qui ne nous empêche pas de contrôler de temps en temps que tous les axes sont bien lubrifiés. »
Du matériel toujours en état de marche
Mesurant 2,80 m de largeur, le godet est assez imposant, ce qui suppose d’avoir des accès suffisamment ouverts à chaque entrée de bâtiment. Dans la stabulation, les vaches sont logées sur une aire paillée qui est curée toutes les deux semaines en hiver. Les deux frères utilisent aussi une pailleuse Emily qu’ils placent sur le télescopique. Le constructeur a prévu un seul boîtier en cabine pour commander les fonctions hydrauliques des deux outils, ce qui est pratique et évite de multiplier les consoles en cabine. « Alimenter, pailler et curer uniquement avec le télescopique est une organisation qui nous convient bien, estime Frédéric. C’est également économique. En 2017, ce godet nous a coûté 25 000 €, alors qu’un bol mélangeur tracté valait au moins le double. Ce ratio est toujours le même aujourd’hui. Sans compter qu’il faudrait aussi prévoir le tracteur pour mettre devant. Cela représenterait un coût supplémentaire important sans gain au quotidien, puisque cela ne ferait pas baisser le nombre d’heures global passé au volant. »



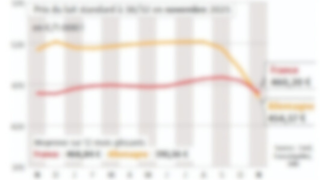
« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »
La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite
À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?
Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité
Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard