
Depuis 2020, la teneur en chlorate ne doit pas dépasser 0,1 mg dans un kilo de lait. Le résidu provient des alcalins chlorés utilisés dans le lavage des équipements de traite. La coopérative Isigny Sainte-Mère a pris ce sujet à bras-le-corps.
Le chlore est un désinfectant largement utilisé dans tous les secteurs économiques, dans le domaine privé et pour le traitement de l’eau. Dans les exploitations laitières, il désinfecte la machine à traire et le tank à lait. « Sans chlore, le lait encrasse les équipements de traite, ce qui favorise les multiplications bactériennes », confirme Denis Thomas, responsable de production lait à la coopérative Isigny Sainte-Mère (Calvados). Son oxydation produit un résidu, le chlorate, qui peut se retrouver dans les denrées alimentaires. » En 2020, l’Union européenne a instauré des limites maximales de résidus (LMR) de chlorate pour les différentes catégories d’aliments. Elles seront réexaminées au plus tard le 8 juin 2025. Pour les laits crus, thermisés et destinés à la fabrication de produits laitiers, la LMR est actuellement établie à 0,1 mg de chlorate par kilo de lait.
Les analyses d’Isigny plus strictes
Connue pour ses poudres de lait infantiles exportées en Chine et ailleurs dans le monde, et pour ses PGC haut de gamme, Isigny Sainte-Mère a décidé de durcir ce critère pour assurer une totale conformité à la réglementation. « Dans la foulée de la modification des règles européennes, nous avons défini, fin 2020, une LMR “maison” en la descendant à 0,05 mg de chlorate par kilo de lait. Les poudres infantiles étant des produits concentrés, nous ne voulons pas prendre le risque de dépasser la barre de 0,1 mg de chlorate. » D’ailleurs, le taux de chlorate dans les poudres infantiles est un des critères de libération des lots de la coopérative.

La réduction de moitié de la LMR s’est accompagnée d’un rappel de bonnes pratiques –○contrôlées à l’occasion de l’audit pour la charte des bonnes pratiques d’élevage○–, en particulier sur le recours à un alcalin chloré homologué. Le lait des 380 exploitations adhérentes est analysé en routine. Deux fois par an, un échantillon de lait spécifique est prélevé par le chauffeur de camion de lait. « Il est analysé directement par le laboratoire de la coopérative, ce qui permet d’être réactif en cas de dépassement de la limite “maison”. Nous prenons contact avec l’exploitation dont les résultats commencent à glisser vers 0,1 mg de chlorate et nous allons traire avec l’éleveur ou l’éleveuse, c’est la méthode la plus efficace pour identifier la cause », estime Denis Thomas.
Les principales mesures pour avoir l’esprit tranquille
- L’alcalin chloré à la bonne dilution. Le choix du produit de lavage de la machine à traire et du tank n’est pas en cause. « Les producteurs achètent tous des produits alcalins chlorés homologués. L’eau de Javel, et encore plus les lavages chocs, sont à bannir car sa concentration en chlore est élevée. Le rinçage est beaucoup plus difficile à réaliser. » La dilution du produit lessiviel est la principale explication au dépassement de la LMR d’Isigny, ou éventuellement à celui de la LMR réglementaire. La première mesure est de respecter la recommandation de concentration mentionnée sur l’étiquette, qui varie généralement de 0,25 % à 1 %, soit 0,25 litre à 1 litre pour 100 litres d’eau de lavage. « Pour cela, il faut connaître le volume d’eau dans le bac de lavage pour obtenir la bonne concentration. » Le responsable de collecte prend l’exemple d’une salle de traite de 2x6 postes ou de 2x7 postes qui nécessite 100 l d’eau de lavage, selon les indications du fabricant. « Pour une concentration définie à 0,5 %, il faudra 0,5 litre de produit. » Si l’installation est équipée d’un préleveur automatique de produit alcalin chloré, bien évidemment il doit être régulièrement surveillé (la consommation hebdomadaire par exemple).
- Rinçage. La deuxième mesure est le contrôle du volume d’eau pour le rinçage. « Afin de sécuriser le rinçage, on compte au moins 8 litres d’eau par griffe ». Soit un minimum de 96 litres pour une 2x6 postes. Si le bac n’est pas suffisant, on le remplacera par un plus grand. Dans le cas contraire, en système de lavage manuel, un second rinçage sera effectué. En lavage automatique, il pourra l’être juste avant la traite suivante. « L’ajout de postes supplémentaires sans faire évoluer la capacité du bac est une des erreurs dans les situations rencontrées », pointe Denis Thomas.
- Purge entre les cycles. La troisième mesure concerne la purge entre les cycles de nettoyage de l’installation de traite. Avant de débuter le rinçage, le bac de lavage doit être vide pour éviter de « contaminer » par les produits l’eau de rinçage. « Malgré toutes ces précautions, il est arrivé que l’on ne corrige pas la situation. Un diagnostic spécifique de la machine à traire a permis d’identifier la source — une contre-pente du lactoduc par exemple. Il s’agit bien souvent d’installations vieillissantes. » Les robots de traite, eux, ne sont quasiment pas concernés par les alertes mises en place par la coopérative. Les équipements sont récents et les prises d’eau automatisées limitent fortement le risque d’une mauvaise dilution de l’alcalin chloré et d’un rinçage insuffisant.


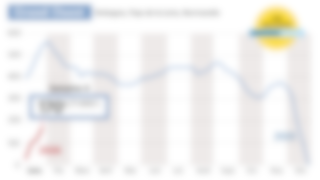


La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035
Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »
Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?
Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud
De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »
Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard
Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité