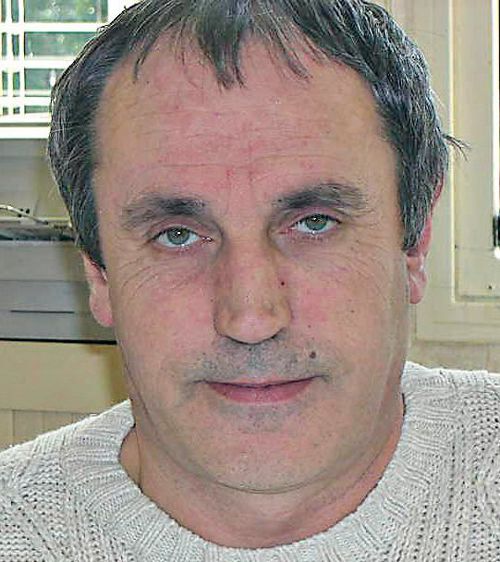
À l'heure de la crise laitière, les employeurs disposent d'outils de gestion du personnel, dont l'activité partielle et le licenciement économique.
Lorsque le prix du litre de lait ne permet plus de faire face aux charges de l'exploitation et au coût salarial se pose la question du licenciement. Tout employeur peut, sous conditions, révoquer un salarié pour motif économique. Mais il doit mettre en oeuvre des mesures permettant d'éviter ce licenciement.
1)Action de prévention : l'activité partielle
RÉDUIRE L'ACTIVITÉ DU SALARIÉ OU LA SUSPENDRE TEMPORAIREMENT
La demande peut être faite pour l'un des motifs suivants :
- une conjoncture économique défavorable ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel (perte du principal client, par exemple) ayant entraîné l'interruption ou la réduction de l'activité.
DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE
Pendant cette période, l'employeur verse une indemnisation au salarié placé en activité partielle. L'État garantit une prise en charge partielle de l'indemnisation des heures chômées. Pour bénéficier de ce dispositif, le chef d'exploitation doit engager des démarches auprès de sa Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) avant la mise en activité partielle de son personnel. Il doit adresser au préfet du département où est implantée l'exploitation une demande préalable d'autorisation d'activité partielle lui permettant de placer son salarié en activité réduite.
La demande doit préciser : les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés et leur durée de travail habituelle, le nombre d'heures prévisionnelles d'activité partielle demandées.
La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours. Le refus doit être motivé. En l'absence de réponse dans les quinze jours, l'autorisation est considérée comme accordée. L'état d'avancement de l'instruction du dossier peut être suivi en ligne. L'autorisation d'activité partielle n'est accordée que pour une durée maximale de six mois renouvelables.
L'employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées ou les faire figurer sur le bulletin de paie. Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en activité partielle, l'employeur doit adresser en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle, tous les mois.
L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé à 1 000 heures par an et par salarié.
L'allocation est fixée à 7,74 € par heure chômée (depuis un décret de 2013) dans les entreprises employant jusqu'à 250 salariés. Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP).
2)Le licenciement économique
CONDITIONS À REMPLIR
Si l'activité partielle n'a pas permis de surmonter la difficulté économique, le licenciement économique peut être inévitable, surtout en cas de cessation d'activité. Il résulte :
- soit d'une suppression ou d'une transformation de l'emploi du salarié concerné ;
- soit d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
Il est fondé :
- soit sur des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;
- soit sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- soit sur la cessation d'activité, sauf si elle est due à une faute de l'employeur ou à sa « légèreté blâmable » (décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner).
Aucun critère particulier, aucun taux de réduction ne sont définis dans le code du travail. Ils sont actuellement laissés à l'estimation du juge en cas de contestation du licenciement par le salarié.
UNE PROCÉDURE STRICTE
L'employeur doit :
- déterminer les critères qui le poussent à choisir tel ou tel salarié en cas de pluralité d'ouvriers (charges familiales, compétences professionnelles, ancienneté) ;
- envoyer la convocation à l'entretien préalable de licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge. Ce courrier doit préciser l'objet de l'entretien, sa date, son lieu, et la possibilité que le salarié a de se faire accompagner par un représentant du personnel ou par un conseiller. L'endroit où il peut trouver la liste des conseillers doit être également précisé ;
- respecter un délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la lettre et l'entretien ;
- expliquer au salarié, durant l'entretien, les raisons qui le poussent à le licencier, lui faire des propositions de reclassement sur des postes équivalents ou inférieurs (avec l'accord du salarié), lui proposer des formations dans le cadre de son compte personnel de formation. L'employeur doit informer le salarié de l'existence d'un contrat de sécurisation professionnelle (mesures d'accompagnement spécifiques et allocation Pôle emploi équivalente à 75 % du salaire pendant un an) ;
- notifier sa décision au salarié, au minimum sept jours après l'entretien, par LRAR en précisant les motifs du licenciement. Il doit aussi informer le salarié qu'il bénéficie, pendant un an, s'il le souhaite, d'une priorité de réembauche. La lettre doit indiquer les mesures prises pour un maintien dans l'exploitation et le délai qu'a le salarié pour accepter ou refuser les propositions de reclassement ;
- informer la Direccte dans les huit jours qui suivent l'envoi de la lettre au salarié. Le préavis de licenciement est de un mois si le salarié a entre six mois et deux ans d'ancienneté, et de deux mois s'il est dans l'exploitation depuis deux ans ou plus.





Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
Le bale grazing à l’essai
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »
Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs