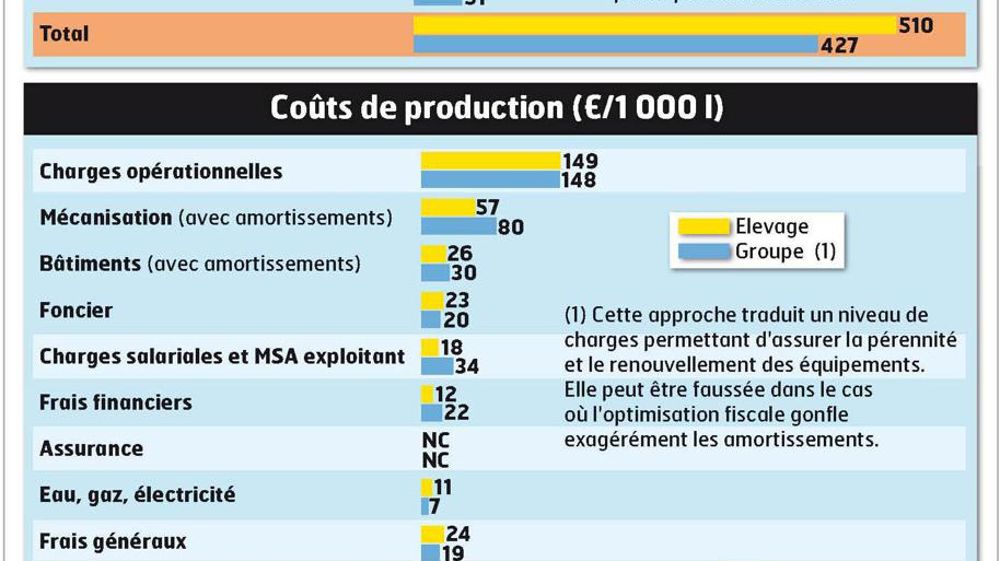
Installé en 2009 avec ses parents, Benoît Gavaland revoit la technique d'élevage des veaux pour allonger la durée de vie productive des animaux. Et il va rester vigilant sur les coûts de mécanisation.
NOTRE SYSTÈME DE PRODUCTION EST BASÉ SUR LES STOCKS, parce qu'avec les taurillons, nous avons besoin de beaucoup de fourrages », explique Benoît Gavaland. L'élevage laitier est donc conduit de manière intensive avec une ration à base d'ensilage (maïs et herbe) toute l'année. Les éleveurs implantent du ray-grass italien, éventuellement associé à du trèfle incarnat en couvert végétal entre les céréales et le maïs. Ces surfaces sont récoltées en ensilage d'herbe au début du printemps. Cependant, les prairies sont également pâturées au printemps et à l'automne. Les taurillons consomment les céréales de l'exploitation. Par ailleurs, la production de légumes a nécessité des investissements pour l'irrigation, dont le maïs profite. « On dispose de 70 ha irrigables, mais on n'arrose généralement que 28 ha », précise Benoît. Les canalisations enterrées sous pression facilitent le travail et l'arrosage demande moins d'une heure par jour. Le rendement en maïs monte ainsi à 15 t, contre à peine 10 t en sec.
« IL EST DIFFICILE DE RÉDUIRE LES ACHATS D'INTRANTS »
Ce système nécessite beaucoup d'intrants et peut difficilement être remis en cause sans modification profonde de l'effectif des animaux. Les vaches sont alimentées en ration semi-complète. Une partie du correcteur azoté et le concentré de production sont donnés avec le robot. La complémentation individuelle est systématique pendant les deux mois qui suivent le vêlage. Elle dépend ensuite du niveau de production. La consommation de concentrés devrait rester proche de 200 g/l de lait avec une production stabilisée autour de 8 200 l/vache.
Mais les éleveurs ont identifié d'autres pistes pour améliorer leur revenu. « Je me suis aperçu que la durée de vie productive des vaches est relativement faible, 28 mois, par rapport à la durée d'élevage des génisses, 31 mois », précise Benoît. Les vaches sont réformées après 2,3 lactations en moyenne.
Ces chiffres se situent dans la moyenne du département mais, pour Benoît, ils ne sont pas satisfaisants. L'éleveur souhaite améliorer ce poste en jouant sur la conduite d'élevage des génisses. « On doit pouvoir descendre à un âge moyen au vêlage de 27 ou 28 mois, même si les normandes sont moins précoces. » En perfectionnant la conduite des jeunes, il espère aussi faire vieillir ses vaches plus longtemps.
Pour y parvenir, Benoît s'est procuré, via sa coopérative, un planning circulaire d'élevage des veaux. Cet outil, conçu par la chambre d'agriculture du Finistère, détaille le rationnement jusqu'au sevrage.
« Nos vêlages sont étalés dans l'année. » Grâce au planning, la conduite a été rationalisée et chacun peut voir en un coup d'oeil les quantités de lait et de concentrés à donner à chaque veau. Tous consomment du colostrum au démarrage. Durant les premières semaines, quand les buvées sont en progression, les veaux reçoivent en priorité du lait en poudre afin d'éviter les diarrhées. Ensuite, ils consomment du lait entier, en fonction des disponibilités. Passé le sevrage, les veaux sont nourris au foin et au concentré. Au moment de l'insémination, les génisses reçoivent les refus des vaches laitières. « On cherche à enrichir la ration en énergie car on pense qu'ainsi, on voit mieux les chaleurs. »
Par ailleurs, une étable à génisses est en construction. Dès l'hiver prochain, toutes pourront rentrer alors qu'auparavant, certaines restaient dehors, faute de place. Tout ceci devrait favoriser la croissance des génisses. Benoît va les mesurer avec un ruban pour la surveiller. Il est encore trop tôt pour évaluer les résultats, mais les éleveurs sont confiants.
« IL FAUT MAÎTRISER LES INVESTISSEMENTS ET LA MÉCANISATION »
Ils explorent une autre voie pour sécuriser leur revenu. « Nous tenons à maîtriser les investissements », précise Benoît. Depuis son installation, l'effectif est passé de 35 à 57 vaches. Il a fallu construire un bloc pour la traite, une stabulation pour les génisses et une fosse à lisier. La salle de traite, une 2 x 5 en simple équipement âgée de vingt-huit ans, était trop juste. « Entre la construction d'une salle de traite neuve et l'installation d'un robot, l'écart de prix était minime, compte tenu de la maçonnerie. » Les éleveurs ont choisi le robot pour la souplesse. Il tourne à 80 %, ce qui permet le maintien du pâturage.
Par ailleurs, les éleveurs restent très vigilants sur les coûts de mécanisation. Dans ce domaine, les investissements concernent en priorité le matériel d'élevage : télescopique, pailleuse, mélangeuse, tracteurs. Ce matériel est soigneusement entretenu afin qu'il dure. Pour le reste, ils travaillent en Cuma. Elle emploie un salarié qui entretient le matériel, et conduit l'ensileuse et la moissonneuse. Pour les semis des céréales et l'ensilage, les adhérents s'organisent en banque de travail. Chacun possède un tracteur adapté au matériel de la Cuma. D'autres réflexions sont en cours. Le père de Benoît a 58 ans et va bientôt préparer son départ, même s'il ignore à quel âge il pourra faire valoir ses droits à la retraite. Il y a du travail pour trois et Benoît et sa mère n'ont pas encore tranché entre un nouvel associé et un salarié.
L'opportunité de produire davantage de lait est également une piste à l'approche. « Ce peut être un moyen pour optimiser le système, notamment pour mieux utiliser le robot », analyse Benoît. L'élevage dispose de places dans les bâtiments, mais la situation est plus tendue au niveau de la surface. Il est difficile d'intensifier davantage. Et la main-d'oeuvre risque alors de devenir le facteur limitant. Benoît envisage l'avenir avec optimisme. La fin des quotas et la volatilité des prix représentent des défis qu'il faudra relever. Le nécessaire respect de l'environnement continuera d'imposer ses contraintes. Mais l'augmentation de la population mondiale crée des besoins élevés en nourriture et consolide l'avenir des éleveurs.
P. LC.
- L'EXPLOITATION - À Lusanger (Loire-Atlantique) - Gaec à trois associés (parents et fils) - 420 000 l de quota - 57 vaches , dont 80 % de prim'holsteins et 20 % de normandes - 150 taurillons produits par an - 125 ha , dont 40 ha en maïs ensilage, 45 ha en céréales (25 ha autoconsommés), 10 ha de légumes, 8 ha de trèfles en multiplication et 12 ha de prairies temporaires 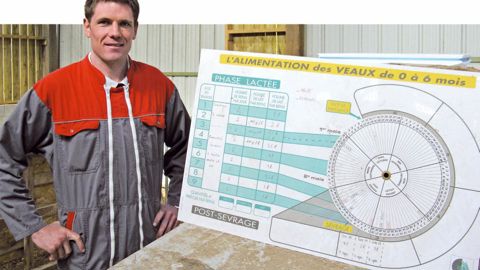




Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
Le bale grazing à l’essai
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »
Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs