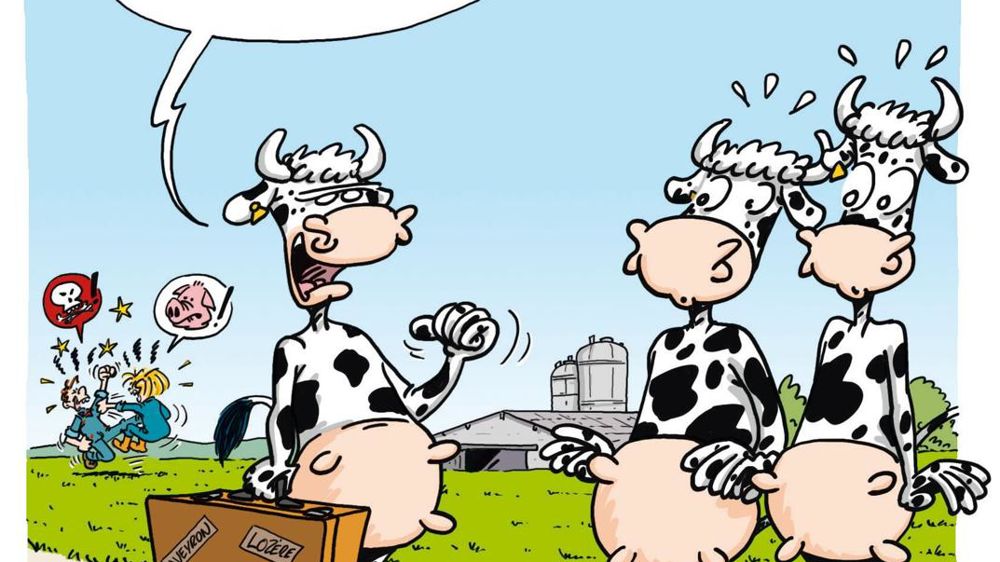
La dissolution du mariage entraîne sa liquidation. Il s'agit alors d'effectuer le partage des biens en calculant les éventuelles compensations financières entre époux.
LE PARTAGE S'OPÉRERA DE MANIÈRE DIFFÉRENTE suivant le régime matrimonialchoisi par les époux. Il existe quatre régimes : la communauté réduite aux acquêts dit régime légal, la séparation de biens, la participation aux acquêts, et la communauté universelle. Nous n'évoquerons que les deux régimes les plus répandus, à savoir la communauté légale et la séparation de biens.
1)COMMUNAUTÉ DE BIENS
Également appelé « régime légal », il s'applique à tous les époux qui n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage et qui se sont mariés depuis le 1er février 1966. Il concerne 80 % des couples mariés. C'est le plus rencontré dans le milieu agricole
Détermination des biens propres et des biens communs
Ce régime de communauté repose sur la coexistence de trois masses de biens : les biens propres de Madame, ceux de Monsieur et les biens communs du couple. Les biens propres sont constitués principalement de tout ce que chacun des époux possédait avant le mariage, ou qu'ils ont reçu par héritage ou donation pendant le mariage. « Chacun est libre de gérer ses biens propres comme il l'entend sans que son conjoint ne puisse interférer. Les biens propres ne sont pas concernés par le partage au moment du divorce. Ils restent la propriété de celui qui les a acquis », indique Julien Dervillers, avocat en droit de l'entreprise agricole à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Par exemple, les parts sociales dans une société agricole qu'un époux a acquise avant de se marier constituent des biens propres sur lesquels le conjoint n'aura aucun droit en cas de séparation. De même, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre sont considérés comme des biens propres. Dans l'hypothèse d'une exploitation agricole en propre, le cheptel acquis pendant le mariage pour les besoins de l'exploitation sera considéré comme un bien propre.
Les biens communs sont tous ceux qui ont été acquis pendant le mariage par les conjoints ensemble ou séparément. « Il en résulte qu'une exploitation agricole créée ou acquise pendant le mariage et les revenus qu'elle génère sont des biens communs », précise l'avocat : par exemple, la constitution d'une structure sociétaire et la reprise de biens agricoles financés avec des biens communs.
En revanche, l'élevage acheté après le mariage avec des fonds propres est un bien propre, à condition d'avoir pris le soin de faire, dans l'acte de vente, une déclaration de remploi de biens propres. En clair, il s'agit de déclarer que l'acquisition se fait avec un financement issu de biens propres (constitués avant le mariage, ou reçus par succession ou donation pendant le mariage). En revanche, les produits de ce bien propre, c'est-à-dire les revenus, sont des biens communs.
La catégorie des biens communs inclut notamment :
- les gains et salaires,
- les biens acquis au moyen des gains et salaires,
- les comptes bancaires, même s'ils sont ouverts au nom d'un seul des époux, à partir du moment où ils ont été ouverts ou alimentés pendant le mariage,
- les fruits et revenus des biens communs (loyers...),
- les fruits et revenus des biens propres (revenus d'une exploitation agricole appartenant en propre à l'un des époux...),
- les parts sociales acquises au moyen de sommes communes.
En cas de rupture, les biens communs sont séparés en deux parts égales.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux se répartissent amiablement les biens communs. Dans les autres cas, le juge, au moment où il prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage des biens et des dettes, et peut désigner un notaire pour ce faire. L'intervention de ce dernier est obligatoire en cas de partage de biens immobiliers. « Si l'exploitation agricole est un bien commun, même si elle est exploitée par un seul des époux, elle doit être, en théorie, partagée pour moitié entre les deux, ce qui peut conduire à sa disparition », note l'avocat.
Pour éviter ce partage par moitié, trois solutions sont envisageables.
Vente de l'exploitation agricole
C'est l'hypothèse la plus souvent redoutée car elle prive l'un ou les époux de l'outil de travail. Elle consiste à mettre en vente l'élevage et à répartir le prix de vente pour moitié entre les époux. C'est le cas si la femme et le mari souhaitent se voir attribuer une exploitation commune, et que personne ne cède. Ou encore l'hypothèse où l'un des deux souhaite conserver l'entreprise, mais n'a pas les moyens de désintéresser l'autre de la moitié de la valeur de l'exploitation attribuée. « Ce sont des cas sanglants où la vente du bien commun s'impose pour permettre le partage en numéraire », explique Julien Dervillers. En général, une négociation reste possible car la vente de l'exploitation n'est pas spécialement productive. En effet, certains droits incorporels (baux ou droits à produire) ne sont pas inclus dans la vente, ce qui réduit la valeur économique de l'exploitation.
L'attribution préférentielle à l'un des époux moyennant une soulte
C'est une solution pour éviter la vente de la ferme. L'un des époux peut demander au juge que l'exploitation agricole, ou tout autre bien commun, lui soit attribuée exclusivement.
Si cette attribution préférentielle rend le partage inégal, le bénéficiaire devra payer à l'autre une soulte, c'est-à-dire une somme d'argent destinée à compenser le fait qu'il a perçu une part plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Le montant de la soulte est fixé par le juge aux affaires familiales, à dire d'expert s'il n'y a pas d'accord sur la valeur de l'exploitation. « Cette solution suppose que l'époux qui se voit attribuer préférentiellement l'exploitation dispose des ressources nécessaires au paiement d'une telle somme », explique l'avocat.
À défaut, le bien devra être vendu et le prix réparti entre les époux, à moins qu'ils décident de rester dans l'indivision.
Le maintien dans l'indivision
Pour sauver la ferme, les époux peuvent décider de demeurer dans l'indivision. Cette solution n'est pas sans risque puisque la gestion de l'indivision suppose l'accord des deux co-indivisaires pour toutes les décisions importantes. « Cela reste exceptionnel mais possible, si le divorce n'est pas trop contentieux, et que les époux sont d'accord pour garder ensemble la propriété du bien commun, le temps, par exemple, que l'exploitation soit cédée, ou que l'un des conjoints se soit constitué des réserves suffisantes pour racheter la part de son ex-conjoint », précise l'avocat. C'est l'une des modalités de l'accord entre les époux qui, au-delà des risques, devront bien s'entendre.
2)SÉPARATION DE BIENS
Environ 10 % des couples mariés le sont sous le régime de la séparation de biens. Même si ce régime matrimonial reste beaucoup moins répandu que la communauté légale, de plus en plus de couples agricoles optent pour ce statut car il est plus protecteur des intérêts de chacun, notamment vis-à-vis des créanciers.
Des biens propres et des biens indivis
Dans ce cas, il n'existe que deux masses de biens propres, ceux de Madame et ceux de Monsieur. Il n'existe donc pas de biens communs. Chacun des époux reste propriétaire de tous les biens acquis personnellement avant ou pendant le mariage, quel que soit le mode de financement de l'opération. Le bien appartient à celui qui justifie d'un titre de propriété.
Cependant, en pratique, la femme et son mari achètent souvent ensemble pendant le mariage des biens qui sont alors qualifiés de biens indivis (logement, véhicule, etc.). Les biens indivis comprennent également les biens dont aucun des époux ne peut justifier de la propriété. Dans ce cas, ils sont réputés appartenir à chacun pour moitié, la preuve contraire pouvant être rapportée par tous moyens.
Liquidation et partage des biens indivis
Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens indivis, lequel peut se faire soit à l'amiable, soit par voie judiciaire. Comme pour le régime légal, il est possible d'avoir recours à des attributions préférentielles pour pouvoir se répartir les biens indivis sans avoir à les vendre.
Des difficultés peuvent survenir si l'un des conjoints s'estime lésé parce qu'il a utilisé ses propres fonds pour financer un bien dont son conjoint est seul propriétaire.
Par exemple, l'épouse a financé des travaux sur la maison appartenant à son mari.
Dans cette hypothèse, le conjoint lésé est titulaire d'une créance à l'encontre de l'autre, à condition de prouver que c'est bien lui qui a financé les travaux litigieux et qu'il n'était pas animé par l'intention de le gratifier. Une créance peut être reconnue pour celui qui a financé avec ses biens propres, un bien commun, voire qui a accepté le financement d'un bien propre de l'autre époux. Dans ce cas, c'est toujours le juge aux affaires familiales, dans le cadre du divorce et en s'appuyant sur des experts si nécessaire, qui fixera le montant de ce que l'on appelle les « récompenses », lesquelles seront intégrées par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation.
« On comprend dès lors que la simplicité du régime de la séparation de biens n'est qu'apparente et peut donner lieu à de nombreuses difficultés au moment de la liquidation », constate Julien Dervillers
De plus, un époux peut s'estimer lésé parce qu'il a participé bénévolement au fonctionnement ou au développement de l'exploitation agricole appartenant à son conjoint, sur laquelle il n'a absolument aucun droit.
En pratique, il s'agira le plus souvent de l'épouse qui, en dehors de son activité professionnelle, participe aux travaux de la ferme dont son conjoint est le seul propriétaire. Au moment de la dissolution du mariage, elle ne peut alors invoquer aucune créance à l'encontre de son époux, à défaut d'avoir financé l'entreprise. Elle ne peut pas revendiquer une partie de l'exploitation de son mari. Si les patrimoines des deux époux sont sensiblement déséquilibrés et que le divorce risque d'entraîner une importante disparité dans leur niveau de vie, au moment du prononcé du divorce, le juge pourra condamner l'époux à payer une prestation compensatoire (voir encadré ci-contre). Elle dépendra de la nature et l'importance des tâches accomplies, de la taille de l'exploitation, de la fortune du conjoint débiteur de la prestation, et de celle de l'époux créancier de la prestation. « Si les revenus de l'époux restant sur l'exploitation sont bien plus élevés que ceux de celui qui la quitte à l'occasion du divorce, alors que ce dernier a travaillé sur l'exploitation, l'a enrichie et en tirait indirectement ses revenus, ce dont il sera désormais privé, il a droit à une prestation compensatoire, fixée par le juge aux affaires familiales, au cas par cas », explique Julien Dervillers.
« Si l'exploitation est un bien commun, elle doit être partagée, ce qui peut conduire à sa disparition. » Julien Dervillers, avocat à Rennes (Ille-et-Vilaine)




God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Le bale grazing à l’essai
Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »
Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité