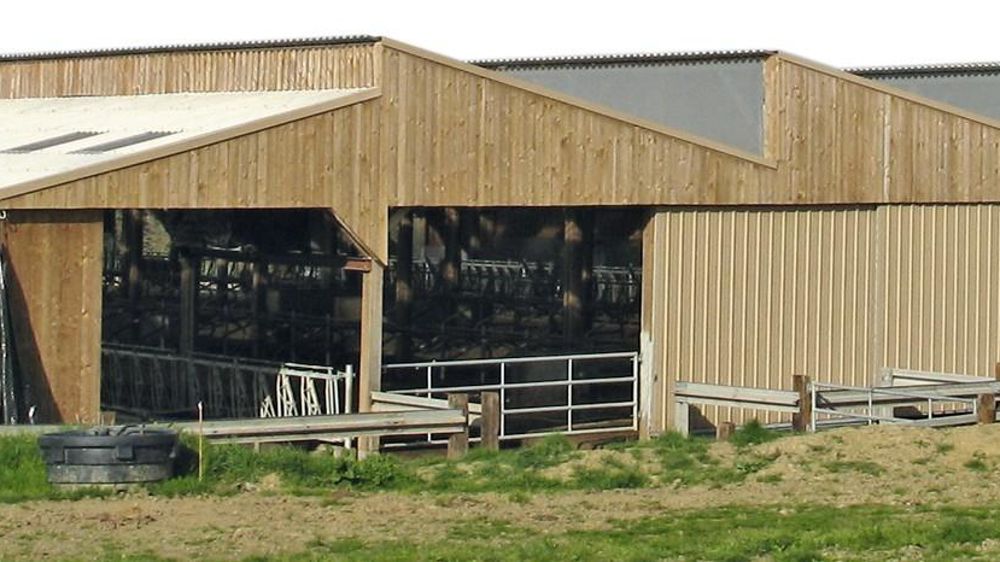
Construire un bâtiment aujourd'hui implique de se projeter dans un monde sans quotas. Tous les repères bougent, mais la structure devra suivre et rester fonctionnelle.
LA DISPARITION DES QUOTAS MODIFIE PROFONDÉMENT la manière de percevoir les projets, notamment en matière de bâtiment. Le volume des livraisons et donc la taille du troupeau ne dépendront plus de l'administration. L'éleveur pourra avoir des opportunités de développement et les bâtiments ne doivent pas représenter un handicap. Ceux qui conçoivent leurs investissements aujourd'hui ont donc tout intérêt à envisager au minimum le doublement de leur troupeau. « Certains éleveurs n'hésitent pas à nous demander de réfléchir à une multiplication par quatre du nombre de leurs animaux », précise David Pichot, chez Eilyps (OCL Ille-et-Vilaine).
Mais nombreux sont aussi ceux qui n'envisagent pas de croissance importante. Cela n'empêche pas de prévoir. « Un certain nombre d'exploitations a doublé sa production depuis une dizaine d'années, presque sans s'en rendre compte », remarque Julien Hamon, également technicien en bâtiment chez Eilyps. Les projets de construction doivent avoir quinze ans d'avance. On s'accommode plus facilement d'un espace trop grand que trop petit. Leur conception et leur disposition dans l'espace doivent permettre des évolutions.
Il faut aussi penser à la main-d'oeuvre. La tendance est à l'agrandissement des troupeaux avec des éleveurs qui gèrent plus d'animaux qu'avant. Un bâtiment conçu pour réduire la pénibilité du travail est plus attractif. Les élevages équipés de robots attirent les salariés. Et lors de la vente éventuelle, un bâtiment évolutif sera plus attrayant.
Les étables doivent néanmoins rester cohérentes avec l'effectif du moment et la capacité économique qui en dépend. « La première contrainte est toujours économique », affirme Julien Hamon. Il faut donc prévoir d'abord de la place pour l'existant.
Le type de bâtiment dépend aussi du système de production qui conditionne le temps passé à l'intérieur par les animaux. « Techniquement, tout peut fonctionner », précise Julien. Chacun a ses préférences.
L'une des règles pour ne pas pénaliser les évolutions futures est de ne jamais condamner les extrémités. Attention aux ouvrages de stockage situés directement à la sortie.
La localisation du bloc de traite doit aussi être pensée en fonction d'une évolution du bâtiment. En cas de forte hausse de l'effectif, la tendance va à la spécialisation des bâtiments. On construit des modules de logement pour 100 vaches avec un bloc de traite à part. C'est ce qui se fait dans les pays laitiers qui disposent de grandes structures. Il faut donc prévoir cette évolution en imaginant l'emplacement des différents modules : le logement des vaches, celui des génisses, le bloc de traite, les stockages, la circulation... « Penser à ce genre d'évolution n'amène pas de surcoût dans la construction, mais peut générer les économies dans le futur puisque le bâtiment existant continuera de servir », précise Julien Hamon.
Pour l'heure, la tendance reste à des bâtiments compacts abritant l'essentiel du troupeau. Mais en fonction de l'effectif, cette pratique peut conduire à des bâtiments très longs pouvant se situer à la limite de la capacité des racleurs.
LOGEMENT : UNE LOGETTE PAR VACHE
L'aire paillée montre ses limites vers 80 à 90 vaches. La charge de travail est trop lourde et il devient difficile de garder un bon état sanitaire. Au-delà de cet effectif, on peut théoriquement aménager plusieurs espaces dans l'aire paillée en vue d'une conduite en lots. Dans les faits, ce type de conduite est rare. Le mode de constitution des lots n'est pas évident avec des troupeaux qui restent de taille modeste.
Il est facile de transformer une aire paillée pour créer des logettes. Cela limite l'investissement de départ. La maîtrise sanitaire est plus simple en logettes. Mais attention, il faut prévoir un minimum d'entretien quotidien. Ce travail devient vite fastidieux avec la multiplication des animaux. D'où l'opportunité de réfléchir à une mécanisation de cette tâche. Des automates de nettoyage de logettes coûtent environ 15 000 €.
Le choix du revêtement dépend des préférences de l'éleveur. Tous les systèmes présentent des avantages et des inconvénients. Les logettes creuses sont confortables et économiques, mais exigent de l'entretien. Les matelas sont confortables aussi, mais plus chers. Les logettes paillées conviennent si l'élevage produit de la paille et accepte de gérer du lisier pailleux. Certains optent pour le lisier composté dans les logettes. « Ce système est confortable, mais on manque de recul pour l'apprécier sur le plan sanitaire », précise Julien Hamon.
Le nombre de logettes doit, selon lui, être au moins égal à celui des vaches. « Je ne crois pas à la théorie qui suppose que lorsque les vaches ne sortent pas, elles ont des cycles différents étalés sur 24 heures qui permettent de se passer d'une place par animal à l'auge ou au couchage. Dans les élevages équipés de robot de traite, on voit moins d'effets de masse dans les comportements du troupeau. Néanmoins, on constate qu'il y a des moments où toutes les vaches se reposent. » Le nombre de logettes peut être supérieur à l'effectif d'environ 10 % au départ, pour tenir compte des évolutions possibles des livraisons à court terme.
Soulignons que cette position s'oppose aux pratiques courantes dans les élevages de quelques centaines de vaches d'Europe du Nord. Il n'est pas rare qu'ils fonctionnent avec 65 places pour 80 vaches, à l'auge comme en logettes, dans des systèmes sans pâturage.
ALIMENTATION : DE LA PLACE POUR TOUS
La conception de certains bâtiments complique la réalisation d'une place à l'auge par vache. C'est le cas notamment avec trois rangs de logettes et une table d'alimentation sur toute la longueur. La question du nombre de places à l'auge se pose surtout avec un système de traite traditionnel, selon Julien Hamon. « Toutes les vaches vont manger après la traite et il est important qu'elles puissent le faire », souligne-t-il. Ceci est d'autant plus nécessaire quand elles reçoivent un peu d'ensilage avant d'aller pâturer. Quand la taille des troupeaux augmente, les phénomènes de concurrence entre animaux ont tendance à s'accentuer. Si les vaches les plus faibles n'ont pas une place à l'auge, elles ne mangeront pas suffisamment. C'est particulièrement problématique pour les primipares en début de lactation.
Avec une traite robotisée, les cycles des animaux sont un peu moins uniformes. Il devient donc possible de fonctionner avec un peu moins d'une place par vache à l'auge.
Se pose aussi la question de l'équipement à l'auge. Le cornadis est-il indispensable, ou la barre au garrot peut-elle suffire ? Julien conseille le cornadis. « Il faut pouvoir bloquer les vaches à tout moment. » L'écart de prix se limite à 35 €/place entre les deux dispositifs.
TRAITE : GÉRER LA MAIN-D'OEUVRE
Le bloc de traite est un poste difficile à faire évoluer en raison de l'importance de la maçonnerie. Entre la salle de traite classique (épi, TPA ou rotative) et le robot, le choix se fait d'abord en fonction de la main-d'oeuvre. Une salle de traite peut s'adapter à une hausse d'effectif, à condition d'allonger le temps de traite. La plupart des grands pays laitiers font appel à de la main-d'oeuvre étrangère pour la traite. Quelles sont les opportunités en France pour déléguer cette tâche ? La réflexion ne fait que commencer, mais le secteur laitier est sans doute à la veille d'une rupture. À chacun de voir en fonction de son propre contexte.
Le robot de traite offre davantage de souplesse sur le plan de la main-d'oeuvre. Mais il se révèle moins évolutif car il ne permet que des croissances par paliers. « L'élevage doit pouvoir changer d'orientation en matière d'équipement de traite sans compromettre ce qui existe pour le reste (logement, stockage...) », conseille Julien Hamon.
VENTILATION : PENSER À L'ÉTÉ
Avec des troupeaux plus grands et des temps de présence dans les bâtiments plus importants, la gestion de la ventilation devient cruciale, notamment en été. Quatre rangées de logettes impliquent une largeur de 30 m au moins, et certains projets comportent six rangs de logettes. La ventilation doit permettre de renouveler l'air et d'assécher le bâtiment en hiver alors qu'en été, il s'agit de réduire la température. Sans oublier que les vaches craignent l'humidité et qu'il faut assurer une bonne luminosité.
L'ouverture de la faîtière est indispensable pour permettre une sortie d'air. Des entrées latérales relais doivent être aménagées à intervalles réguliers. « L'idéal est de pouvoir ouvrir le bâtiment », insiste Julien Hamon. Les bardages en bois, économiques et appréciés des éleveurs qui peuvent les poser eux-mêmes, présentent l'inconvénient d'être fixes. Or, les panneaux amovibles, en filet brise-vent ou autres, sont intéressants pour ouvrir en été.
La circulation de l'air dans le bâtiment est liée au site, à l'exposition par rapport aux vents dominants. Elle s'étudie au cas par cas.
SOLS : ÉVACUER L'HUMIDITÉ
L'enjeu est de mettre en place des sols faciles à garder secs afin d'améliorer la santé des pieds. Les caillebotis sont performants sur ce plan, mais ils sont plus chers. Le béton fonctionne bien aussi. La tendance est à la création d'une pente pour favoriser le drainage. 1 % suffit et cela ne gène pas le racleur. Il ne faut pas hésiter à racler souvent pour garder un sol sain, jusqu'à cinq ou six fois par jour. Les tapis donnent satisfaction. Le choix se fait aussi en fonction du prix.
STOCKAGE DES EFFLUENTS : PENSER AUX CIRCUITS
La plupart des éleveurs qui investissent aujourd'hui préfèrent travailler avec du lisier. Les raisons sont essentiellement d'ordre pratique. Cette filière est facile à automatiser et à déléguer. Le fumier demande davantage de manipulation et donc de main-d'oeuvre.
Mais il se révèle plus intéressant sur le plan agronomique. Cette option exige d'investir dans des plateformes de stockage de surface importante avec de grands volumes d'eau de pluie à collecter.
La localisation de la fosse, ou de la fumière, conditionne la capacité d'évolution du site. Il faut donc penser, à ce stade, aux circuits des hommes, des animaux et des produits (effluents, fourrages, lait...). Pour des raisons évidentes de bon sens, ces différents circuits ne doivent pas se croiser.
En lisier, le choix s'opère d'abord entre les fosses en béton et engéomembrane. « L'entrée est économique, les deux fonctionnent bien. » La géomembrane coûte deux fois moins cher, mais il faut prévoir des plates-formes de malaxage.
Ensuite, l'essentiel est de positionner la fosse d'une manière qui ne bloque pas les évolutions. Des systèmes de transfert permettent de la décaler par rapport à l'axe du bâtiment afin de ne pas interdire son éventuel allongement. Il existe deux solutions. La construction d'une préfosse en béton au bout du bâtiment. Elle sera vidangée vers la grande fosse environ une fois par semaine par gravité ou à l'aide d'une pompe, en fonction du dénivelé. On peut aussi installer un canal à lisier flottant. Il s'agit d'un tuyau de 80 cm de diamètre dans le fond duquel se trouve de l'eau. Le lisier tombe dans ce tuyau et glisse sur l'eau vers la fosse.
Dans les deux cas, l'installation est légère et permet de guider le lisier vers la fosse. On peut facilement les protéger pour passer dessus en tracteur. Et elles ne bloquent pas l'extension du bâtiment.
De nouveaux arrêtés sont attendus fin 2013 dans le cadre de la directive nitrates. Ils pourraient modifier les exigences en termes de capacité ou demode de stockage. L'autre inconnue en matière de réglementation environnementale concerne les gaz à effet de serre. L'élevage est responsable de 98 % des émissions d'ammoniac et leur réduction est clairement sur la table.
PASCALE LE CANN

Pour alléger les coûts, les tables d'alimentation sans cornadis peuvent être préférées. Il faut alors penser à une autre solution pour bloquer les vaches.




Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?
God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Le bale grazing à l’essai
Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »
Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »