
Énergie. Des vaches qui pâturent sous des panneaux solaires feront peut-être partie demain du paysage. Les références technico-économiques manquent aujourd’hui.
Moins dépendre des énergies fossiles et nucléaires en développant le renouvelable est le défi que se doivent de relever la France et les pays gros consommateurs. Depuis plusieurs mois, l’agrivoltaïsme fait partie des nouveaux mots à la mode. Traduisez des parcs photovoltaïques installés au sol, couplés à l’activité agricole en place. « Répondre à l’objectif français de 44,5 gigawatts de capacité photovoltaïque en 2028 suppose de couvrir entre 20 000 et 40 000 ha de surfaces agricoles, soit 0,1 % de la SAU française. On est en loin : environ 500 ha », indique Jérôme Pavie, qui suit ce dossier pour l’Institut de l’élevage (Idele).
En élevage ruminant, ces centrales photovoltaïques sont associées au pâturage des animaux. Les panneaux, à quelques mètres du sol, créent de l’ombre aux bovins ou ovins qui pâturent le couvert et les protègent du stress thermique en cas de fortes chaleurs. Selon la technologie solaire utilisée, la densité des panneaux dans la parcelle, la proximité du raccordement au réseau et la surface du projet, l’investissement pourrait varier entre 0,65 et 1,30 M€/ha (source : Davele). « À raison d’un mégawatt sur 1 à 2 ha, le réseau classique ne peut pas accueillir l’électricité produite. Elle doit rejoindre un point de délestage. Il faut compter 100 000 à 150 000 € par kilomètre de tranchée », complète Jérôme Pavie. Idele est en partenariat avec douze entreprises pour 35 conceptions de projets, dont un tiers en bovin, de quelques à plusieurs dizaines d’hectares. « Plusieurs modèles économiques sont proposés aux agriculteurs. » Le projet peut reposer sur la location du terrain agricole, avec un versement d’un loyer au propriétaire en contrepartie d’un bail emphytéotique de 30 ans et avec une rémunération de l’exploitant pour dédommagements et services rendus. « La rémunération ne doit pas induire de spéculation foncière », précise Jérôme Pavie. Le projet peut aussi être une coconstruction entre l’agriculteur et le développeur. Dans ce cas, l’agriculteur participe au financement.
Des minima techniques fixés par Idele
L’agrivoltaïsme en élevage bovin fait ses tout premiers pas et souffre d’un manque de connaissances techniques. Les premiers conseils d’Idele sont tirés des observations réalisées autour de plusieurs centrales en élevage ovin. « Plus le sol est couvert de tables photovoltaïques (assemblages de panneaux), plus il y a des pieux de fixation, plus est basse la hauteur entre le sol et le point le plus bas des équipements, et moins sera facile la cohabitation entre les animaux et l’infrastructure. » Il faut en effet permettre aux bovins de circuler aisément et éviter des blessures par des tables trop basses et des coins contondants. De même, il faut que les engins puissent circuler entre les tables pour effectuer un entretien mécanique de la prairie (fauche) et si besoin un sursemis. Dans ce but, Idele déconseille les tables fixes bipieux et recommande celles monopieux, espacées de minimum quatre mètres pour le passage du matériel. « Pour les bovins adultes, nous recommandons un minimum de 2,20 à 2,40 m entre le sol et le point le plus bas de l’installation. En dessous, ils buteront dessus, en cas de chevauchement, notamment. »
Une canopée solaire testée dans un élevage laitier du Calvados
Idele regarde avec intérêt la canopée photovoltaïque que le groupe TSE veut tester. Un projet est dans les tuyaux dans un élevage laitier à Saint- Ouen-des-Besaces (Calvados). Il n’en est qu’au stade des démarches administratives. Des grands câbles tenus par des pylônes espacés de 27 m supporteront les panneaux dont le point le plus bas sera à 5 m du sol. Ces panneaux sur trackers surélevés seront mobiles et suivront le soleil. « L’ombre tournante créée permettrait d’avoir une pousse d’herbe plus lissée. »
« Lorsque le projet sera sorti de terre, nous mettrons en place avec Idele et l’éleveur un protocole de comparaison, annonce de son côté Marie Belingard, de TSE. Nous constituerons deux lots de vaches, l’un au pâturage sous 3 ha d’ombrière, l’autre également sur 3 ha en pâturage classique, pour mesurer leur bien-être, leurs performances et celles des prairies. L’investissement est d’environ 1 M€/ha. »
En ombre fixe, quelques suivis de biomasse sous les panneaux montrent la création d’un microclimat aux effets négatifs en déficit hydrique estival modéré, positifs en déficit marqué. « Beaucoup d’interrogations subsistent, reprend Jérôme Pavie. Quelle est l’incidence de l’ombre sur la production de biomasse ? Quelle est l’évolution de la flore sous les panneaux ? Laquelle faut-il privilégier ? » De même, l’incidence sur la production des vaches et leur santé est méconnue, dont celle des ondes électromagnétiques.
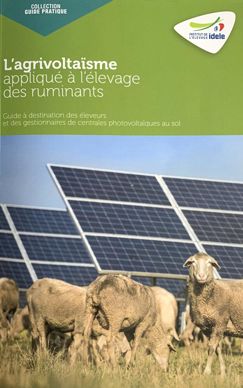




Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »