
La ferme de Merval a développé un système efficient et économe pour rémunérer tous les facteurs de production dont les nombreuses heures de travail salarié.
Malgré la crainte pour l’image du lycée et le recrutement des élèves, la ferme de Merval, en Normandie, a opéré un choix de rupture en transformant son système classique maïs-herbe en un 100 % herbe autonome et économe. « Au-delà de la certification bio obtenue en 2017, c’est notre système tout herbe qui intéresse les crémiers fromagers qui achètent notre Cœur de Neufchâtel AOP à un prix plus rémunérateur », pointe Bertrand Cailly, le directeur de l’exploitation.
Alors que le troupeau de normandes passait de 75 à 115 vaches, et que le taux de renouvellement tombait de 50 à 22 %, les charges opérationnelles étaient réduites drastiquement. Elles se situent désormais entre 12 à 15 % du produit brut. N’utilisant aucun engrais minéral, la ferme limite au maximum les achats de concentrés. Cette année, les 115 normandes ont pâturé 270 jours et nuits sans concentré ni fourrage complémentaire. En période hivernale, elles ont consommé 80 kg seulement d’aliments pour un coût de 22 € par vache et par an. Les taureaux de monte naturelle se sont substitués à l’insémination, l’écornage des animaux a été arrêté. « Outre des économies substantielles, nous avons amélioré nos résultats de reproduction (1), et nous nous sommes simplifié la vie en conservant les échographies », précise Bertrand Cailly.
Les vaches pâturent sous les pommiers et fertilisent le sol par leurs bouses
La transition agroécologique tranchée a été opérée sans dogmatisme, avec une priorité : la préservation d’une cohérence globale et l’optimisation des interactions entre les différents ateliers, lait, vergers, ruchers, agroforesterie, qui sont aujourd’hui nombreuses : les vaches pâturent sous les vergers qu’elles fertilisent avec leurs bouses et leur fumier. Le lactosérum est testé comme solution de biocontrôle sur les pommiers pour lutter contre les maladies fongiques. Le bois plaquette issue de la taille des haies et des vergers est utilisé pour la litière des animaux. Une partie des effluents d’élevage est compostée avec les plaquettes de bois pour élaborer un mulch qui est valorisé sous les pommiers. Les 30 ruches pollinisent les vergers et produisent du miel vendu en direct. « Nous nous inscrivons dans une économie circulaire, commente Bertrand Cailly. Les interactions techniques apportent des interactions humaines, ce qui renforce l’efficacité et la résilience du système. » En 2018, un projet agro-arbo-apiforesterie intraparcellaire a été lancé sur 17 ha pour combiner élevage, céréales ou oléo-protéagineux, production fruitière et essences mellifères.
Accompagné de modifications organisationnelles (décloisonnement des différents ateliers de l’exploitation), le changement de cap a eu des résultats positifs sur les comptes de l’exploitation. Les performances des vaches sont moins élevées (4 400 litres de lait par an au lieu de 6 500 litres initialement), mais les marges sont supérieures ( 1 938 € de marge brute par vache en 2021). Économiquement, la ferme fonctionne bien, ce qui n’était pas le cas par le passé. « Malgré des résultats techniques bons, l’exploitation ne dégageait pas de CAF (capacité d’autofinancement), précise Bertrand Cailly. Le but de l’atelier lait était de fournir une quantité de lait “quoi qu’il en coûte” pour rationaliser le travail en fromagerie. Malgré l’AOP, le réseau de commercialisation des fromages ne valorisait pas à sa juste valeur le travail. Les achats de concentré, minéraux et levures (non OGM, cahier des charges AOP oblige) oscillaient entre 55 000 et 80 000 € par an. La cidrerie était un atelier chroniquement déficitaire. Les comptes étaient tendus et il était difficile d’investir et de rémunérer l’ensemble des facteurs de production, dont la main-d’œuvre. » À l’exception du directeur, rémunéré par l’État comme tous les lycées agricoles, les neuf salariés de l’exploitation, embauchés sur la base d’un contrat de 35 heures, doivent être financés par la seule activité agricole, tout comme les investissements en bâtiment et matériel autofinancés ou couverts par des emprunts. Contrairement à d’autres établissements, la ferme de Merval ne bénéficie d’aucune aide financière des collectivités.
« Que le coût de la tonne d’azote ou de concentré flambe ne nous concerne plus ! »
Aujourd’hui, la nouvelle conception du système de production est considérée comme un succès. « Notre exploitation laitière bénéficie d’une vraie crédibilité professionnelle et a gagné en attractivité auprès des jeunes, futurs installés, souligne notre interlocuteur. Aller chercher de la valeur ajoutée pour mieux rémunérer la main-d’œuvre et améliorer les conditions de travail sur l’exploitation contribue à donner une image plus attractive de l’agriculture. Un week-end sur deux payé au Smic, ça ne fait plus rêver. La stratégie “maxipâturage et minicharges opérationnelles”, la recherche de valeur ajoutée par la transformation, couplée à un prix de cession interne de 550 € aux 1 000 litres de lait est une démarche qui peut être controversée, mais des résultats sont là. Sur le plan environnemental, la ferme stocke plus de carbone qu’elle n’en produit et la sobriété énergétique dont on parle aujourd’hui a été intégrée il y a déjà six, sept ans. Que le coût de la tonne d’azote ou du concentré flambe ne nous concerne plus. »
Pour le responsable de la ferme de Merval, la transition agroécologique implique de s’adapter à son contexte, en sachant qu’il n’est pas possible de tout montrer ou de tout faire sur une exploitation. « On risque des incohérences en matière de fonctionnement global. Mieux vaut faire des choix tranchés, cohérents économiquement et socialement, en les assumant. Si l’on ne part que sur des objectifs pédagogiques tels que cultiver 10 ha en bio à côté d’un système intensif à la vache, on risque l’échec : l’efficacité ainsi que l’implication des acteurs feront défaut. »
(1) IVV : 371 jours
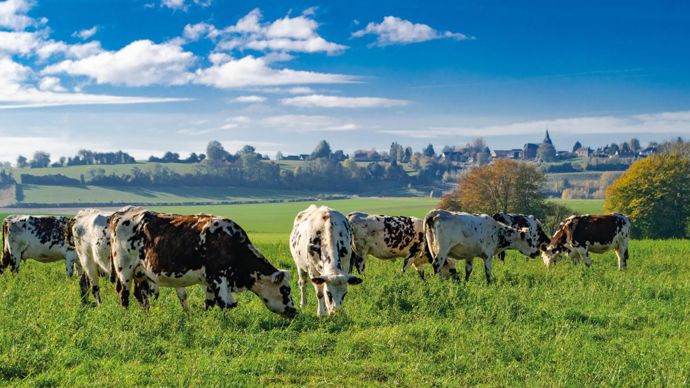





Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?