
En Savoie, dans la Haute-Maurienne,l’été, alors que les troupeaux pâturent les estives d’altitude, l’arrosage, réservé aux meilleures parcelles de la vallée, sécurise la production des petites prairies.
En Haute-Maurienne, zone la plus sèche de la Savoie, les réseaux d’irrigation collectifs sont créés ou agrandis avec le soutien des collectivités locales. Il s’agit de renforcer l’autonomie fourragère des exploitations et de pérenniser l’agriculture.
Ces démarches s’accompagnent d’une restructuration du foncier (remembrement, échanges parcellaires), d’une organisation technique sous forme d’association d’irrigants et d’un travail pour économiser la ressource en eau. En témoigne l’expérience des agriculteurs de Sollières-Sardières et de leur GIEE (Groupement d’intérêt économique et environnemental) : Eau’ptimiser l’irrigation des prairies.« Alors qu’en plaine, l’irrigation est souvent conçue comme un outil d’intensification, chez nous, en haute montagne, c’est un moyen de lutte contre la sécheresse et un levier pour préserver la diversité floristique des prairies, indispensable à la qualité de nos fromages », pointent Claude Favre et Coralie Petitqueux, respectivement président de la Coopérative laitière Haute-Maurienne Vanoise et chargée de mission irrigation et foncier au Gida(1). Dans cette vallée encaissée très ventée, faiblement arrosée et aux sols sableux, il ne s’agit pas d’irriguer des prairies temporaires pour les retourner tous les trois ans, mais de sécuriser un minimum de tonnage et de préserver la résilience des prairies. Ainsi, en août 2019, mois très chaud, l’irrigation n’a pas empêché les volumes de chuter de moitié sur la seconde coupe, mais elle a préservé le potentiel fourrager.
75 % d’autonomie fourragère obligatoire, au moins
En zone beaufort AOP, où le cahier des charges impose qu’au minimum 75 % des besoins en foin-regain et pâture du troupeau proviennent de l’aire géographique, les exploitations ont l’obligation d’être autonomes en fourrages. Or, les sécheresses successives subies depuis 2003 et l’accélération du changement climatique fragilisent les systèmes fondés exclusivement sur l’herbe. En assurant un minimum hydrique aux parcelles à fort potentiel sur 3 à 5 % de la SAU, l’irrigation est devenue un élément de survie des exploitations laitières AOP. L’eau permet de limiter les pertes de rendement des prairies, mais aussi d’améliorer le tonnage moyen récolté (+ 2 tMS/ha minimum ce qui permet de rentrer jusqu’à 7 tMS/ha sur certaines prairies temporaires et luzernières). Elle sécurise une seconde coupe de foin, voire assure un pâturage aux animaux lors de leur descente d’alpage. Ces dernières années, de nouveaux réseaux d’irrigation ont été créés (120 hectares à Lanslebourg-Lanslevillard), d’autres existants ont été agrandis (100 ha à Bramans et Aussois). À Sollières-Sardières, les extensions ont permis d’augmenter de 20 ha la surface irrigable de la commune. Avec 140 ha, le niveau maximum d’équipement y est désormais atteint.
30 millimètres au maximum à chaque fois
Sur cette commune pionnière dans l’irrigation, un GIEE a été créé en 2015 à partir de l’association d’irrigants (sept exploitations). Le but était d’améliorer les pratiques d’irrigation pour favoriser une gestion durable des prairies et des économies d’eau. Les différentes études et analyses de sols réalisées dans ce cadre ont permis de déterminer la juste dose à apporter en fonction des besoins de la prairie (environ 2 000 m3 d’eau par ha et par an) et de la réserve utile (RU). Sur les sols peu profonds de Haute-Maurienne, celle-ci se situe entre 41 et 48 mm. Pour irriguer au plus juste, il convient donc d’arroser peu et souvent, avec des apports de 30 mm d’eau maximum sur une durée moyenne de six heures. Tant qu’il y a de l’eau dans la RFU (Réserve facilement utilisable), les plantes compensent correctement les pertes par évapotranspiration (ETP). Si la plante puise dans les 15 mm restants (réserve de survie), alors c’est le début de la sécheresse. La pratique d’irrigation raisonnable consiste à déclencher l’arrosage avant le point de flétrissement. Sans trop anticiper, car, comme l’observe Vincent Melquiot, éleveur et membre du GIEE : « Prendre de l’avance en matière d’irrigation sur nos sols caillouteux et superficiels ne sert à rien. » Des expérimentations portant sur la fertilisation des prairies, les itinéraires techniques et le choix des espèces ont également été menées par le GIEE entre 2015 et 2018. Elles ont souligné l’importance de remédier aux carences des sols par une fertilisation adaptée en P et K.
Un hersage juste avant l’arrosage serait profitable, mais ce passage d’outil est difficilement envisageable pour des raisons de charge de travail à une période déjà bien remplie (foins, vaches en alpage, irrigation). Les premiers résultats concernant les espèces prairiales ont montré que la composition des mélanges commerciaux était inadaptée et peu pérenne dans le contexte séchant et venteux de la vallée. La recherche d’un mélange résilient et productif est à poursuivre.
« Attention au visuel : une prairie verte peut être en stress »
« Coûteux, les mélanges suisses comportent officiellement une quinzaine de variétés, mais dans nos terres et sous nos climats, peu d’espèces poussent en dehors du ray-grass et des trèfles, constate ainsi Claude Favre, producteur de lait beaufort AOP et bleu de Bonneval. Productif, le ray-grass est très consommateur d’eau et difficile à sécher. D’autant plus quand on récolte le foin en balles rondes, ce qui est mon cas. » Dans son exploitation, les prairies temporaires, semées sous couvert d’avoine, contiennent du dactyle, du trèfle, une poignée de luzerne, de la fétuque, de la fléole et très peu de ray-grass. Les parcelles fauchées sont fertilisées au printemps avec du lisier. Outre l’installation d’une station météo, un bulletin hebdomadaire Herbe et Irrigation a été créé en partenariat avec la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Chaque semaine entre mai et septembre, il informe sur l’évolution de la pousse de l’herbe, les données météorologiques de la semaine, la dose d’eau à apporter.
Il aide les agriculteurs à prendre les meilleures décisions en matière de déclenchement et d’arrêt de l’irrigation à la parcelle et à piloter plus finement leur arrosage. « Sur une prairie, le visuel peut être trompeur ou difficile à interpréter, alerte Vincent Melquiot. Une prairie verte peut être en stress. » Fort de cette première expérience, le collectif d’agriculteurs membres du GIEE a déposé une nouvelle candidature pour poursuivre son travail. Élargi à de nouveaux agriculteurs et territoires, il permettrait d’affiner les questions de résilience des prairies et de valorisation des effluents organiques (compostage fumier-lisier). Le lien entre la gestion des prairies, la qualité du foin et le goût des fromages figure aussi au programme.
(1)Gida : Groupement intercommunal de développement agricole de Haute-Maurienne
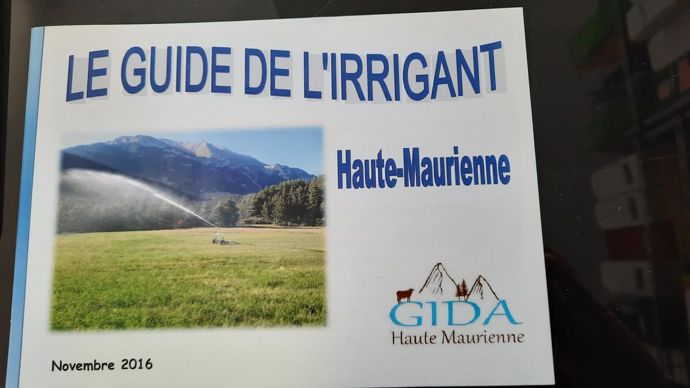






Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?