
Pour Olivier Decultieux, la résilience, c’est « être capable d’accompagner au mieux la conjoncture sans la subir, en anticipant les évolutions de son environnement ».
Typique des monts du Lyonnais, l’exploitation du Gaec Clément Lestra, à Saint-Clément-les-Places, s’est inscrite jusqu’en 2016 dans une stratégie d’augmentation de volume et d’intensification. Cette orientation avait été renforcée avec le regroupement de l’exploitation familiale d’Olivier Decultieux avec celle de David Bruyere en 2008. Résultat : de 300 000 litres sur 60 ha il y a vingt ans avec des vaches à 6 000 litres, la production est montée en 2016 à 650 000 litres de lait avec une moyenne d’étable de 9 500 litres par montbéliarde et un chargement de 1,6 UGB à l’hectare. Un niveau très intensif dans le contexte local caractérisé par des sols séchants et pentus. « Ces dernières années, nous avions la volonté de faire plus de lait, explique Olivier Decultieux. Nous étions pointilleux en génétique (transplantation embryonnaire et semences sexées) et en alimentation. Sur nos cultures, nous réalisions des préparations de sols soignées, avec des apports d’engrais élevés et des désherbages pointilleux. La satisfaction de la performance technique et du travail bien fait nous motivait. »
En 2016, en même temps qu’ils se dotaient d’un robot de traite, les associés du Gaec Clément Lestra ont opéré un changement stratégique : ils ont décidé d’évoluer vers un système moins gourmand en intrants, avec moins de maïs et plus d’herbe. « Le système que nous avions mis en placeétait rentable, analyse l’éleveur, mais il n’était pas durable compte tenu des évolutions environnementales, climatiques, économiques et des demandes sociétales : des vaches qui mangent de l’herbe, qui produisent du lait riche en oméga, etc. »
« Il n’est pas question de ronronner »
Les associés souhaitaient aussi se fixer de nouveaux objectifs pour garder de l’intérêt à leur travail. « Nous avons encore vingt ans devant nous. Il n’est pas question de ronronner. Pour autant, on ne se voyait pas finir notre carrière en trayant encore matin et soir. »
Tout un hiver, Olivier et David ont étudié l’hypothèse d’une conversion en bio, conformément aux sollicitations de leur entreprise Sodiaal. Ils ont même suivi des formations. Finalement, ils ont opté pour contractualiser des MAEC sur les cinq prochaines années en mettant en place un système plus herbager, en réduisant la sole maïs (de 22 ha à 8 ha, si possible d’ici à trois ans), en limitant la quantité de concentrés et les phytosanitaires. « Avec nos sols caillouteux, sableux, filtrants, à faible réserve d’eau, le risque climatique est trop élevé pour opérer d’emblée une transition bio. » La rotation, initialement fondée sur des maïs-ray-grass avec des dérobées, a été allongée avec deux ans de maïs, un an de céréales, trois à cinq ans de prairies multi-espèces ou de luzerne. Sept hectares de luzerne pure ont été implantés en 2016, et vingt de prairies temporaires. Dans le nouveau système, le risque majeur sera lié à la pousse de l’herbe.
« Réussir la récolte de printemps devient essentiel »
« Avec le changement climatique (sécheresse accentuée l’été), la pousse de l’herbe est déjà plus rapide et plus courte, note Olivier. Depuis quelques années, nous récoltons plus tôt et plus souvent : deux coupes avant la période sèche, contre une autrefois. Réussir la récolte de printemps devient essentiel. » Dans la ration, une quantité minimum de maïs (15 kg à 20 kg bruts) sera maintenue toute l’année avec 1 kg de foin de luzerne, 1 kg de céréales (blé, orge, triticale). Les volumes d’ensilage d’herbe varieront de 100 % en hiver à 0 au printemps. Avec plus d’enrubannage, il sera possible d’ajuster la ration des laitières en fonction de la quantité d’herbe disponible.
Pour récolter des fourrages de qualité, les agriculteurs ont la chance d’avoir une Cuma dynamique et qui colle aux besoins de ses vingt-cinq adhérents. Outre une autochargeuse et une enrubanneuse, une faucheuse à rouleaux a été achetée pour la luzerne, ainsi qu’un round-baller muni d’un hachoir. Il faut être vigilant pour maintenir l’état d’esprit et le bon fonctionnement. David, président local de la Cuma, s’y emploie avec son équipe.
Les éleveurs se sont fixé comme objectif de livrer d’ici à cinq ans 725 000 litres en A, ce qui correspond à leur référence, en saturant le robot deux stalles avec 95 vaches à 8 000 litres/VL. Ce lait sera produit dans un contexte de volatilité des prix. Ce qui demandera aux producteurs de s’ajuster en permanence à la conjoncture. « Il faudra être capable de produire aux périodes favorables en augmentant les quantités de lait par vache, en gardant des animaux, en faisant plus de lait d’été quitte à acheter de l’aliment : même s’il est plus cher à produire, il y a les primes. A contrario, il faut pouvoir réduire quand le prix baisse. Ce n’est pas simple, mais pour y parvenir, il faut déjà avoir la volonté. Comme nous pensons que l’augmentation du prix du lait va se poursuivre début 2018, nous avions choisi de piocher, à l’automne, dans notre trésorerie pour acheter un camion de drèches. »
« Tout projet est un challenge et comporte des risques »
Dans leur nouvelle stratégie, les deux éleveurs désirent conserver les bonnes habitudes de fonctionnement et de gestion de l’exploitation qui leur ont permis de maintenir un niveau d’EBE et de rémunération satisfaisant malgré les conjonctures (voir tableau page précédente). Sur l’exploitation, la prudence a toujours été de mise dans les investissements. Alors que l’essentiel du matériel est en Cuma, sauf trois tracteurs et une mélangeuse, les bâtiments ont été construits en parallèle pour être évolutifs. Ils ont été agrandis progressivement en fonction de l’agrandissement du troupeau.
La trésorerie est pilotée avec soin. Pas question de flamber les bonnes années. L’argent est plutôt mis de côté pour pallier les périodes plus difficiles. « En période de taux bas, nous évitons d’autofinancer les investissements », précise Olivier Decultieux. Les travaux de mise aux normes réalisés l’an passé (couverture de la fumière, fosse géomembrane, agrandissement des silos) ont été financés par emprunt. Se constituer un petit pactole aide à faire face aux imprévus, ce qui a été le cas avec la mise en service du robot.
Ne pas travailler dans la routine, être dans l’action est une posture qui aide à être réactif et positif. « Les nombreux projets que nous avons eus sur l’exploitation ne se sont pas tous réalisés, mais ils ont enrichi notre réflexion et alimenté nos pratiques », observe notre interlocuteur. C’est le cas du projet de fusion mené il y a cinq ans avec un Gaec voisin à 2 UMO. Ce rapprochement aurait permis de doubler les volumes. Il ne s’est pas fait. L’étude a montré que les économies d’échelle étaient limitées avec un nouveau bâtiment à construire. La gestion du troupeau aurait été plus difficile. La réflexion n’a pas été vaine. Les deux fermes utilisent en commun une pailleuse.
Pour Olivier Decultieux, il faut savoir évoluer et grossir. Mais dans une conjoncture incertaine, il faut aussi prendre le temps de réfléchir, en faisant attention à ne pas trop se disperser et en ayant en tête que « tout projet est un challenge et comporte des risques ».
| Évolution des résultats sur les trois dernières années | |||||||
|
Produit brut |
Prix du lait /1 000 l |
Charges totales |
EBE |
EBE/produit brut | EBE/1 000 l |
Revenu disponible/UMO exploitant |
|
| 2016 | 353 924 € | 315 € | 252 111 € | 101 813 € | 29 % | 155 € | 41 873 € |
| 2015 | 368 060 € | 352 € | 278 498 € | 89 635 € | 24 % | 133 € | 27 210 € |
| 2014 | 410 150 € | 414 € | 275 082 € | 135 074 € | 33 % | 200 € | 51 290 € |
| La maîtrise des charges, les bonnes habitudes de fonctionnement et de gestion de l’exploitation ont permis aux éleveurs de maintenir un niveau d’EBE et de rémunération satisfaisant malgré les conjonctures des dernières années. | |||||||
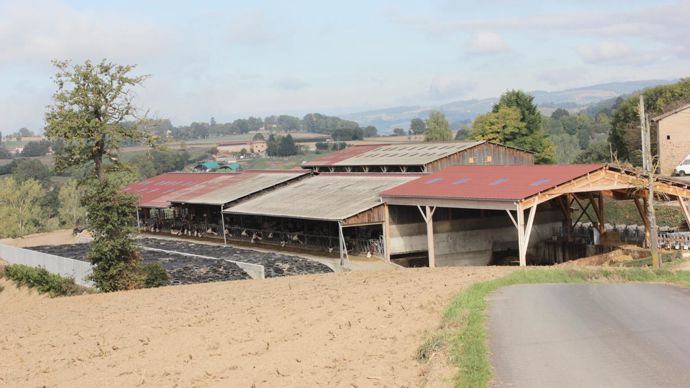








Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »