
Aux Etats-Unis, les producteurs engagés dans une agriculture de proximité sont peu nombreux. Certains parviennent encore difficilement à vivre de leur travail, en raison des obstacles rencontrés pour commercialiser leurs productions. Pierre-Louis et Joan Monteillet en ont fait l’amère expérience ; ces éleveurs de chèvres et de brebis étant, dans l’Etat de Washington, des pionniers de la fabrication et de la vente de fromages à la ferme. Pourtant, l’avenir est au local de part et d’autre de l’Atlantique. Dans l’Union européenne, le projet Pac en faveur du développement rural favorisera les filières courtes. Un article issu de Terre-net Magazine n°8.
 En plus de l’herbe pâturée et du foin (12 ha de prairies permanentes), les ovins et les caprins reçoivent de la luzerne et des compléments alimentaires deux fois par jour. (© DR) |
Aux Etats-Unis
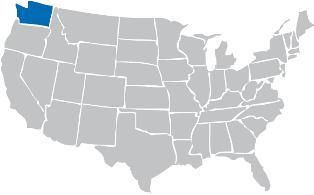
(© Terre-net Média)
Joan et Pierre-Louis Monteillet, éleveurs de chèvres et de brebis à Dayton (Etat de Washington)
Difficile de défendre son modèle agricole
Les petites fromageries fermières, comme celle de Pierre-Louis et Joan Monteillet, sont rares aux Usa. Les premières sont apparues il y a une vingtaine d’années seulement avec, pour ambition, de faire découvrir aux consommateurs américains des produits "naturels". Mais, pas facile de développer la transformation à la ferme dans un pays où la production et la commercialisation de fromages relèvent de grandes firmes agroalimentaires.
|
|
Conscients de ces difficultés, Pierre-Louis et sa femme ont pourtant pris en 2002 un virage à 180°, afin d’être en phase avec leurs convictions : après avoir exploité, pendant 20 ans, les 750 ha de l’exploitation céréalière des parents de Joan, ils se sont lancés dans l’élevage de brebis et de chèvres, avec production et vente de fromages à la ferme.
La ferme de Pierre-Louis et de Joan, située à Dayton, une petite ville de l’Etat de Washington, regroupe 48 chèvres de race alpine et 40 brebis lacaunes. Leur lait est transformé en une dizaine de fromages pasteurisés différents, "très français", crémeux et riches en matières grasses, sans additif ni conservateur.
Ni label, ni dispositif de soutien
Les éleveurs en fabriquent 200 par semaine, qu’ils vendent en moyenne 55,50 $/kg (environ 41 €/kg). En France, une tomme Aoc "Ossau-Iraty" par exemple coûte en moyenne 27 €/kg. Dans ce pays, la notoriété des produits labellisés ou fermiers facilite leur commercialisation, comme la forte demande des consommateurs. Aux Usa en revanche, il n’existe ni label comme l’Aoc, garantissant une qualité liée à la tradition et à l’origine géographique des produits, ni dispositif de soutien pour les filières qualité, la transformation à la ferme ou encore la vente directe.
|
|
coûts de production. Or, les éleveurs ont investi plus d’un million de dollars pour réaliser leur projet.
Pierre-Louis et Joan ont envisagé, à plusieurs reprises, d’embaucher un commercial pour dynamiser les ventes. Toutefois, comme ils ne peuvent pas lui assurer un salaire tous les mois, ils y ont renoncé. Les résultats économiques n’étant pas au rendez-vous, les éleveurs complètent leurs revenus en louant des gîtes et en organisant des stages de fabrication fromagère. Livrés à eux-mêmes, dans une région viticole et de grandes cultures, Pierre-Louis et Joan peinent à défendre leur modèle agricole. Néanmoins, ils ne regrettent pas d’avoir quitté leur ferme céréalière très conventionnelle pour devenir éleveurs de chèvres et de brebis. Même si, être fidèle à ses convictions ne rend pas la vie facile.
A la loupe
L’avenir du secteur agricole est au local
|
|
Les circuits courts ont aussi le vent en poupe aux Etats-Unis. Mais, certains états sont encore pionniers et les agriculteurs, qui optent pour l’agriculture de proximité, souffrent du manque de débouchés, comme Pierre-Louis Monteillet et sa femme Joan. D’autant que les gouvernements de beaucoup d’états n’ont pas encore pris conscience que ce mode d’agriculture constitue une voie de développement porteuse.
Le retour au local se mondialise
Ainsi, l’engouement pour une agriculture locale est une réalité de part et d’autre de l’Atlantique. Un engouement motivé par des questions de santé et de protection de la biodiversité, comme par la volonté de maintenir une ruralité dynamique.
L’essor des circuits courts réduit aussi les distances parcourues par les aliments et diminue la perte de terres agricoles autour des villes. Aux Etats-Unis, des centres-villes abandonnés deviennent des zones agricoles. « Aux Usa, même si le nombre de fermes diminue, celles qui s’orientent vers la vente directe ont augmenté de 15 % entre 2002 et 2007, date du dernier recensement » (1).
Réorientation des soutiens publics
En France, le gouvernement contribue à la relocalisation de la production agricole. D'ailleurs, un décret dans ce sens a été publié dans le cadre de la Loi de modernisation agricole (Lma). Son objectif : inciter, les services de restauration collective de l’Etat, à s’approvisionner en produits locaux à hauteur de 20 % en 2012. Selon les pouvoirs publics, le retour à une agriculture de proximité justifierait la réorientation des soutiens alloués au secteur agricole. « Ainsi, la réforme de la Pac de 2014 vise à amplifier les aides du second pilier, destinées au développement rural » (1)
Cependant, ce mouvement de relocalisation intéresse d’abord l’élite de la population, au pouvoir d’achat plus élevé, donc prête à consacrer une part plus importante de son budget alimentaire à des produits onéreux.
|
Cet article est extrait de Terre-net Magazine n°8 Si vous ne l'avez pas reçu chez vous, retrouvez Terre-net Magazine en ligne en cliquant ICI.
|





Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »